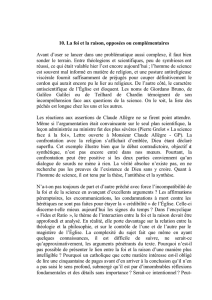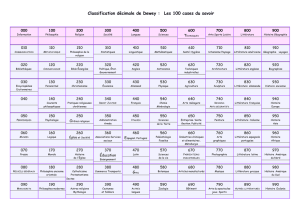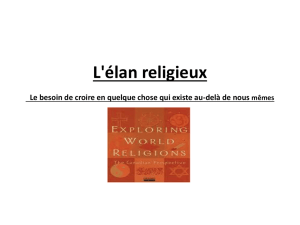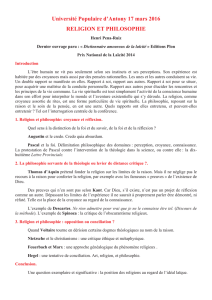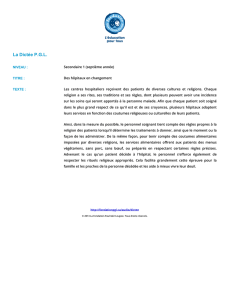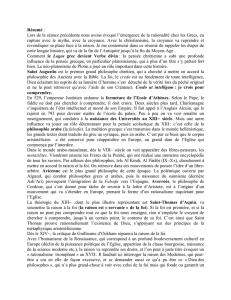La philosophie, médiatrice

209
Studia Theologica VI, 3/2008, 209 -223
La philosophie, médiatrice
entre l’affirmation religieuse et l’attitude de foi
Paul GILBERT sj
Università Gregoriana, Roma
Depuis toujours, des ambiguïtés inhérentes à l’expérience religieuse, un sort que la raison
révèle en toute expérience humaine, ont été mises en évidence par les philosophes et les
théologiens. L’expérience religieuse étant cependant particulière, ses difficultés sont propres à sa
prétention originale, qui est de tenir des liens privilégiés avec l’absolu. Or les expressions de cette
prétention peuvent être mortifères
1
. Les hommes sont hélas experts en transformation de ce qui est
le plus noble en eux pour l’avilir et pour le détruire, de sorte qu’ils deviennent des ennemis d’eux-
mêmes sans même s’en rendre compte. C’est ainsi que les symboles les plus élevés de la sainteté
peuvent être détournés de leur sens. La dénonciation de la sécularisation de ce qui devrait
transfigurer notre existence singulière, par exemple la dénonciation de la sacralisation des pouvoirs
étatiques, est commune chez les philosophes, dont la fonction est de servir la vérité. En prolongeant
des textes de Varron, Augustin a mis en évidence l’ambiguïté des prétentions religieuses
lorsqu’elles se donnent des figures trop humaines
2
. La réflexion que je propose ici indiquera
comment le discernement de la philosophie peut tenir un rôle de garant de la vérité qui libérera
l’expérience religieuse de ses ambiguïtés.
Mon titre oppose deux termes, ‘affirmation’ et ‘attitude’
3
. Cette opposition peut paraître
brutale et exagérée ; je me situerai en fait à un niveau purement schématique, d’essences pures
autant qu’irréelles ; c’est là un choix de ma part, mais une décision utile pour mettre en évidence les
arrêtes du problème. J’oppose de même, au seuil de mon exposé, la religion et la foi, exagérant ainsi
l’idée que Thomas d’Aquin se faisait de la foi qui ne se fixe pas sur les énoncés littéraux des
1
Ce n’est pas l’intention de notre réflexion d’approfondir ici la question du lien de la violence et du
monothéisme, bien que cette question dramatique soit tenue ici en arrière fond.
2
Voir s. Augustin, La Cité de Dieu, VI, v-vi.
3
On pourrait renvoyer ici à la distinction entre l’‘attitude’ et la ‘catégorie’ que propose Weil, Éric
²1996, Logique de la philosophie. Paris: Vrin, p. 79-80 ; j’utiliserai ce vocabulaire, sans les nuances que Weil

210
croyances, mais qui s’élance au delà, vers le mystère qu’est Dieu même
4
.
L’affirmation religieuse
Par ‘affirmation religieuse’, je n’entends pas les présentations par les théologiens des
systèmes spéculatifs de leurs religions respectives, mais plutôt les moyens que les religions utilisent
pour s’affirmer, c’est-à-dire pour ‘prendre consistance’ dans nos sociétés, nos cultures, pour
s’installer dans l’histoire. Parmi ces moyens, il faut évidemment compter la puissance politique, et
donc la tendance toute naturelle à identifier la religion et l’État, comme dans l’Islam ou en Europe
lorsque l’édit de Nantes consacra le mot « cujus regio, eius religio ». L’affirmation religieuse est
une affirmation spontanée de l’homme, à laquelle participe toute personne et tout groupe humain et
qui naît autant des passions de la vie que, nous le verrons, de la raison.
S’affirmer, c’est se poser de manière ‘ferme’. L’étymologie du mot en précise l’idée.
S’affirmer, c’est faire en sorte qu’on ait des aspects ‘fermes’ (firmare signifie ‘solidifier’,
‘fortifier’) ou des ‘formes’ (formare qui veut dire ‘façonner’, ‘régler’) en vue (ad) d’apparaître et de
se faire reconnaître parmi les autres réalités du monde en se donnant une visibilité déterminée, une
identité. Cela implique que cette affirmation de soi développe des processus qui permettent de se
distinguer de toutes les ‘autres’ réalités et de faire voir les différences. C’est dans ce contexte que
s’engendrent les volontés d’exclusion de ceux dont on ne reconnaît pas la participation aux mêmes
affirmations identitaires. Le propre d’une religion, un mode d’être parmi tous les autres modes
d’être qui affirment leur identité en se distinguant des autres formes de vie, est toutefois qu’elle se
veut absolue, car la religion est par essence une manière de s’unir à l’absolu. Cette exclusivité en
faveur de l’absolu entraîne le désir de l’emporter sur tout autre système religieux.
On notera que la religion englobe et fixe les codes moraux de la société qu’elle régit, comme
tout processus identitaire. Nous pouvons nous identifier à un mouvement de jeunesse, à un groupe
d’entraide, à un club sportif, chaque fois sous le regard d’un symbole représentatif, d’un uniforme,
d’une bannière, d’une représentation d’une valeur supposée absolue et indiscutable dans son genre.
lui accorde dans sa perspective propre.
4
Voir Thomas d’Aquin, Somme de théologie, IIa-IIae, q. 1, a. 2, ad 2 : « L’acte du croyant n’a pas
son horizon [non terminatur] dans un énoncé, mais dans la chose [rem] même ». Cette règle, note l’Aquinate
dans le même passage, vaut aussi pour les sciences.

211
Nous aurons à chaque fois des codes de conduite spécifiques, qui donnent à ceux qui y participent
le sentiment d’appartenir par leur pratique quotidienne à un ensemble vivant, plus large que leur
seule individualité. La sociologie s’occupe de ces phénomènes d’identification par construction de
cellules sociales autodéterminées mais particulières. Les processus d’identification peuvent aboutir
à ce que toute détermination posée fermement par un autre groupe au sein d’un même genre social
soit vu comme une menace et donc insupportable. Cela arrive dès qu’un groupe humain juge son
principe d’agrégation absolu, c’est-à-dire, selon l’étymologie du mot ‘absolu’, sans aucune nuance
possible de relativité. Beaucoup de nos groupes humains se prétendent absolus dans leur genre.
Mais dès qu’un groupe humain pense que son principe d’agrégation est le meilleur de tous ceux que
l’on peut poser, c’est-à-dire sans égal, dès qu’il prend conscience d’en exprimer entièrement la non-
relativité, il engendre immédiatement la violence, polie ou non, de ses membres. C’est ce qui se
passe lorsque des supporters de football guerroient dans les tribunes à la manière de leurs équipes
qui s’opposent sur le terrain où l’une l’emportera sur l’autre. Le principe d’identité (et sa
revendication d’absoluité) est accentué dangereusement quand il se conjoint à la pratique de la
compétition, car l’égalité ou la relativité réciproque des groupes sociaux s’y révèle insupportable, la
qualité du meilleur ne souffrant aucun partage.
Dans la mesure où toute religion se définit comme une expression adéquate d’une perception
du meilleur et d’un absolu qui concerne la totalité de l’existence, elle ne peut pas ne pas se vouloir
entièrement exclusive ; toute rencontre avec une autre religion sera nécessairement compétitive et
violente. La volonté de rendre pacifique la cohabitation des religions ne peut que manifester la perte
du sens religieux au sein de nos sociétés. Les religions se veulent naturellement omni-
compréhensives, intégratives de tous ceux qui y participent et de toutes leurs actions. Leurs
théologiens peuvent ainsi prétendre enseigner la structure réelle du monde. Les attitudes que les
religions imposent à la suite de leurs travaux et de leurs réflexions ont alors pour fonction de rendre
possible la vie dans un monde qui n’est pas seulement agréable pour tous (règles d’hygiène, pour le
vêtement, pour reproduction des membres du groupe, etc.) parce que sans questionnement
fondamental, mais qui est surtout en harmonie avec l’ordre cosmique sacralisé. Les actions
accomplies religieusement expriment par principe l’ordre idéal du monde ; elles ont pour rôle de
faire venir cet ordre à la visibilité ; elles veulent représenter et exprimer adéquatement le cosmos
sous des aspects symboliques à la fois pratiques et cognitives. De là les rituels scrupuleux et
somptueux, détaillés, où chaque moment d’exécution et chaque position des acteurs dans l’espace
est à comprendre en fonction d’un temps sacré et d’un ordre cosmique immense. Les religions
symbolisent l’absolu dans le concret.
Cela dit et redit par les historiens et les sociologues modernes et contemporains, le point à

212
considérer est cependant le suivant : comment se fait-il que naisse l’idée d’une symbolisation de
l’absolu dans l’existence de chacun qui, de toute manière, est relative, contingente ? D’où viennent
les religions ? Comment comprendre que l’appel et la représentation de l’absolu dans la vie
quotidienne soit source de violence, alors que l’absolu est précisément ce qui devrait tout unir, ce
qui devrait donc assurer une communion et une paix universelle ? Ma thèse est que l’homme est
naturellement religieux en tant qu’il est rationale
5
, la religion étant une expression directe de sa
raison. Voilà pourquoi la religion peut utiliser des aspects violents de la raison. L’homme jouit de la
raison quand il en pratique les fonctions, par exemple quand il fait mémoire de son passé ou qu’il
projette son futur. Mais nous devons dire surtout que la raison transcende ces mêmes fonctions
puisqu’elle est capable de s’y tenir ou non, d’en manier les objets, de les analyser dans une sorte
d’atemporalité pour les organiser d’une manière plus ou moins libre. Les créations de la raison ne
sont pas déterminées par le seul fait qu’elle connaît et analyse leur succession événementielle ; la
raison transcendante est en effet inventive, capable de perturber l’ordre des choses et de créer des
réalités nouvelles. Les prouesses de la technique contemporaine le montrent en suffisance : la raison
humaine est créative. De là sa conviction : elle n’est pas soumise au destin des choses relatives. En
outre, elle se connaît critère des relatifs, indépendante d’eux qu’elle transcende, et donc absolue.
Les religions assument cette même capacité de la raison à transcender les faits isolés, à les
organiser pour leur donner un sens qu’en eux-mêmes ils semblent ne pas avoir. Elles possèdent elles
aussi une puissance d’invention. Inventer n’est cependant pas créer n’importe quoi par pure
fantaisie. L’inventivité de la raison et de la religion suppose toujours que soient cohérents les
différents éléments du monde. Aucune invention ne pourrait être envisagée si le monde à partir
duquel on va la réaliser n’était pas fiable. Mais ce n’est pas là un destin qui pèse sur la raison.
L’invention par l’homme rend témoignage au fait qu’il sait a priori qu’il est dans un monde
ordonné, mais aussi que son travail rationnel va révéler cette invisibilité, la rendre visible de sorte
qu’elle va devenir davantage disponible. L’invention, en son acte producteur, fait venir en visibilité
l’ordre a priori du monde qui, autrement, resterait à jamais dans une obscurité menaçante
6
. La
raison reconnaît l’avènement de ce fond obscur dans ses réalisations techniques, et cela lui donne de
l’espoir pour aller plus loin. Toutefois, elle doit être prudente. Elle ne pourra pas faire en effet
5
Voir la définition classique de la personne, chez Boèce : persona est naturae rationalis individua
substantia (dans le De duabus naturis et una persiona Christi, chap. 3 [Migne, PL 64, col. 1345]).
6
Ladrière, Jean (2005), ‘L’intelligence de la foi et le devenir de la raison’, dans Bousquet, François
& Capelle, Philippe (éds) (2005), Dieu et la raison. L’intelligence de la foi parmi les rationalités
contemporaines. Paris: Bayard, p. 15-28. L’espérance de la raison et légitimée par le fait qu’elle s’élance

213
qu’elle n’ait pas eu la possibilité de faire émerger l’ordre du monde en quittant un désordre
préalable : de là l’idée que l’ordre, qui n’avait pas été préalablement perçu par le savoir, ne pourra
sans aucun doute jamais être entièrement connu et dit. Quant aux religions, elles font elles aussi
venir à la lumière l’ordre caché du monde, en prétendant cependant se situer à la pointe extrême de
sa révélation totale. En ce sens, elles sont plus pressées que la raison, plus impatientes que les
sciences.
Voilà d’ailleurs pourquoi les religions sont susceptibles d’être soumises à la critique et au
doute. Les processus qui soutiennent leur imagination peuvent être interprétés de nombreuses
manières ; la culture philosophique occidentale le sait depuis des siècles, avant même que l’étude
spécifique de la philosophie de la religion ne prenne son envol
7
. On pourrait par ailleurs se
demander, en considérant que la religion et la raison ont des structures tout-à-fait semblables
8
, si les
interprétations qui déconstruisent les religions au nom de la raison n’épousent pas ou ne profitent
pas des mêmes processus qui ont été à leur origine, en travaillant également à bloquer le
mouvement de la recherche du sens dans quelque substance ou raison anthropomorphe, à la mesure
du seul homme. Mais arrêtons-nous maintenant au second segment de mon titre : l’attitude de foi.
L’attitude de foi
Pour se défendre des interprétations malveillantes de la religion, des théologiens chrétiens
ont distingué la ‘religion’ et la ‘foi’ jusqu’à les séparer radicalement. Cette distinction, fort présente
à l’époque de Vatican II mais déjà ancienne dans la littérature critique
9
, s’enrichit en étant
confrontée à d’autres, par exemple à celle de la chrétienté sociologique et du christianisme
évangélique
10
, ou encore, dans un langage proprement philosophique, du catégorial et du
vers un sens total, qui ne peut pas ne pas lui être donné au présent, mais seulement de façon inchoative.
7
Laquelle est née en 1772. Cf. Greisch, Jean (2002), Le buisson ardent et les lumières de la raison.
L’invention de la philosophie de la religion. I. Héritages et héritiers du XIXe siècle. Paris: Cerf, p. 31.
8
Même affirmation d’un ou de plusieurs principes premiers sous la lumière de l’idée d’absolu ;
même affirmation pour laquelle cet absolu se lit dans la particularité de l’expérience sensible et quotidienne.
9
Voir les travaux de Paul Tillich, qui distingue les domaines du conditionné et de l’inconditionné
(cf. Greisch, Jean [2002], p. 415-441).
10
Voir Vattimo, Gianni (2002), Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso. Milano:
Garzanti.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%