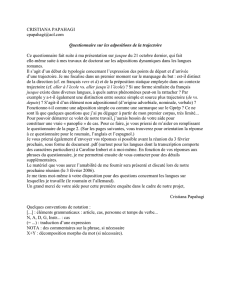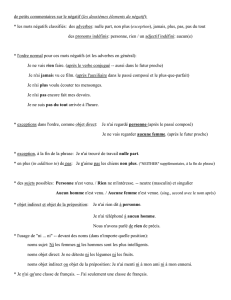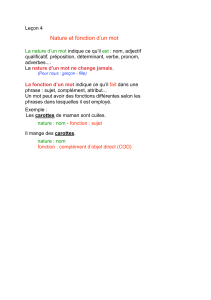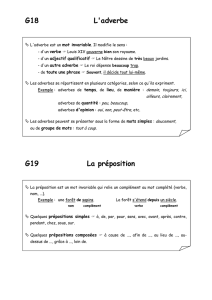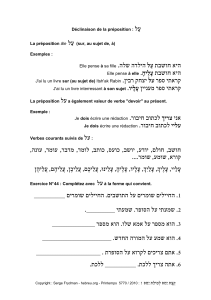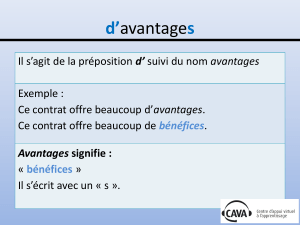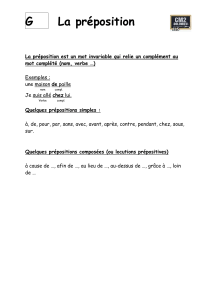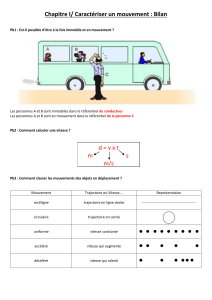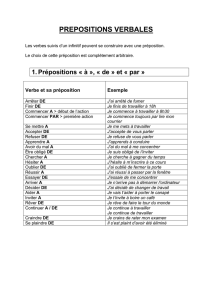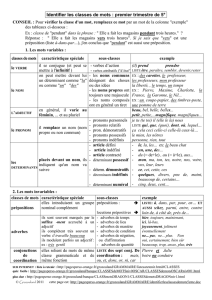Questionnaire vierge

Cristiana PAPAHAGI juin 2006
1
Questionnaire sur les adnominaux spatiaux
Introduction
Ce questionnaire fait suite et complète le questionnaire sur l’expression du but. Suite aux discussions
du 7 avril, ce nouveau questionnaire met l’accent sur :
a. l’organisation générale du système des marques adnominales spatiales d’une langue ;
b. la dynamique historique de ce système, là où il est possible de la reconstruire.
Le questionnaire est organisé en trois parties :
A. une introduction avec rationalisation du questionnaire
B. le formulaire du questionnaire lui-même, à remplir et à rendre daté ;
C. une annexe qui comprend quelques entrées du Lexique utiles pour le remplissage
du questionnaire et les conventions de notation pour les gloses.
Le présent questionnaire (introduction et formulaire) comprend deux volets :
1. le système général des adpositions de votre langue : cette partie sera discutée lors de
la réunion de Lyon les 3 et 4 juillet. Il serait donc souhaitable que vous y
apportiez/envoyiez une première réponse. Le plus simple serait de scanner/photocopier
dans une grammaire un tableau ou une liste des adpositions, avec vos commentaires en
marge.
2. le fonctionnement en phrase de ces adpositions. Ce deuxième volet est donné ici pour
base de départ : il ne s’agit pas d’y répondre pour l’instant, mais plutôt de penser à
le modifier/compléter en fonction de votre langue.
A. INTRODUCTION ET RATIONALISATION
I. Vue d’ensemble et systématique des adnominaux spatiaux
Par marques adnominales nous comprenons (cf. les articles de Wälchli 2006 distribués) les adpositions
et/ou marques casuelles qui accompagnent un nom pour en faire du point de vue syntaxique un
complément de lieu et du point de vue sémantique un site.
Dans cette section, il s’agira de considérer le système d’adpositions de trois points de vue :
morphologique (point 1 ci-dessous), sémantique (2) et syntaxique (3), et y ajouter ensuite une
dimension historique (4) dans la mesure du possible.

Cristiana PAPAHAGI juin 2006
2
1. point de vue morphologique
Plusieurs types d’organisation des adnominaux ont été retenus suite au questionnaire « jusque ». Il
s’agit donc d’encadrer votre langue dans l’un des types suivants ou, le cas échéant, de signaler si
votre langue se comporte différemment. Je rappelle que seuls sont pris en compte les adnominaux
qui ont ou peuvent avoir un sens spatial.
1.1. langues à système adpositionnel uniquement (i.e. sans cas, ou sans cas à valeur sémantique :
dans ces langues, seules des adpositions peuvent introduire un complément de lieu) :
a. système adpositionnel réduit :
- à une seule adposition simple et plusieurs constructions complexes (locutions)
Ex : cas du tagalog : adposition simple : sa,
constructions complexes : sa ilalim ‘dessous’, sa gitna ‘entre’, etc.
- à 3-5 adpositions simples et plusieurs constructions complexes/ dérivées :
Ex : cas du birman : adpositions simples : ka’ ablatif, ko direction, mha statique ;
adpositions dérivées : be? ‘côté’, the? ‘intérieur’ ;
adpositions complexes : ka’-ne ablatif+ ‘endroit’, ?a-thi’ ‘jusque’
b. système adpositionnel développé : langues qui possèdent plus de 5 adpositions simples, des
adpositions composées et des constructions complexes : cas des langues romanes (exemple : en
roumain on a 12 prépositions simples spatiales, 8 prépositions composées et une liste ouverte
de locutions). Dans ce cas :
- adpositions simples (monosyllabiques) : donner la liste
- adpositions composées de deux (ou trois) adpositions simples : donner la liste et
signaler si la composition est figée (lexicalisée) ou encore analysable pour le locuteur :
Ex: en roumain on a d’un côté des composés comme dintre < de + între (de+entre) qui est analysable
(comme en français d’entre) et d’un autre côté des composés inanalysables comme deasupra <
de+ad+supra (de+à+dessus = au-dessus de).
- locutions : donnez quelques exemples si la liste est ouverte, éventuellement organisés
selon le type de construction (voir Annexe pour un exemple). Précisez éventuellement
leur origine, si elle est connue, p.ex. en roumain locution în spatele ‘dans le dos de’
provient d’un nom de partie du corps/objet (le dos) plus préposition ‘dans’.
1.2. langues à système casuel uniquement : il s’agit de langues où le complément de lieu est marqué
par un ou plusieurs cas spécifiques, sans adpositions. Pour l’instant, on n’a pas eu de langue dans
cette situation.
1.3. langues à système complexe casuel et adpositionnel : langues qui possèdent des adpositions
simples et complexes qui se combinent avec des cas à valeur spatiale et éventuellement avec
d’autres éléments.
Ex : Cas de l’allemand qui possède un grand nombre d’adpositions simples, dont une partie se combinent avec
Accusatif ou Datif (en alternance significative : accusatif de la direction vs. datif de l’état). Par ailleurs, ces
adpositions apparaissent aussi comme des préfixes verbaux, seules ou combinées avec des directionnels.

Cristiana PAPAHAGI juin 2006
3
Question annexe : Prière de signaler si un adnominal peut également avoir d’autres emplois
(comme préfixe verbal, adverbe, etc.), pour qu’il soit pris en compte dans les questionnaires qui
porteront sur la zone verbale.
Question annexe : Si votre langue se trouve dans la situation 1.3, prière également de signaler le
rapport qui existe entre cas et adposition. Idéalement, il paraît y avoir deux possibilités
seulement :
a. les cas expriment des relations de base (état/déplacement, séparation/contact, etc.) et les
adpositions affinent ces relations. Il s’agit alors d’un cas de distribution sémantique des
informations état/mouvement (et son orientation) sur le cas et forme du site sur l’adposition
Ex : en latin, le cas ablatif exprime la source d’un mouvement, seul ou avec des
adpositions : ex + Abl. note la sortie d’une intériorité, alors que ab + Abl. note la perte
d’un contact, le départ ; ex et ab précisent donc la relation exprimée par le cas seul).
b. les cas expriment divers types de relations et de sites. C’est donc un cas de conflation
sémantique entre information état/mouvement et forme du site.
Ex : en hongrois, un cas spatial exprime l’idée de but, de source ou d’état et une forme
grossière de site (intériorité, surface, contact) : -ba/-be illatif, -bol/-böl élatif, etc. Les
adpositions ( ?) hongroises expriment, elles, des relations complexes comme près de,
devant, etc.
2. point de vue sémantique
2.1. Le but est de voir quelle est la distribution des adnominaux (adpositions simples et
complexes, cas) entre éléments statiques, dynamiques (qui expriment la trajectoire) ou neutres
Ex : le français n’a pas de préposition statique, il a des prépositions dynamiques (de, vers, jusqu’à...) et des
prépositions neutres, ie qui sont soit dynamiques soit statiques selon le contexte, et notamment selon le verbe :
à, en, dans, sur... :
statiques dynamiques neutres
- de, depuis, dès, à partir de à
par, parmi, à travers en, dans
le long de sur/sous
vers, en direction de devant/derrière
jusque+à, en, dans... etc.
2.2 Les points de la trajectoire :
Voir ci-dessous la granularité « idéale » des points de la trajectoire présentée lors de la séance d’avril,
avec exemple du français :
Question : veuillez remplir le tableau avec les adnominaux de votre langue :

Cristiana PAPAHAGI juin 2006
4
Ex : Granularité sémantique (3x3) Ex français
simple composé
final vers en direction de
pour
par rapport initial - de la direction de
à un repère
médian - -
initial de -
Traj. par rapport final (à, en, dans, sur...) (au-dessus de...)
à un site
médian (par) à travers
initial depuis à partir de
combinée final - jusque+à, en...
avec un site
médian - -
Les paranthèses signalent que l’élément n’est pas spécifique. Si tel est le cas dans votre langue, prière
de le préciser.
Nota : voir le Lexique dans l’Annexe pour la notion de « repère »
3. point de vue syntaxique
Cette section vise à relever le fonctionnement syntaxique des adnominaux par rapport au mot
déterminé et de là, à répondre à la question suivante : est-ce qu’il y a une différence de
fonctionnement syntaxique entre les adnominaux qui expriment la trajectoire et les autres,
statiques ou neutres ?
Ex. dans les langues romanes : A la suite de Ruwet (1968) et à partir des résultats du premier
questionnaire, j’ai proposé la distinction suivante : les adnominaux neutres ou statiques sont des
éléments primaires, dont le rôle est de construire un site (i.e. ils donnent une forme conceptuelle
à un objet) ; dans les termes de Ruwet, toute adposition neutre (dans, sur, sous, en...) est
réductible à à + une forme d’objet. Par contre, les adnominaux qui expriment la trajectoire sont
des éléments secondaires, qui s’appliquent sur un site déjà construit, explicitement (comme en
roumain : de la scoalã ‘de à école’) ou implicitement (comme en français : de [*à ] l’école).
Cette différence entre les adnominaux neutres/statiques et dynamiques est visible surtout dans la
combinaison avec les adverbes de lieu (substituts ou non) et parfois avec les noms de

Cristiana PAPAHAGI juin 2006
5
localisation : ici remplace un Gprép comme dans ma chambre, sur la table et il contient donc
conceptuellement une adposition statique. En conséquence, ici ne peut pas être accompagné
d’une adposition *dans ici, *sur ici, sauf par une adposition qui exprime la trajectoire : d’ici, par
ici, jusqu’ici.
Plusieurs types de mots déterminés ont été pris en compte :
a. un nom d’objet comme table, arbre, etc. Dans ce cas, les adnominaux spatiaux le
déterminent-ils directement ou non ? Tous ou certains seulement ?
Ex : en roumain, toute préposition neutre peut accompagner un tel nom : pe masã ‘sur la table’, sub
masã ‘sous la table’, la masã ‘à table’, mais les prépositions initiale, médiane et finale doivent être
suivies d’une préposition neutre : de pe masã ‘de sur la table = de la table’ et non pas *de masã ‘de la
table’.
Question annexe: Si plusieurs adnominaux déterminent un seul nom, prière de préciser si
cette situation est obligatoire (comme en roumain) ou seulement possible (comme en français
de sous la table). On considère également comme deux adnominaux une adposition et un cas
comme en allemand auf dem Tisch ‘sur la[D] table’, si le cas a un sens spatial.
b. des lieux comme Paris, maison (chez soi), terre, etc.
Ex : Dans certaines langues, comme le latin, certains lieux sont considérés comme
typiques (Roma ‘Rome, la ville’, rus ‘à la campagne’, domus ‘à la maison’, etc.). Ces
noms peuvent avoir un comportement distinct de a. en ceci qu’ils ne nécessitent pas de
préposition ; ils sont toujours interprétés comme un lieu. Par contre, ils prennent toujours
un cas pour signaler leur position sur la trajectoire : eo rus, eo Romam ‘je vais à la
campagne, je vais à Rome’ avec accusatif de la direction.
Question: Dans votre langue, existe-t-il des noms qui nécessitent soit moins de
détermination spatiale que les autres noms (comme en latin) soit pas du tout de
détermination (i.e. ni cas, ni adposition) pour fonctionner comme des compléments de
lieu ?
c. des noms de localisation qui désignent des Régions (voir annexe) : le devant,
l’intérieur, le long. Ils possèdent certaines des caractéristiques d’un nom (par exemple,
dans les langues IE, ils prennent un complément du nom comme tout autre nom : le dessus
de la table = le fils de mon père), mais pas toujours toutes les caractéristiques (par
exemple, en roumain un tel nom ne peut pas apparaître en fonction sujet ou objet, mais en
français si : le dessus de la table est sale). Ces noms sont la principale source de création
d’adpositions (par grammaticalisation).
Question : Pour mesurer leur degré de grammaticalisation : est-ce que des noms comme
la surface, l’intérieur, le bord, etc. doivent prendre une adposition ou un cas spatial pour
fonctionner comme complément de lieu ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%