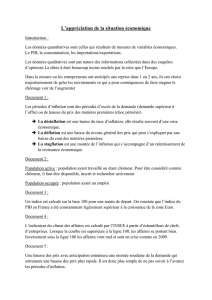Inflation et choix économiques [modifier]

La nouvelle économie a-t-elle fait disparaître l’inflation ?
On entend fréquemment dire que l’inflation n’existe plus dans le contexte de la nouvelle
économie. Cette affirmation serait basée sur plusieurs explications. Examinons les
successivement.
- La mondialisation de l’économie accroît la concurrence et favorise ainsi de faibles hausses
des prix. L’inflation mesure une hausse générale du niveau des prix. Or, ce que la
mondialisation peut faire en redéfinissant les structures des marchés ne concerne pas ce
niveau général. Pour preuve, en régime de changes flexibles, le taux d’inflation peut être
durablement différent dans deux pays, sans pour autant que la compétitivité relative des
entreprises soit modifiée. Par ailleurs, à supposer que cette explication soit exacte, on
remarquera que les secteurs concernés par la concurrence internationale ne déterminent que
pour une part les biens inclus dans l’indice des prix à la consommation et que la mondialisation
est à ce jour encore limitée.
- Les nouvelles caractéristiques des processus de production et du marché du travail, plus
flexibles, favorisent une meilleure circulation de l’information et des ajustements plus rapides
aux déséquilibres : activité et emploi s’ajustent plus vite que par le passé aux variation des
prix et salaires ou l’inverse, réduisant ainsi les variations des taux d’inflation. C’est une
hypothèse plausible, mais difficile à mesurer.
- Le niveau et peut-être le taux de croissance de la production potentielle dans la nouvelle
économie ont augmenté. Dans ce cas, l’inflation ou du moins son accélération sont d’autant
moins probables que la production réelle n’aura que peu de chances de dépasser le plein
emploi des capacités. Reste alors à confirmer cette hypothèse par une mesure adéquate de la
production et de la croissance potentielle, mesure qui s’avère problématique.
- Une vision de la question aux conséquences différentes est que l’inflation mesurée par
l’indice des prix à la consommation s’est réfugiée dans une inflation des actifs. La hausse des
prix en tant que témoin d’un déséquilibre macroéconomique générateur de cycles, se mesure
désormais par l’ampleur des bulles spéculatives. Primo, les actifs financiers en tant qu’élément
du patrimoine des ménages déterminent leur consommation. Ils déterminent également
l’investissement des entreprises, dans la mesure où la valeur de la firme a un effet sur celui-ci.
Le cours des actifs financiers a donc une influence sur la demande globale. Mais ces deux
effets sont généralement sujet à caution. Secundo, on considère plus souvent que c’est par le
biais du crédit bancaire que l’inflation par les actifs a une influence sur le cycle économique.
Les actifs détenus par les agents servent de garantie au crédit bancaire (voir les modèles de
rationnement du crédit et de cycles financiers). Lorsque leurs cours sont élevés, l’obtention de
crédits est facilité. Inversement lorsqu’ils sont bas. De sorte que les variationss des prix
d’actifs conditionnent les évolutions de l’investissement et de la consommation. Ainsi, dans
cette logique, l’inflation a disparu de l’indice des prix à la consommation, mais ses effets
déséquilibrants sont toujours présents au travers des variations des cours boursiers.
Il ressort de ce rapide survol que :
- la nouvelle économie en soi n’exclut pas la possibilité d’une inflation au sens traditionnel,
dans la mesure où les mécanismes macroéconomiques usuels reliant demande globale et
inflation n’ont aucune raison d’être remis en cause. Tout au plus, sont-ils accélérés par un
fonctionnement plus fluide des marchés;
- si on accepte néanmoins l’hypothèse selon laquelle la nouvelle économie se caractérise par
un contexte structurel favorisant une faible inflation, les outils de la théorie économique (et la
pratique standard de la politique monétaire) ne sont pas remis en cause. Un nouveau contexte
donne simplement de nouvelles valeurs à certains paramètres du ou des modèles utilisés (le
PIB potentiel par exemple), sans en bouleverser la structure;
- le rôle des banques centrales est prépondérant dans tous les cas. D’une part, c’est très
probablement du côté des politiques de désinflation menées depuis les années 1980 qu’il faut
chercher l’origine de la faible inflation des années 1990 et non en se tournant vers la nouvelle
économie. Si la pratique des politiques monétaires venait à se modifier dans le sens d’une
grande détente monétaire, l’inflation reapparaîtrait. D’autre part, si l’inflation par les actifs est
un repère pertinent (ce qui est très probable), alors la fonction prudentielle des banques
centrales devient essentielle.

Quels sont les coûts de l'inflation ?
La question est importante et la réponse pourtant encore largement
méconnue. En dehors des cas d'hyperinflation, le problème du pouvoir d'achat
des consommateurs n'est qu'un argument faiblard utilisé par un politicard
tocard au 20 heures. Les procédures d'indexation des revenus sont
suffisamment développées dans une économie structurée pour que seuls
quelques agents mal informés craignent l'inflation pour cette raison. Certains
vous diront même que c'est formidable, l'inflation, pour doper l'activité. Mais là
n'est pas la question, nous parlons des coûts.
Le problème principal de l'inflation est de créer une distortion temporaire
dans l'évolution des prix relatifs et d'induire des choix économiques
(notamment d'investissements sectoriels) malheureux. Ces choix pourront être
corrigés plus tard, mais avec une inertie plus ou moins grande et des effets
d'hystérèse plus ou moins marqués. En gros, c'est l'argument de Hayek et de
Lucas ( dans les années 70) : l'inflation est mauvaise parce qu'elle perturbe le
processus d'allocation des ressources en occasionnant des variations de prix
relatifs qui ne sont induites que par le décalage qu'occasionne l'inflation entre
la hausse des prix des différents bien dans l'économie. Le seul argument solide
allant dans ce sens n'est même pas celui que je viens de citer, mais celui qui
consiste à dire que l'inflation a un coût seulement dans la mesure où les
agents pensent qu'elle en a un, et agissent en fonction (Barro).

Inflation réelle ou ressentie ?
Voilà en tous cas un défi pour l’Insee : le difficile calcul du panier type …
Le décalage entre les indices de prix officiels et l'inflation ressentie par les consommateurs est
répandu en Europe depuis le lancement de l'euro, même si les économistes affirment que ce
calcul est ajusté au plus près de l'évolution des comportements.
L’euro en partie responsable
"Il y a eu une vague de contestation déclenchée par le passage à la monnaie unique.
Quasiment tous les pays de la zone euro ont connu des débats sur la réalité" des chiffres de
l'inflation, remarque Dominique Guédès, de l'Insee.
Même le président de la Banque centrale européenne (BCE), Jean-Claude Trichet, a récemment
reconnu que les citoyens "perçoivent des augmentations de prix supérieures à ce que nous croyons
être la vérité".
En France, où la hausse des prix a officiellement atteint 1,6% en 2006, l'Insee tente de "dissiper les
malentendus" en lançant un calculateur personnalisé, disponible mardi sur son site internet,
emboîtant le pas à l'Allemagne et la Grande-Bretagne.
Statisticiens et économistes font valoir que les indices comptabilisent non seulement les produits de
consommation courante comme l'alimentation et le logement, qui ont beaucoup augmenté ces
dernières années, mais aussi des dépenses plus occasionnelles comme les voyages, les télévisions
ou l'électroménager, qui ont parfois nettement baissé.
En Italie, les chiffres de janvier prennent ainsi pour la première fois en compte les cartes de
mémoire numériques ou les couettes, mais plus les couvertures, les cassettes vidéo ou les appareils
photo classiques.
Par exemple, "tout le monde a maintenant son téléphone portable, même les adolescents".
Il y a aussi un "effet euro", remarque-t-il. "On achète plus facilement des produits à 15 euros qu'on
achetait ceux à 100 francs".
Le cabinet d'étude Bipe prônait il y a quelques mois un calcul du pouvoir d'achat fondé sur les
dépenses incompressibles, comme le remboursement des crédits (non pris en compte par l'Insee),
les loyers, les assurances obligatoires et les transports collectifs, mais sans intégrer l'essence ou le
téléphone mobile, estimant qu'ils relèvent d'un arbitrage des ménages.
L'Insee note qu'il publie également un "indice des ménages urbains dont le chef de famille est
ouvrier ou employé", qui reflète peut-être mieux la hausse des prix pour les foyers modestes que
l'indice global.
Pour le magazine 60 millions de consommateurs, ce dernier a, entre autres, plusieurs vices: il prend
en compte le logement "à seulement 6% des dépenses des ménages, alors qu'elles en représentent 20
à 25%.
Mardi 27 Février 2007
BM

Inflation (wikipédia).
L'inflation est la hausse du niveau général des prix, entraînant une baisse durable du pouvoir
d'achat de la monnaie[1][2]. Elle est généralement évaluée au moyen de l’Indice des prix à la
consommation (IPC).
En général, on parle de l'inflation des prix à la consommation des biens et services, mesurée à
qualité égale. L'inflation est un phénomène persistant, autoentretenu, qui touche l'ensemble des prix
(avec une amplitude variable)[2].
Définitions [modifier]
L'inflation est la « hausse généralisée et durable du niveau général des prix »[2]. Elle se traduit par
une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie, et à un taux de croissance différent entre valeur
nominale et valeur réelle.
Employé seul, le terme d'inflation fait référence à la seule hausse de prix des biens de
consommation, à l'exclusion de la hausse des prix des actifs (financiers, immobilier,…). Lorsqu'on
parle de l'augmentation des prix de l'immobilier, des actions, des fonds de commerce ou autres
actifs, on doit alors préciser que l'inflation se rapporte au niveau des prix de ces actifs.
La stabilité des prix décrit la situation où la hausse des prix est durablement très faible ou nulle,
maintenant ainsi l'incertitude des agents économiques à un niveau faible.
La déflation est une baisse des prix, donc le contraire de l'inflation. C'est un phénomène qui peut
être généralisé à l'économie ou particulier à un secteur économique volatil (p. ex. déflation du
marché immobilier), durable (parfois sur une décennie), autoentretenu, parce qu'il modifie les
anticipations des agents économiques. Comme le phénomène historiquement le plus fréquent (du
moins dans la période contemporaine) est bien l'inflation, on parle parfois aussi d'une inflation
négative.
La désinflation, quant à elle, est une baisse du taux d'inflation, qui reste positif. Par exemple, si
pendant des années l'inflation s'est située à 10 % en moyenne et que l'inflation des années suivantes
baisse à 7%, puis 5%, puis 2%, on parlera de phénomène désinflatoire. Lorsque l'inflation approche
de zéro, on risque un passage en déflation.
La stagflation consiste en la concommittance d'une croissance faible voire négative, avec un niveau
élevé d'inflation.
Augmentation durable de l'inflation [modifier]
L’inflation dépend en grande partie du comportement des agents économiques ; si les agents
anticipent que les prix vont augmenter, alors les prix risquent effectivement d'augmenter.
Les entreprises qui pensent que les coûts de production, dans lesquels rentrent les prix de
l'économie en général, vont augmenter, peuvent augmenter le prix de leurs produits pour se mettre à
l'abri de pertes éventuelles.
Comme le coût de changement des prix de vente (le « coût d'étiquette ») est assez élevé, les
entreprises ne peuvent pas modifier fréquemment leurs prix et sont obligées de se baser sur leurs
anticipations d'inflation qui sont incertaines.
Une hausse des prix importante mais de faible durée ne provoquera pas d'augmentation durable de
l'inflation car elle ne modifiera pas les anticipations des agents.

Conséquences [modifier]
En général, le salaire moyen augmente aussi vite, voire plus vite, que l'inflation[réf. nécessaire] ; les
salariés ne perdent donc pas en pouvoir d'achat. De même, les minima sociaux et les pensions de
retraite sont indexés sur l'inflation, et leurs pouvoirs d'achat ne diminuent pas.
Une inflation élevée est néfaste pour l'économie : elle induit des « coûts d'étiquette », mais surtout
modifie le comportement des agents économiques, pouvant entraîner une perte de confiance dans la
monnaie.
Une inflation élevée se répercute généralement sur les prix à la production de l'économie, et donc, à
taux de change constant, entraîne une baisse de la compétitivité-prix.
Théorie économique générale, inflation et monnaie [modifier]
Le développement suivant fait appel à l'équation d'Irving Fisher (avec M la masse monétaire, V la
vitesse de circulation de la monnaie, P le niveau des prix et T le nombre de transactions pendant une
période donnée).
La fonction principale de la monnaie est de permettre des transactions monétaires (par opposition au
troc). Trois paramètres fixent la quantité de monnaie nécessaire :
le nombre de transactions, lié aux biens de consommation échangés d'une part et aux actifs
d'autre part.
- Si la population échange deux fois plus de biens de consommation, par rapport à une situation de
référence, elle a besoin de deux fois plus de monnaie (à vitesse de circulation de la monnaie
constante) pour ce type de transaction. Compte tenu de la faiblesse du marché d'occasion des biens
de consommation, on peut approximer la mesure des échanges à la mesure de la production et donc
à la croissance économique.
- Si la population échange deux fois plus d'actifs, soit qu'elle en produise plus (investissement dans
des outils de production), soit qu'elle échange plus souvent le stock d'actifs existant (le stock de
maisons, d'actions, d'œuvres d'art circule de façon plus rapide), elle a besoin de deux fois plus de
monnaie (à vitesse de circulation de la monnaie constante) pour ce type de transaction.
la vitesse de circulation de la monnaie (si elle circule deux fois plus vite, on en a besoin de
deux fois moins pour faire les mêmes transactions). Ce paramètre est difficile à mesurer, et
en pratique on l'approxime par la quantité de transactions réalisées.
et bien sûr la valeur nominale de la monnaie (avec une monnaie deux fois mieux valorisée,
on a besoin de deux fois moins d’unité monétaire pour la même transaction). C'est sur ce
paramètre que joue l'inflation.
Comme la monnaie est l'étalon universel de valeur, sa valeur relative est fixe et toujours égale à un,
ce qui n'apporte aucune information sur la valeur « absolue » de la monnaie. Pour contourner la
difficulté et estimer la valeur de la monnaie, on utilise comme référence la valeur d’échange en
biens de consommation associée à cette même monnaie mais à une époque antérieure, et on
s'intéresse à sa variation relative (un pourcentage, positif lorsque l'ancienne monnaie avait une
valeur inférieure) : c'est l'inflation.
Par extension, on peut mesurer les variations de la valeur d'échange de la monnaie en actifs et
mesurer une inflation des prix des actifs.
On peut aussi utiliser comme référence un bien supposé stable (c’est-à-dire un bien dont le besoin,
ou la demande globale reste constant), comme l'or ou une devise étrangère réputée. L’essentiel étant
de pouvoir mesurer « ce que l’on peut obtenir avec telle quantité de monnaie ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%