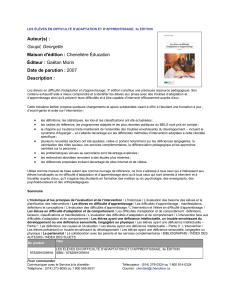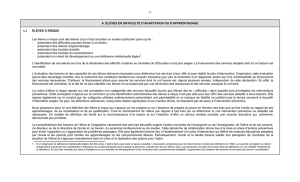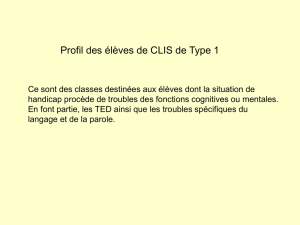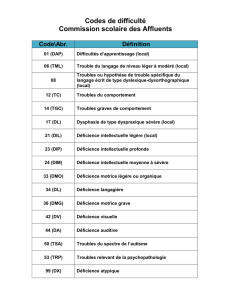Du professionnalisme de l`humain

Du professionnalisme de l’humain
L’engagement relationnel est une nécessité clinique et une posture sociopolitique.
Clinique, non pas au sens restreint de médical ou de psychologique mais au sens de la
considération singulière de la personne accompagnée, de la personnalisation de l’interaction
que le professionnel développe avec elle. Sociopolitique, non pas au sens politicien, idéologique
du terme, mais au sens où il n’y a pas d’interaction d’aide professionnelle (d’éducation avec les
enfants ou de soutien à l’autonomie avec les adultes) hors champ sociétal, sans considération de
la commande sociale qui l’autorise – la légitime pour la rendre opératoire - et en même temps
induit des représentations pour partie dissimulatrices des rapports de pouvoir et donc d’inégalité
au sein d’une société donnée.
Il importe donc, pour le professionnel du secteur social et médico-social, de former une
conception du sens clinique et sociopolitique de son action. C’est ce qui lui permet d’agir avec
conviction et de se situer éthiquement au regard des prescriptions de pratiques que comporte
l’exercice de la mission.
Fondements scientifiques du professionnalisme
Je voudrais tout d’abord rappeler les fondements scientifiques du professionnalisme en action
sociale et médico-sociale.
Tout exercice professionnel suppose une technicité, toute technicité repose sur des
connaissances scientifiques. La technicité du professionnalisme en action sociale et médico-
sociale repose sur les connaissances en sciences humaines.
Les sciences physiques (les sciences de l’objet) relèvent de la causalité et donc de la
prévisibilité du résultat. Les sciences humaines (les sciences du sujet) relèvent du registre de
l’interaction entre des sujets et donc de la probabilité des effets
1
.
L’interaction suppose la considération de motivations émanant de chacun des sujets pour
l’autre et une influence de chacun des sujets sur l’autre.
La probabilité repose sur la conscience d’une communauté humaine de motivations, d’une part
l’hypothèse de motivations du même ordre chez l’autre que chez moi, par analogie à ce que je vis,
et d’autre part l’expérience relationnelle de ce que l’autre m’apprend de semblable ou/et de
dissemblable dans ses motivations, à la fois singulières et du même ordre que les miennes.
Parce que je me vis comme sujet (certes conditionné par mon environnement physique et
social), parce que j’ai conscience d’agir à partir de mes motivations, d’une pensée qui m’est
propre, je suis aussi conscient que d’autres sujets (des entités de même statut ontologique que
moi) éprouvent des motivations singulières mais du même ordre. Je suppose donc chez l’autre des
effets du même ordre (et non pas un résultat prédéfini) à condition qu’il comprenne que je lui
reconnais des motivations propres bien que du même ordre, autrement dit que je m’adresse d’une
façon qui prenne sens pour lui à partir de ce qui est notre commune humanité.
1
« La méthode de convergence d’indices, typique de la logique de la probabilité subjective, donne une base
ferme à une science de l’individu digne du nom de science. » Paul Ricoeur, Du texte à l’action (Essais
d’herméneutique II), Le Seuil, Paris, 1998.

L’interaction humaine suppose donc d’une part la reconnaissance de la singularité de chaque
sujet et d’autre part la conscience d’une communauté de motivations, autrement dit le partage
d’affects suffisamment semblables. C’est d’abord en référence à moi-même, à mon rapport à
l’autre et au monde, que je comprends ce qui motive le comportement de l’autre dans l’interaction
d’aide. C’est ensuite par l’observation chez l’autre de son rapport au monde et aux autres que je
suppose ses motivations singulières et pourtant du même ordre que les miennes.
Penser l’accompagnement des personnes dans le cadre du secteur social et médico-social a
priori sur le mode de la distanciation désaffectivée n’a donc aucun sens.
Distance il y a puisque la relation suppose la différenciation de soi et de l’autre.
Affects il y a puisque la prestation délivrée l’est par un professionnel à une personne,
autrement dit concerne deux sujets.
C’est le professionnalisme qui crée la distance signifiante et opératoire parce que formulée
dans un cadre symbolique, autrement dit en référence à un ensemble de représentations
partagées – ce qui constitue une société. Le professionnalisme est une opération technique
constituée par un ensemble d’objets (pratiques, procédures, gestes homologués, connaissances
scientifiques, rôles, modalités de collaboration interprofessionnelle, programmes, etc.) qui font tiers
dans l’intersubjectivité relationnelle, en soutiennent la validité et l’efficience.
Il faut dépasser une pensée qui oppose les termes (engagement/distance,
objectivité/subjectivité), pour soutenir une pensée qui les articule non seulement en
complémentarité mais aussi en tension : il n’y a de professionnalisme en action sociale et médico-
sociale que relationnel, donc engagé, et agissant dans un faire ensemble avec la personne
accompagnée, médiatisé par des objets.
Evidemment l’engagement relationnel comporte un risque. Mais c’est le propre de l’existence.
Ce risque est nécessité vitale.
Ce qu’on appelle la bonne distance relationnelle ne se prédétermine ni ne se mesure, elle
n’est juste d’une part que parce qu’elle ne relève pas de mon arbitraire, d’une prétention solipsiste
de savoir comment agir, mais du mandatement par la mission, l’organisation de travail, l’équipe
d’appartenance, d’autre part parce qu’elle est analysée dans ses éventuelles projections. Ces
projections sont non seulement inévitables mais aussi nécessaires pour peu que je les
reconnaisse comme tâtonnements relationnels, que je ne me conforte ni ne m’isole dans une
position surplombante qui attribuerait l’essentiel des affects et contre attitudes à la personne
accompagnée.
Tout professionnel disposant de l’étayage d’une équipe et d’instances d’analyse de ses
projections décèle intuitivement en situation - intimement - à quel moment « il va trop loin » dans
l’intensité de la relation, à quel moment les sentiments éprouvés à l’égard de la personne et les
attitudes adoptées à son égard relèvent plus d’une satisfaction personnelle – d’une envie pour ce
que cela satisfait en moi - que d’une utilité pour la personne.
Motivation et objectif
L’engagement relationnel suppose de fonder l’action auprès d’une personne non sur la notion
de causalité supposant un résultat prédéfini mais sur la notion d’interaction supposant une double
motivation, la probabilité d’effets et la conception d’objectifs comme des leviers.
La notion d’interaction implique de raisonner à partir des besoins et attentes de la personne,
autrement dit de sa motivation. La poursuite d’un objectif avec une personne suppose que cet

objectif la motive. Le professionnel ne crée pas cette motivation, elle surgit à l’articulation d’une
opportunité, d’une proposition qu’il formule et d’une attente préexistante supposant un besoin, un
désir de fondamental chez la personne. On ne mobilise une personne qu’en lui offrant une raison
d’agir, autrement dit un motif qui prend sens dans son existence. « La perspective selon laquelle la
stimulation précéderait la motivation relève d’une conception objectale qui dénie l’existence du
sujet comme être de conscience et d’intention. Elle suppose que certains êtres n’existent que par
le regard qu’on porte sur eux, la parole qu’on tient sur eux, l’action qu’on mène sur eux. »
2
Le
préalable d’une motivation chez la personne accompagnée repose sur la conscience de soi telle
que précédemment évoquée : j’éprouve l’évidence d’une existence de l’autre comme sujet
indépendant par analogie à la conscience que j’ai de ma propre existence
3
.
La notion d’interaction reposant sur une double motivation, celle du professionnel et celle de la
personne, implique de concevoir l’objectif partagé non comme une visée en soi mais comme
l’effort porté un temps donné sur une nécessité, un besoin, une attente, dont la résolution produira
une pluralité d’effets sur le développement ou l’existence de la personne. Dans le domaine de
l’humain, un objectif est la focalisation sur un aspect névralgique de l’existence d’une personne, un
levier producteur de changement et non la formulation d’un résultat prédéfini. Il n’a d’autre intérêt
que de supposer son atteinte comme la condition d’un mieux être de la personne.
Ce primat accordé à la motivation de la personne implique un engagement relationnel du
professionnel, un engagement qui projette la personne dans l’intérêt qu’il y a pour elle de
développer cet effort. Je ne trouve en moi de puissantes raisons d’agir que parce que des êtres
d’importance à mes yeux me manifestent leur attente à mon égard, me renvoient une image de
moi qui suscite leur intérêt, le fait que j’ai de l’intérêt pour eux, de l’importance dans leur existence.
Désaffectivée, la relation d’un professionnel à l’égard d’une personne accompagnée ne lui offre
pas l’opportunité susceptible de former la motivation préalable au changement.
Dimension sociopolitique de la rationalisation des actes
Je fais l’hypothèse que le discours sur la distance à tenir avec l’usager au nom de la technicité
professionnelle relève d’un processus de rationalisation des actes en matière d’action sociale. La
question du financement de la protection sociale est sous-jacente à ce processus de rationalisation
en cours. La structure économique de nos sociétés développées est aujourd’hui telle qu’elle prive
de travail une partie de plus en plus significative de la population et, avec l’allongement de la vie,
voit croître de façon exponentielle la couverture des besoins liés à l’avancée en âge.
L’explosion des inégalités de revenus, la précarisation d’une partie de la population,
augmentent continument le nombre des personnes requérant un accompagnement social. La
rationalisation des actes en action sociale est la conséquence logique de cette massification, elle
vise à contenir le volume de cet accompagnement en mécanisant les actes qui le composent au
travers de procédures et de pratiques contingentées.
De même que, conjointement au discours relatif à l’égalité des droits, à l’accessibilité et à
l’inclusion, se développe un processus d’inégalisation des ressources, de même, conjointement au
discours éthique relatif à la personnalisation de l’accompagnement, se développe une orientation
qui consiste à penser les populations en flux, les dépenses en volume, et la réponse aux besoins
en actes normés, rationalisation impliquant une distance relationnelle économe en temps dédié à
2
Le professionnalisme en action sociale et médico-sociale, Bertrand Dubreuil, Dunod 2009.
3
Cf. Soi-même comme un autre, Paul Ricoeur, Le Seuil, Paris, 1990.

la personne parce que dénué d’engagement personnel. Cette rationalisation de l’action sociale
écarte le questionnement sur l’origine de la difficulté rencontrée par la personne, sur le processus
d’exclusion en jeu, dénie la perspective d’un travail social promotionnel en ce qu’il comporte une
dimension politique, une interpellation sociale sur le processus actuel d’inégalisation
socioéconomique.
La question sociale sous-jacente
Pour illustrer la double dimension clinique et sociopolitique de l’engagement relationnel, je
voudrais évoquer une expérience de dépistage et d’accompagnement précoce de la déficience
intellectuelle légère, entreprise par le SESSAD de l’association Claire-Joie à Saint-Benoît de la
Réunion.
4
Il s’agit d’une initiative visant à compenser un déficit émergent, non identifié par le dispositif
social et médico-social et souvent non signalé par l’école par crainte de stigmatisation engageant
l’enfant dans un processus de filiérisation. La dimension sociopolitique de la déficience
intellectuelle légère est particulièrement flagrante car, à la différence d’une déficience d’origine
organique, son étiologie est attribuée à un environnement social et plus particulièrement à un
environnement socio-familial. Plus ou moins explicitement la cause de la difficulté de l’enfant est
considérée comme consécutive au comportement de ses parents.
Or en même temps, les textes légaux et les pratiques professionnelles soutiennent la
nécessaire collaboration avec les parents pour traiter précocement la difficulté de l’enfant. Mais
comment établir une collaboration avec ceux qu’on pense à l’origine de cette difficulté et donc
susceptibles de continuer de l’entretenir ? Comment construire une réponse sur un mode co-
éducatif, qui suppose une horizontalité d’interaction et non une vision surplombante, invalidante
des parents et donc de leurs ressources ? Comment ne pas s’enfermer soit dans une vision
assistantielle de leur condition ou une vision caritative qui les mette en dépendance d’un altruisme,
soit dans une vision savante qui les considère incapables de contribuer au traitement du
problème ? Quelle conception avoir de l’étiologie de la déficience légère en milieu défavorisé, une
conception pertinente dans l’état des connaissances, sans rendre pas les parents responsables de
la difficulté de leur enfant ?
Dans une étude préalable
5
relative aux enfants concernés par le dépistage précoce de la
déficience intellectuelle légère, les professionnels observaient que les enfants relevaient
essentiellement de milieux familiaux marqués par la précarité socio-économique. Ils référaient
cette donnée aux conclusions de recherches plus larges sur la relation entre inégalités socio-
économiques et inégalités de santé
6
.
Il apparaît également dans différents travaux que la déficience intellectuelle légère rend sans
doute possible l’acquisition du langage et de nombreuses aptitudes mais seulement à un niveau
concret. Assez commune, cette observation ne s’interroge pas sur la différenciation entre
intelligence concrète et capacité d’abstraction. Ne devons-nous pas toujours passer par
4
Financement par l’Agence régionale de santé d’un dispositif expérimental visant à la « Reconnaissance du
besoin de diagnostic précoce pour les enfants qui présentent des difficultés scolaires en petite et moyenne
section de maternelle ».
5
Etude de population, Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile pour enfants et adolescents
Déficients Intellectuels (SESSAD DI), Association Claire-Joie, IBANEZ-CEJUELA Emmanuel
6
Leclerc A., Fassin D., Grandjean H., Kaminski M., Lang T. (dir), « Les inégalités sociales de santé », Paris,
La découverte, Inserm, 2000, 448 p.

l’expérience d’une situation pour généraliser ensuite à un ensemble de situations, passer par un
support concret pour constituer des généralités abstraites ? Ce qui pose la question des supports
concrets employés dans la didactique scolaire : sont-ils aussi « concrets » pour les enfants des
milieux dits populaires ou défavorisés que pour les enfants des milieux sociaux accédant à une
diversité d’expériences sociales qui les familiarisent aux références dominantes d’une société
donnée ?
Nous sommes tellement imprégnés du présupposé de la scientificité des échelles
d’intelligence que nous en oublions le caractère normatif, construit et naturalisé, notamment ce
clivage entre le concret et l’abstrait que nous ne nous représentons plus comme un continuum
opératoire mais comme deux formes d’intelligence attribuées plus ou moins aux individus en
fonction de leur classe sociale. Nous oublions que la capacité de construire des généralités par
abstraction est nourrie par les modes d’expérience qui structurent les apprentissages notamment
scolaires, modes d’expériences auxquels nous sommes plus ou moins bien préparés par nos
milieux socio-familiaux.
Les travaux de Bernard Charlot, Elisabeth Bauthier et Jean-Yves Rochex
7
sur le rapport au
savoir des jeunes de milieux populaires ont montré que les difficultés d’apprentissage scolaires de
nombre de ces derniers ne relevaient pas d’une intelligence moindre ou d’une incapacité à
abstraire et généraliser mais du fait que les apprentissages auxquels ils étaient confrontés ne
prenaient pas sens pour eux, ne s’inscrivaient pas dans leur rapport à leur réalité sociale et donc
existentielle.
Il y a en en effet tout lieu de penser que les savoirs scolaires et les modalités didactiques de
leur enseignement participent du phénomène de distinction mis en lumière par Pierre Bourdieu :
les milieux favorisés constituent des pratiques et des références culturelles pour se distinguer des
milieux moins favorisés, notamment dans la compétition scolaire en ce qu’elle est la porte d’entrée
aux positions sociales.
Autrement dit, la sur-représentation des enfants de milieux défavorisés dans le public déficient
intellectuel léger ne serait pas liée à la pauvreté culturelle d’un milieu mais à un rapport entre un
environnement de développement - l’environnement socio-familial – et un environnement
d’apprentissage normé - l’environnement scolaire – qui comporte des références et des exigences
plus ou moins familières aux enfants selon leur milieu social d’origine.
Les professionnels au contact des enfants concernés sont témoins de ce décalage entre
l’environnement socio-familial et l’environnement scolaire. Mais celui-ci reste attribué à la pauvreté
culturelle d’un milieu social, et tout particulièrement du milieu familial. Le risque est de s’enfermer
dans un jugement moral sur les conduites de ce milieu, au moins dans une position de supériorité
explicative sur ce milieu, invalidant alors toute visée co-éducative avec les parents bien que
l’énonçant comme la condition pour aider l’enfant dans ses difficultés. Le risque est aussi à
l’inverse d’attribuer la déficience à la seule condition sociale, basculant alors dans un discours
idéologique sur l’inégalité socioéconomique qui confine à l’impuissance professionnelle devant le
poids du conditionnement social. Sachant par ailleurs que l’attribution de la déficience à la seule
condition sociale fait l’impasse sur le fait que tous les enfants de milieux défavorisés ne deviennent
pas déficients intellectuels.
7
Bernard Charlot, Elisabeth Bautier, Jean-Yves Rochex, Ecole et savoir dans les banlieues... et ailleurs,
Paris, Armand Colin, 1993. Le Rapport au Savoir en milieu populaire, Une recherche dans les lycées
professionnels de banlieue, Anthropos 1999, Bernard Charlot.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%