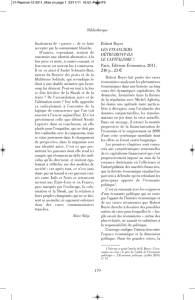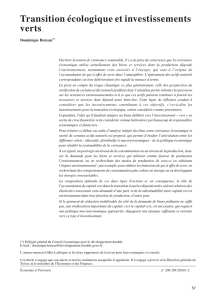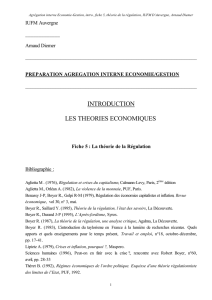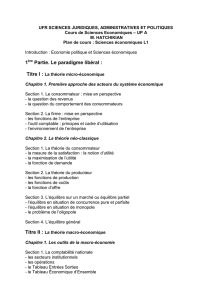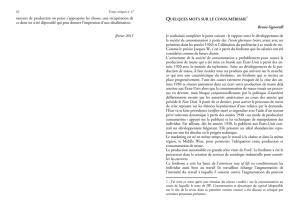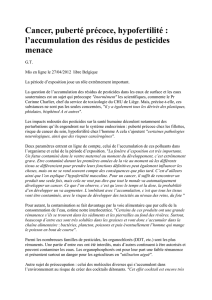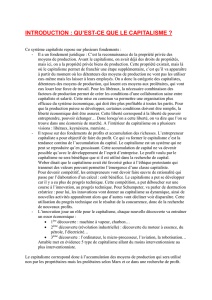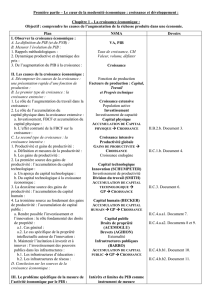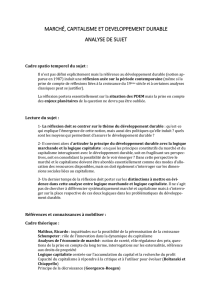La difficulté à nommer le nouveau régime de croissance.

1
La difficulté à nommer le nouveau régime de croissance.
Un difficile adieu à la référence du fordisme
CEPN/MSHPN
Mickaël Clévenot
Résumé : La théorie de la régulation s’est intéressée de près à la croissance améri-
caine des années 1990. Elle a cru y déceler un successeur au fordisme mais l’ensemble de ses
représentants n’était pas d’accord sur l’idée que l’économie américaine aurait présentée
toutes les caractéristiques nécessaires. Cette divergence de point de vue est apparue comme
une opportunité pour comprendre précisément ce que les différents auteurs plaçaient der-
rière le concept de régime de croissance. Il nous est apparu que ces divergences portaient es-
sentiellement sur les phases de développement à laquelle les auteurs régulationnistes se réfé-
raient implicitement : TR1, TR2 et TR3. Ce papier donnera lieu à un éclaircissement sur ces
différences grâce à l’analyse du régime de croissance américaine. Dans une première partie,
on présentera les éléments qui sont favorables à l’existence d’un régime de croissance domi-
né par la finance. Dans la seconde partie, nous évoquerons les facteurs limitatifs ou défavo-
rables à son existence. Dans la troisième partie, on reviendra sur sa petite crise de gouver-
nance et sa régulation. Fort de ces éléments, on tentera de tirer quelques enseignements sur
la TR.
Mots clés : Théorie de la régulation, régime d’accumulation, mode de régulation, financiarisation,
régime vertueux/régime excluant.
Abstract : The American growth of the 1990’s has aroused the interested of the Regulation The-
ory. This theory at first was convinced to be in presence of the rightful successor of the fordism
regime but not all authors of this school agreed because the American economy would not, for
some of them, present all the necessary characteristics. This divergence of appreciation appears to
be an opportunity to assess the concept of growth pattern of the various authors of the Regula-
tion School. It appeared to us that these divergences related primarily to the phases of develop-
ment to which the regulationnists authors referred implicitly: TR1, TR2 and TR3. This paper will
give place to an explanation on these differences thanks to the analysis of the mode of American
growth. In a first part, one will present the elements which are favorable to the existence of a
mode of growth dominated by finance. In the second part, we will evoke the restrictive or unfa-
vourable factors with its existence. In the third part, one will reconsider his small governance cri-
sis and his regulation. Extremely of these elements, one will try to learn some lessons on the TR.
Keywords : Regulation Theory, accumulation regime, regulation pattern, financializa-
tion, excluding/virtuous regime

2
Les fondateurs de la Théorie de la Régulation (TR) après avoir largement admis
l’existence du fordisme ont connu des difficultés pour s’accorder sur l’existence aux États-Unis
d’un régime de croissance dominé par la finance (M. Aglietta [1998, 2000] et R. Boyer [2000]). Si
les positions semblent s’être rapprochées (M. Aglietta et A. Rebérioux [2004]), ce rapprochement
a été réalisé sur la base de l’absence d’un mode de régulation alors même que les crises succes-
sives qui s’y sont produites (2001, Enron) n’ont pas entraînées de transformations institution-
nelles majeures (Sarbanne-Oxley). Situation qui marque donc la présence de régulations robustes
tendant à démontrer l’existence même de ce régime. Dès lors, comment interpréter la difficulté
qu’ont R. Boyer et M. Aglietta à identifier le nouveau régime de croissance Outre Atlantique ?
Nous entendons par régime de croissance l’adéquation provisoire mais effective entre un
régime d’accumulation et un mode de régulation. Le régime dominé par la finance aux Etats-Unis
constitue un régime de croissance comme nous allons nous efforcer de le montrer car le régime
d’accumulation bien que déséquilibré n’en est pas moins régulé par divers procédures institution-
nelles marquant la dominance du pouvoir financier. Dès lors, on tentera de saisir les raisons pour
lesquelles il semble si difficile de nommer le nouveau mode de croissance.
L’impossibilité à nommer le nouveau mode de croissance parait ressortir simultanément à
des éléments normatifs et théoriques. Les éléments normatifs concernent la nature excluante du
régime dominé par la finance. Ces considérations normatives ont des implications théoriques, la
plus importantes consistant à retarder l’avènement de la nouvelle phase des travaux régulation-
nistes résumée sous le terme de TR3. Les éléments théoriques résident dans l’incapacité des con-
cepts qui ont permis d’identifier la diversité du Capitalisme (TR2) à repérer les innovations insti-
tutionnelles que représente le nouveau régime. Cette innovation institutionnelle majeure réside
dans la subordination du rapport salarial acceptée dans le cadre de TR3. Cet élargissement analy-
tique est contrarié par des considérations normatives. S’il est possible de voir se maintenir un ré-
gime de croissance avec un rapport salarial comme variable d’ajustement du régime, le régime ne
peut plus posséder les vertus de cohésion sociale du fordisme.
Dans une première partie on présentera les éléments qui sont favorables à l’existence d’un
régime de croissance dominé par la finance. Dans la seconde partie nous évoquerons les facteurs
limitatifs ou défavorables à son existence. Dans la troisième partie on reviendra sur sa petite crise
de sa gouvernance et sa régulation. Fort de ces éléments on tentera de tirer quelques enseigne-
ments sur la TR. Avant d’entrer dans le cœur de la question nous rappelons les définitions respec-
tives de TR1, TR2 et TR3.

3
Le courant régulationniste en France existe depuis les années 1970. Le travail de référence
est constitué par l’ouvrage de M. Aglietta Crise et régulation du capitalisme (1976). On peut définir les
trois phases de la TR à travers trois questions qui ont structurées ces travaux. La première aura
été comment la période des « trente glorieuses » a pu exister alors que le Capitalisme est censé al-
ler de crise en crise s’accompagnant d’une paupérisation croissante de la population devant con-
duire à la crise finale ? Aussi, la question posée par la TR n’aura pas été pourquoi la crise, mais
pourquoi la stabilité avant la crise (A. Lipietz [1995]) ?
La seconde question aura pu être comment des pays dont les histoires sociales et poli-
tiques différentes peuvent néanmoins disposer du même régime d’accumulation ? La troisième
question est construire sur la surprise générée par le maintien d’une croissance forte et stable aux
Etats-Unis alors que la finance semble occuper une place prépondérante dans l’économie et que
celle-ci est historiquement associée à une instabilité structurale ? Autrement dit, comment la fi-
nance est susceptible de générer un mode de régulation capable de canaliser les contradictions du
régime d’accumulation ?
Ainsi TR1 s’appuie sur des travaux de macroéconomie appliquée pour souligner
l’enchâssement des relations économiques, le régime d’accumulation, dans des relations institu-
tionnalisées, le mode de régulation qui permet de réguler l’instabilité produite par le fonctionne-
ment du capitalisme. Avec TR2, on se rend compte qu’il peut exister des pays dont les régimes
d’accumulation sont proches mais dont les modes de régulation peuvent être nettement diffé-
rents. Enfin TR3 renforce l’importance du mode de régulation dans le régime de croissance. Mal-
gré l’existence de déséquilibre au niveau du régime d’accumulation, le mode de régulation peu
surcompensé ces contradictions. Nous préciserons dans les sections suivantes, les conditions
économiques qui permettent au mode de régulation de surplomber les relations économiques, car
si pour l’usage théorique, il est utile de diviser ces deux notions dans la réalité des relations éco-
nomiques, elles sont lovées les unes dans les autres. En résumé, la TR qui constitue à sa naissance
une rupture vis-à-vis du structuralisme (A. Lipietz [1995]) tend à travers le temps à affirmer la
dimension idéelle des rapports sociaux. Cette articulation entre le mode des idées et objets maté-
riels dont la séparation est également difficile à réaliser (M. Godelier [1984]) constitue le pro-
gramme de recherche de TR3. Quel est le rôle des idées, des représentations dans la stabilité ou la
dynamique des institutions dans la diversité du Capitalisme.
Section 1. Les cohérences du régime de croissance financiarisé.
Jusqu’à la seconde moitié des années 1990, la théorie de la régulation n’aurait pas trouvé
de « digne » successeur au fordisme. L’adjectif est important car il a une connotation normative
forte. Cette dérive entre la dimension analytique et politique dans la critique adressée à la TR à
produit deux effets contradictoires, mais c’est le second qui l’a finalement emporté. Le premier a
poussé M. Aglietta à surestimer la cohésion sociale générée par le nouveau régime de croissance
dominé par la finance (1998). Au contraire, R. Boyer a eu tendance à sous-estime le pouvoir de
régulation générer par le mode de régulation induit par la domination financière. Dans les deux
cas, on manque le retour de la capacité du capitalisme à produire de plus en plus de richesse tout
en suscitant de plus en d’inégalité.
Donner même succinctement une idée du climat intellectuel et politique du début du
XXIe siècle paraît important pour comprendre les difficultés auxquelles doit faire face la Théorie
de la Régulation. La concurrence avec les économistes standards est extrêmement rude dans la
mesure où ces derniers au nom de la Science s’autorisent à livrer clé en main des solutions aux
problèmes économiques et sociaux alors même qu’au nom de cette même science la TR s’interdit

4
de prescrire, soulignant simplement les incohérences et les contradictions qui entravent la crois-
sance. Dans ce contexte, en 1998 lorsque M. Aglietta décrit les fondements du capitalisme patri-
monial à partir de l’observation des Etats-Unis, on a l’impression que ce modèle amendé ou pas
va devoir s’imposer aux autres pays y compris la France. Or les institutions sous-jacentes au nou-
veau régime sont très différentes de celles héritées de la période fordienne. Ainsi, l’enjeu politique
derrière l’enjeu théorique de l’existence ou non d’un régime d’accumulation a été et est toujours
de voir réaliser l’application de ce régime en France. D’ailleurs certains éléments de la politique du
nouveau gouvernement français actuel ont eu tendance à aller dans ce sens (réforme des retraites,
crédit hypothécaire, réduction des impôts sur les gains en capital, etc.).
1.1. Les cohérences du régime d’accumulation patrimonial
M. Aglietta est l’auteur régulationniste qui a avancé le premier l’idée d’un régime
d’accumulation intensif fondé sur la finance (1998). Dans cette nouvelle configuration, la finance
semble jouer un rôle majeur. L’actionnariat se « démocratise » par le développement des stocks
options et des retraites par capitalisation. Les ménages voient leur patrimoine financier s’accroître
grâce à la hausse des titres détenus. L’effet richesse les incite à consommer. La consommation tire
l’emploi. Les bonnes perspectives sur les marchés financiers soutiennent également la consom-
mation des agents non détenteurs d’actifs qui associent la flambée financière à la prospérité réelle
de l’économie. Le cercle vertueux, consommation, emploi, croissance est enclenché, autorisant la
validation ex post de la convention haussière qui anime les marchés financiers. Du côté de l’offre,
l’investissement est tiré par la consommation ainsi que par le renouvellement des équipements
entraîné par les technologies de l’information et de la communication favorisé par l’engouement
financier et la réduction de leur prix. D’importants effets richesses semblent influencer la con-
sommation des ménages tandis que des effets de levier financier paraissent doper
l’investissement. Ainsi de nombreuses transformations tant financières que réelles devaient per-
mettre à l’économie américaine de renouer avec une croissance soutenue. Néanmoins pour iden-
tifier un régime de croissance, il faut simultanément la stabilité d’un régime d’accumulation et
l’émergence de cohérences institutionnelles qui permettent au régime de se maintenir sur
moyenne période, tel que décrits par l’ensemble des premiers travaux régulationnistes (TR1).
L’un des éléments majeurs du nouveau régime reposerait sur une inversion institution-
nelle : le rapport salarial dominant durant le régime fordien est désormais subordonné aux exi-
gences financières de la valeur actionnariale ce qui constitue une innovation tant du point de vue
des institutions que de l’analyse des institutions réalisée par la TR qui nous place dans la troi-
sième phase du programme de recherche (TR3). Dans ce cadre, de nouvelles modalités de rému-
nération sont mises en place : stock-options, modification de la protection sociale avec le déver-
sement des systèmes d’épargne retraite à prestation définie vers des systèmes à cotisation définie
gérés en capitalisation.
La démocratisation de l’accès aux marchés financiers pour les ménages constitue un élé-
ment important pour établir de nouvelles cohérences. Le second élément consiste en
l’émergence d’une « convention Internet ». Elle se traduit par des niveaux de rentabilité finan-
cière élevés et réguliers autour de 15%. Le bouclage macroéconomique du régime
d’accumulation financier reposerait ainsi sur la formation d’une convention financière qui a été
favorisée par la montée en puissance des investisseurs institutionnels dont la demande de titres
entretient la dynamique haussière. La consommation des ménages est poussées par les subsides
financiers : gains en capital, dividendes et de plus values latentes. Les entreprises accroissent
leurs investissements particulièrement dans les TIC, par endettement en raison de puissant effet
de levier financier. La faiblesse de l’inflation malgré l’ampleur de la croissance indique que le ré-
gime ne repose pas exclusivement sur une dynamique financière. La globalisation accroît la con-
currence et la pression financière sur les entreprises ce qui conduit à une discipline importantes

5
sur les coûts de production. Le nouveau cadre institutionnel est cohérent avec le nouveau régime
d’accumulation. C’est cette dynamique qui incitait M. Aglietta à parler d’un régime de croissance
patrimonial. Une des hypothèque majeure pesant sur le régime réside dans la dimension conven-
tionnelle de la dynamique financière. Le régime pour exister pleinement devra être en mesure de
dépasser cette difficulté. Avec les travaux de J.F. Vidal, on confirme la présence d’un régime
d’accumulation dominé par une dimension intensive dans la pure tradition des travaux (TR1) de
macroéconomie appliquée.
1.2. Le retour d’un régime d’accumulation intensif
L’existence d’un régime d’accumulation intensif repose sur la pérennité de la hausse
des gains de productivité et un niveau de demande adéquat. J-F. Vidal (2003) parvient à identi-
fier la « nouvelle économie » dans lignée traditionnelle de travaux de macroéconomie appli-
quée dans la filiation des travaux originels de la TR (CEPREMAP-CORDES [1977]). J-F. Vi-
dal décrit les évolutions macroéconomiques des États-Unis en passant de la crise du fordisme
à l’entrée dans une phase de mutation qui va conduire à l’avènement d’un régime
d’accumulation extensif au début des années quatre-vingt (R. Boyer et M. Juillard [1995]), puis
au milieu des années quatre-vingt-dix, on retrouverait un régime intensif.
Dans l’analyse de la crise fordienne J-F. Vidal fixe son attention sur la baisse des gains
de productivité du travail provoquée par une substitution trop importante du capital au travail
: « L’économie américaine a donc suivi les régimes de croissance suivants : un régime
d’accumulation intensive de type fordiste jusqu’en 1966. De 1966 à 1982, la crise du fordisme
l’a entraînée dans une trajectoire marxienne. De 1982 à 1992, elle a suivi un régime de crois-
sance extensif cohérent, avec faible gain de productivité du travail, une faible substitution du
capital au travail, et la stagnation du salaire réel. Au cours des années 1990, la croissance est
redevenue intensive selon la chronologie suivante : à partir de 1992, il y a eu une forte hausse
du taux d’accumulation et de la substitution du capital au travail, alimentée par une demande
soutenue, par la baisse du prix réel des biens capitaux, et peut-être par la bulle spéculative ; à
partir de 1995, il y a une accélération des gains de productivité du travail ; à partir de 1997, les
salaires réels ont recommencé à augmenter, grâce à la raréfaction de la main-d’œuvre » J-F. Vi-
dal (2003). Le passage du régime extensif, qui existe depuis le début des années 1980, à un ré-
gime intensif résulterait d’un choc d’offre exogène. L’intensification du capital par tête consti-
tue une marque essentielle de l’émergence d’un régime intensif, car le capital par tête est
l’élément fondamental sur lequel repose la productivité apparente du travail : « La baisse de
Pk/Py ouvre une voie à une intensification de l’accumulation, car elle autorise une baisse de la
productivité du capital en volume, et donc une substitution du capital au travail plus élevée
que le progrès technique au sens de Harrod, sans que le taux de profit chute. L’accélération
des gains de productivité du travail aux États-Unis au cours des années 1990 peut être inter-
prétée ainsi comme un retour à un régime d’accumulation intensif, fondé sur les NTIC et sur
la baisse du prix des biens capitaux » (ibid, p.7).
Le second élément consiste à établir les fondements de la consommation. L’élément prin-
cipal est constitué par les revenus d’origine salariale. De ce côté, les États-Unis ont l’image d’une
répartition des revenus relativement stable à travers le temps. Cet élément est important car il est
censé donner un indice de l’existence d’un mode de régulation ; la stabilité de la répartition impli-
quant une stabilité institutionnelle. Cette stabilité peut sembler surprenante si on prend au sérieux
l’assertion d’une inversion du rapport institutionnel en faveur des revenus du capital. Les revenus
d’origine salariale devraient diminuer ? « Aux États-Unis, il [le partage salaires-profits] reste stable
à long terme, et ses variations de court terme sont limitées, ce qui montre que la régulation des
salaires y a été efficace […] On remarque aussi que les points des années 1981 à 1995 se situent
" plus bas " pour un même taux de chômage. Ceci suggère que pendant cette période, les poli-
tiques libérales ont déplacé vers le bas la courbe de Phillips […] Mais il faut souligner que le par-
tage salaires-profits est resté pratiquement stable aux États-Unis entre 1973 et 1976, lors du pre-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%