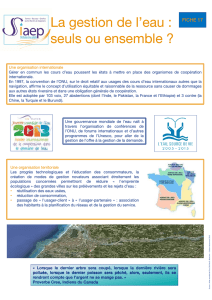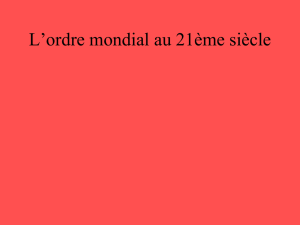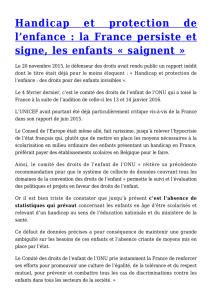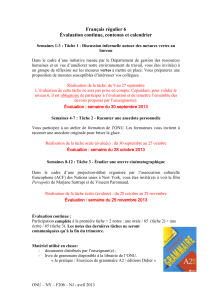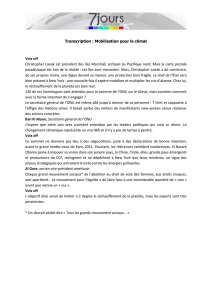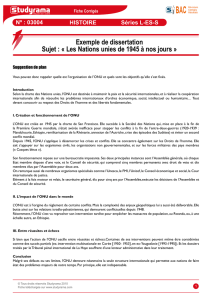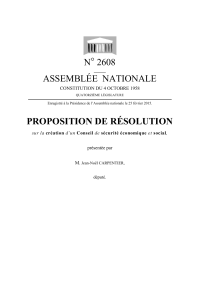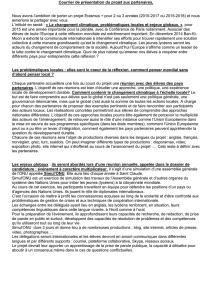l`onu gouverne-t-elle le monde

Thierry.brugvin@free.fr
1
L’ONU GOUVERNE-T-ELLE LE MONDE ?
Introduction
La mondialisation actuelle se développe mais, dans la régulation du travail (les
relations professionnelles), quel est l’acteur le plus puissant actuellement? Est-ce les
Etats, les organisations internationales publiques (OIP), les entreprises transnationales
(ETN), le pouvoir militaire, la société civile, les mouvements sociaux internationaux ou
encore l’opinion publique? La question, à laquelle cherchent à répondre les différentes
théories qui portent sur ce thème, concerne en particulier le problème de la puissance.
La mondialisation néo-libérale entraîne un vent de contestation croissant. Pour l'apaiser
les dirigeants des organisations internationales publiques, telle l’ONU, l’OMC ou la Banque
Mondiale proposent de développer une bonne gouvernance, fondée sur le consensus de
Washington, qui s’avère une gouvernance néo-libérale.
Le réalisme
Jusqu’au début des années 80, la théorie dominante chez les spécialistes des relations
internationales était le réalisme. Il se base sur l’idée que les Etats sont les acteurs les plus
puissants et qu’ils ont comme but premier, de servir leurs propres intérêts, même si c’est au
détriment des autres.
Les deux principes de cette école de pensée, sont la souveraineté et la territorialité. L'Etat
est souverain sur son territoire, "c'est le seul principe d'ordre pour la scène internationale"
(Badie 1997 : 48).
Mais cette vision, bien que n'ayant pas disparue, constate à l'évidence que cette
souveraineté est mise à mal, du fait de l'intégration économique internationale, de la division
internationale du travail, de l'émergence de nouveaux acteurs non-étatique et du rôle
croissant des institutions supranationales telle l’ONU.
Le néo-realisme
A partir des années 80, un autre courant va émerger, le néoréalisme. C’est l’approche qui
domine aujourd’hui chez la plupart des élites politiques mondiales. L’économie et la
technique, sont considérées comme des éléments de plus en plus prégnant et qui viennent
limités les marges de manoeuvres des Etats. Mais cette vision du monde reste réaliste, car les
Etats sont toujours considéré comme les maitres du jeu, même si à présent les institutions
internationales qu’ils dominent viennent complexifier les jeux de pouvoirs.
Pour les néoréalistes la direction politique du monde ne peut être fait que par les Etats.
L’Etat dominant, actuellement les Etats Unis, exerce ses qualités de “leadership”, c’est ce
que l’on appelle la théorie de la stabilité hégémonique.
Les néo-réalistes ont bien conscience que de nouveaux acteurs viennent attaquer la
souveraineté des Etats, c'est pourquoi il vont développer une perspective institutionnelle,
(école néo-institutionnaliste) qui reporte en partit le pouvoir des Etats au sein des institutions
inter-étatiques et des régimes internationaux.
1
Docteur en sociologie, Largotec, auteur du livre Les mouvements sociaux face au commerce éthique,
Hermès/Lavoisier, 2007.

Ainsi si on considère souvent que les plus puissantes ETN, exercent une domination
croissante sur le monde, c’est selon les néoréalistes, surtout parce que les Etats
(particulièrement le G8) ont décidé ensemble de libéraliser l’économie mondiale, au travers
des institutions internationales (ONU, BM, FMI, OMC). De cette manière ils se sont
volontairement départie de leur pouvoir. Il ne tient donc qu’à eux de le reprendre.
Les théories néo-libérales
A la différence des théories néo-réalistes qui attribuent aux conflits de puissance entre
Etats le rôle explicatif dominant et des marxistes qui centre leur approche sur les conflits
d’intérêts entre classes, les théoriciens néo-libéraux centre leur approche sur la convergence
d’intérêts individuels plutôt que de conflits (Graz 2000: 359-360)
2
. Les marxistes et les néo-
libéraux ont en commun cette vision : ils considèrent que les entreprises transnationales
disposent du pouvoir dominant au plan international.
Le réalisme critique
Strange remet en cause la théorie néoréaliste, notamment avec le concept d’autorité, en
considérant que les Etats, ne sont pas les seuls à en disposer (Tooze 2001)
3
. Susan Strange
conteste une vision hégémonique des Etats tel qu’elle est élaborée par les néo-réalistes. Cela
ne signifie par pour autant que ceux ci non plus de pouvoir, mais qu’il existe certaines zones
qui leur échappent, notamment la finance internationale. Selon elle aucun autre acteur
n’aurait d’ailleurs le pouvoir de maîtriser cette évolution (Tooze 2001).
Si elle considère que les Etats, non plus le monopole du pouvoir, elle estime néanmoins
que certaines nations peuvent exercer un leadership mondial, notamment les Etats Unis.
(Strange 1987).
4
Certains réseaux tel la finance, ou la production de connaissance, issus des
Etats Unis prennent ainsi une dimension hégémonique dans le monde.
Le matérialisme historique transnational (le néo-gramscisme)
Il y a différentes théories de la stabilité hégémonique. Pour les théories réalistes,
l’hégémonie correspond à la puissance et la domination des Etats au plan économique,
politique et militaire. Tandis que pour les théories néo-gramsciennes: l’hégémonie relève de
la domination l’idéologique et politique qui prend sa source dans la société civile.
Dans le sens commun l’hégémonie désigne la domination souveraine, l’autorité, la
suprématie du pouvoir. Si Gramsci reprend à son compte ces dimensions, il va octroyer à
l’hégémonie, le sens plus large de la direction politique et idéologique.
Ainsi l’hégémonie correspond à un stade, ou l’idéologie et les pratiques des classes
dominantes se passent non seulement de la coercition, de la force, de la propagande, mais en
plus elle a la capacité de laisser se développer une force autonome d’opposition aux classes
dominantes.
Les théories de la gouvernance
2
GRAZ Jean Christophe, Les nouvelles approches de l’économie politique internationale, Annuaire Français de relations
internationales, Volume I, Bruylant, Bruxelles, 2000.
3
TOOZE Roger, Susan Strange et l’économie politique internationale, Economie politique, n°10, 2001b.
4
STRANGE Susan, The myth of lost hegemony, International Organization. 41, 4 automne 1987: p 551-574.

L'usage du concept de gouvernance prend des significations variées, du fait de son usage
de plus en plus répandu (Chavagneux 2001). Il faut donc distinguer la gouvernance comme
simple "action de gouverner" (Cassen, 2001), des différentes théories de la gouvernance. La
gouvernance globale, dans son utilisation comme prénotion, signifie un gouvernement
international mis en oeuvre par les pouvoirs publics (États et organisations internationales
publiques). La fonction de ces derniers consiste alors à compenser l’absence de direction
politique mondiale qui entraîne un développement anarchique de la mondialisation. La
gouvernance globale est ainsi préférée au terme de gouvernement global, considéré comme
insuffisamment démocratique, notamment du fait de ses dérives bureaucratiques possibles.
Mais nous allons voir que cette définition de la gouvernance comme prénotion, diffère
nettement de celle des théoriciens néo-libéraux qui l’ont forgée.
Historique de la gouvernance
Dès le Moyen âge, le terme “governance” évoquait le partage du pouvoir entre les
différents corps constitutifs de la société médiévale anglaise. Il était issu des travaux des
historiens universitaires anglo-saxons de l’époque (Solagral, 1997)
5
. Il est utilisé en ancien
français, mais aussi au Portugal et en Angleterre au XIIIe siécle, comme l'équivalent de
“gouvernement” (l’art et la manière de gouverner). Cassen précise qu’il passe en anglais
(governance) au siècle suivant avec la même signification.” (Cassen, 2001). Il n'existe pas
un mode de gouvernance, mais plusieurs. En les classant par ordre chronologique, il s'agit
principalement de la gouvernance d'entreprise ou coporate gouvernance (Coase, 1937),
locale ou urbaine (années 90), "bonne" (World Bank: 1991) globale (Rosenau : 1992) ou
mondiale et européenne (Commission Européenne, 2000)
6
. Par exemple “l’urban
gouvernance” débute en Angleterre avec l'élection de Margaret Tatcher en 1989 et a pour
origine le désengagement des pouvoirs publiques municipaux britanniques. Elle a pour
objectif de réorganiser le désengagement des municipalités néo-libérales, en faisant appel à
la société civile (associations et secteur économique privé). Ainsi “on fait d’une pierre trois
coups: on réduit les frais du public, on augmente le bénéfice du privé et on supprime dans
une grande mesure la marge d’intervention des classes populaires dans la gestion des
affaires publiques” (Brown, 2001 : 4). Dans l’usage de la gouvernance, il s’agit de
distinguer la théorie, le discours politique et la pratique de terrain. C'est pourquoi nous
préciserons les spécificités des différentes théories de la gouvernance chaque fois que cela
sera nécessaire.
La gouvernance globale par la société civile contre l’Etat
James Rosenau fait partie des politologues qui ont forgé le concept de gouvernance. Il
considère qu’il permet de “concevoir une gouvernance sans gouvernement, un ensemble de
mécanismes de régulation dans une sphère d’activité qui fonctionne même s’il n’émane pas
d’une autorité officielle” (Rosenau, 1992 : 5). Si l’on poussait le raisonnement à son
extrême, la société pourrait ainsi voir un jour la disparition de l’État au niveau national et
des institutions interétatiques au plan international au profit de la seule gouvernance par les
entreprises et la société civile.
5
SOLAGRAL, "Réforme de l’Etat et nouvelle gouvernance", Courrier de la planète, n°41, juillet-août 1997.
6
Dès 1995, la cellule prospective de la Commission Européenne va travailler sur ce thème et elle aboutira en 2001 la
présentation du livre blanc (CEE, 2000).

Les organisations internationales, comme l’ONU, l’OMC ou la Banque Mondiale, ont
compris tout le regain de légitimité qu’elles pouvaient tirer des ONG. La théorie de la
gouvernance qui règne au sein des organisations internationales publiques, s’appuie sur la
société civile pour remplacer ou renforcer l’État. Mais, comme le fait remarquer John
Brown, la société civile “est précisément cet ensemble de relations dans lequel les individus
ne sont pas des citoyens, mais de simples vecteurs d’intérêts particuliers. On est citoyen
qu’en tant que membre du peuple souverain" (Brown 6: 2001). L’ONU, L’OMC ou l’UE
par exemple, disent tenir compte des avis de la société civile surtout depuis le sommet de
Seattle en 1999. Or, lorsqu’ils tiennent des discours sur cette dernière, ils pensent surtout
aux organisations représentant les intérêts des entreprises privées (les BINGOS) et aux
associations qui les représentent. Pour le sommet de l’OMC de Doha en 2001, les ONG et
les syndicats ne s’élevaient pas à plus du tiers, parmi des représentants de la société civile,
tandis que les autres associations représentaient les intérêts des ETN.
On observe en effet une lutte idéologique, autour du concept de société civile, visant
notamment à gagner “la bataille” pour une nouvelle forme de direction politique
démocratique mondiale. Actuellement pour le sens commun, la société civile englobe
l’ensemble du champ social et économique. Y sont présents aussi bien les ONG, les
syndicats et les associations (culturelles, sportives...) que les acteurs économiques (salariés,
chefs d’entreprise...). Mais les organisations internationales de l’ONU ou de l’OMC
intègrent les représentants des entreprises dans le concept de société civile.
“La société civile, dans cette conception, signifie prendre en compte prioritairement le
monde de l’entreprise sur celui des associations citoyennes” selon Houtard (1998: 14).
Le terme de société civile nuit à une lecture claire des enjeux politiques, dans la mesure
où il recouvre des classes différentes et en conflit. Au sein de la société civile au sens de
Gramsci luttent donc différents acteurs afin de conquérir l’hégémonie idéologique et
politique et pour la défense des plus défavorisés. Nous les qualifierons pour notre part
d’associations civiques (ONG notamment), d’associations de travailleurs et de mouvements
sociaux.
Le partenariat avec la société civile se substitue à la souveraineté populaire
D’un point de vue lexical, théorique et politique on relèvera que la notion de société
civile se substitue souvent à celle de peuple et celle de souveraineté à partenariat (Gobin,
2002 : 157-169). Le Global Compact a été crée par l’ONU en 2001. C’est un partenariat
avec les entreprises dans lequel elle s’engage à faire respecter les normes fondamentales de
l’environnement, les droits de l’homme et du travail (droit syndical, interdiction du travail
des enfant...). Ce n’est plus les seuls représentants du peuple qui décident des lois, mais les
entreprises en partenariat avec l’ONU. De plus l’ONU dispose de la capacité d’exercer une
régulation contraignante, mais elle choisit de ne pas en user et préfère se limiter à
l’incitation fondée sur un engagement moral.
Même si elles n’appliquent pas le Global Compact, les entreprises disposent du droit de
placer le logo de l’ONU, sur leurs documents publicitaires. De plus, soutenir ainsi certaines
ETN, peut se révéler nuisible pour l’image, la crédibilité et même la légitimité de l’ONU.
Les Nations Unies ont autorisé les ETN Nike et Shell à se joindre aux entreprises adhérant
au Global Compact. Or leurs exactions (non respect de la limite du temps de travail, travail
des enfants...) dans ces domaines ont été observées à plusieurs reprises notamment par la
CCC européenne (1998).

L’ONU aspire à un partenariat avec les entreprises selon ses déclarations. Mais cela
suppose un échange de service réciproque. Les relations de l’ONU avec les entreprises
transnationales (ETN) prennent parfois la forme de partenariat économique. Par exemple,
l’UNICEF à demander à être sponsorisée par Mac Donalds.
Conclusion
La théorie de la gouvernance entend restaurer le pouvoir de la société civile afin ne pas
laisser une place excessive aux pouvoirs publics nationaux et internationaux considérés
comme trop bureaucratiques. C'est-à-dire que cette théorie entend privilégier une approche
“bottom up” (ascendante) par rapport à une approche “top down” (descendante) considérée
comme moins démocratique. Or, dans les pratiques politiques qui se fondent sur la
gouvernance globale ou européenne notamment, l’État est pris en tenailles. Il existe une
première limitation de la démocratie lorsque les organisations internationales publiques telle
l’ONU limitent la souveraineté des États; une seconde limitation apparaît quand les relations
entre les organisations internationales publiques et la société civile mettent à l’écart les
Etats. Alors que dans leurs discours, les tenants de la gouvernance entendent renforcer la
démocratie grâce à la société civile, nous observons la réalité inverse, puisque cette plus
grande participation favorise les intérêts privés d’une minorité. Si la majorité des ONG
souhaitent pas cela, elle ne désire pas pour autant un mode de gouvernance dominé par les
seuls pouvoirs publics internationaux. C’est à dire un gouvernement mondial qui serait
pyramidale et non participatif. Les mouvements sociaux reprochent donc au modèle de la
gouvernance globale et au gouvernement par les seules organisations internationales
publiques, d’être trop extrêmes et insuffisamment démocratiques. Ils considèrent que dans
ces modèles, les institutions servent prioritairement les intérêts des classes dominantes et
que cela restreind excessivement le pouvoir des États et des peuples.
BIBLIOGRAPHIE
ALTHUSSER Louis (1975), Positions, Paris, Ed. Sociale, “Idéologie et appareils
idéologiques d’État et soutenance d’Amiens”.
BLARDONE Gilbert (1994), Le FMI, L'Ajustement et les coûts de l'homme,
Édition de L'épargne, Paris.
BOUVIER Paule, (1998) “Le concept de société civile: mythe ou réalité”,
Cahiers Cercal, n°23, Bruxelles.
BROWN John (Juillet 2001), La gouvernance globale, Lignes d'Attac, Paris,
Attac.
BURNS T. (2000), The future of Parliamentary Democracy: Transition and
Challeng in European Goverance (Green paper prepared for Conference of the
Speakers of EU Parliements. Rome, September, 22-24, 2000), Rome, Uppsala.
CAMPBELL B. (1997), "Débats actuels sur la reconceptualisation de l'État" in
GEMDEV, Les avatars de l'État en Afrique, Paris, Kartala.
CASSEN Bernard (juin 2001), "Le piège de la gouvernance", Le monde
diplomatique, Paris.
CHAVAGNEUX Christian (2002), “La montée en puissance des acteurs non
étatiques”, Gouvernance globale, Conseil d’analyse économique, La documentation
française.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%