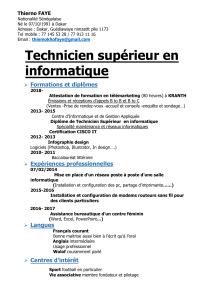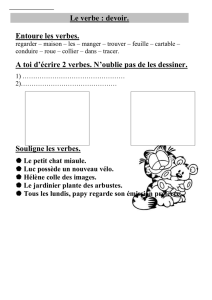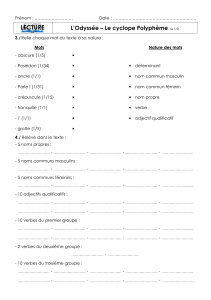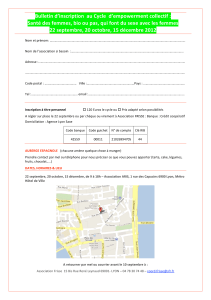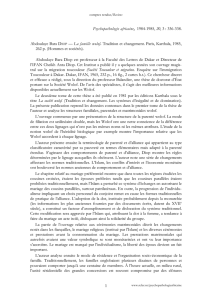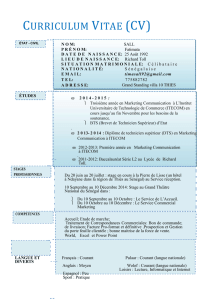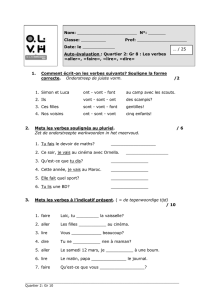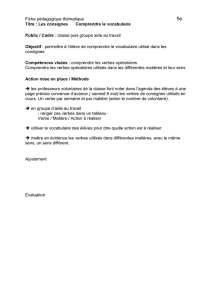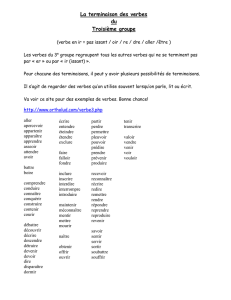ResBondeelleMoDyCoFev09

Olivier Bondéelle Résumé-séminaire du MoDyCo 18 février 2009
Université Paris X / Leiden University
Propriétés combinatoires des bases verbo-nominales en wolof: exemples des émotions
En wolof, certains lexèmes sont considérés comme des bases verbo-nominales (Nouguier-
Voisin, 2002 : 19) : ils ont la même forme et ils présentent la plupart du temps une polysémie
régulière du type : Action ↔ Nom d’action, ou Action ↔ Nom d’Actant’ (Apresjan, 1992 :
216-259). La double flèche se justifie par le fait que je ne préjuge pas d’un sens à priori de
dérivation sémantique.
XARITOO (B) ‘se lier d’amitié avec quelqu’un’ ↔ ‘liens d’amitié avec quelqu’un’.
Lexème verbal et lexème nominal ont vraisemblablement le même nombre d’actants
sémantiques : ici, les deux amis et la cause de leur amitié. Je testerai cette hypothèse en
utilisant le formalisme des décompositions sémantiques sous forme de graphes, et des
fonctions lexicales qui associent un lexème nominal à ses verbes supports (Mel’cuk et al.
1995, Mel’cuk 2004).
Il est admis que la distinction nom/verbe en wolof se fait selon la position et le comportement
combinatoire de l’unité lexicale (Nouguier-Voisin, 2002 : 19 et Robert 2003 : 103).
Dans le cas ci-dessus, il est vrai que la présence du suffixe verbal de réciprocité –oo indique
que la base est verbale.
Je propose de privilégier la combinatoire des bases verbo-nominales non dérivées comme
BËQËT (B) ‘craindre, avoir peur’ ↔ ‘peureux, poltron’ ; JAAXLE (G) ‘être inquiet, être dans
une situation embarrassante’ ↔ ‘inquiétude, trouble’ (si le suffixe verbal « possessif » -le
existe en wolof, la racine JAAX n’existe pas en synchronie) ; MER (M) ‘être fâché, se fâcher’
↔ ‘colère’. La lettre majuscule entre parenthèses précise la classe nominale. Le wolof en effet
est une langue à classes nominales dont les indices sont indissociables des noms.
Les mêmes indices spatiaux modifiant les noms et les verbes ont déjà été mis en évidence
(Robert 1998). J’étendrai cette question à d’autres indices qui n’ont pas forcément la même
forme, selon qu’ils modifient le verbe ou le nom : l’indice d’aspect pour le verbe, et l’indice
de nombre pour le nom. Ils ont ceci en commun qu’ils modifient tous deux le caractère discret
ou continu du lexème. Les noms comptables acceptent le pluriel, et les verbes d’activité se
combinent avec l’inaccompli à valeur progressive : RAGAL (B) ‘peureux’ ↔ ‘faire peur’.
Cette base verbo-nominale est considérée comme une entité discrète.
Le cas des humeurs sentimentales comme MER (M) ‘(être) en colère, se fâcher’ ↔ ‘colère’
est intéressant parce que cette base n’est considérée ni comme une entité discrète ni comme
une entité continue (Robert 1991). Ce genre de verbes peut se combiner avec les aspects
perfectifs et imperfectifs, tandis que ce genre de noms se combine de façon préférentielle avec
des verbes d’état de quantité.
Au cours de cette présentation, j’aurai parcouru des degrés de cohésion sémantique entre les
deux catégories grammaticales en donnant un aperçu de polysémies intra-catégorielles et
transcatégorielles. (Robert 2003 et Victorri 2002).
Références
Apresjan, 1992. Lexical semantics, user's guide to contemporary Russian vocabulary. Ann Arbor, Karoma
Publishers
Becher, J. 2003. Experiencer constructions in Wolof. Hamburger afrikanistische Arbeitspapiere 2:1-89.
Mel’cuk, I. and al. 1995. Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire. Louvain-la-Neuve : Duculot.
Mel’cuk, I. 2004. Actants in Semantics and Syntax I. Linguistics 42:1, 1-66. Berlin
Mel’cuk, I. 2004. Verbes supports sans peine. Lingvisticae Investigationes 27: 2, 203-217. Amsterdam: Johns
Benjamins
Nouguier Voisin, S. 2002. Relations entre fonctions syntaxiques et fonctions sémantiques en wolof. s.n.
Robert, S. 1991. Approche énonciative du système verbal: le cas du Wolof. Paris: CNRS.

Olivier Bondéelle Résumé-séminaire du MoDyCo 18 février 2009
Université Paris X / Leiden University
Robert, S. 1998. Espace déictique, espace syntaxique et prédication: les indices spatiaux du wolof. Proceedings
of the 16th International Congress of Linguists, Paris 1997, ed. Caron, CD Rom, CNRS-LLACAN Meudon /
Amsterdam, Elsevier.
Robert, S. 2003. Polygrammaticalisation, grammaire fractale et propriétés d’échelle. Perspectives synchroniques
sur la grammaticalisation, polysémie, transcatégorialité et échelles syntaxiques, ed. Robert. Louvain-Paris 85-
120
Victorri, B. 2002. La catégorisation et la polysémie. Catégorisation et langage, ed..Cordier et François.
Lavoisier 107-124
1
/
2
100%