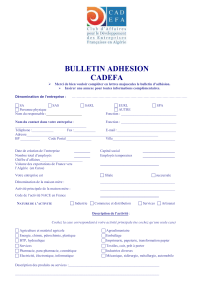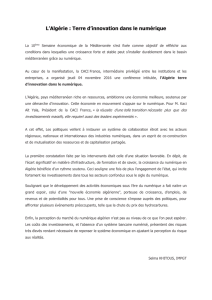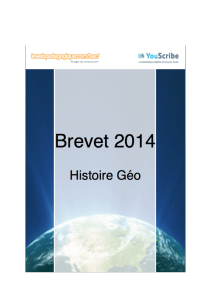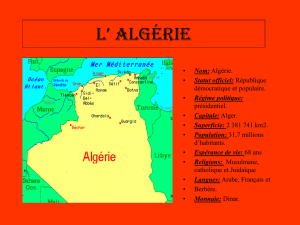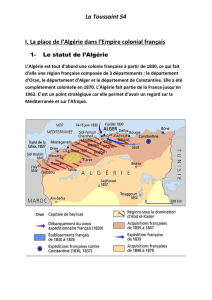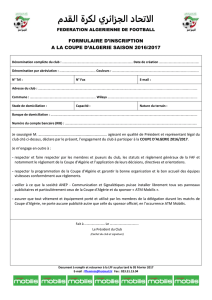télécharger - Cours-univ

1
LA GUERRE D'ALGERIE
Prologue (1945-1947) :
La proximité des côtes languedociennes et provençales, l'importance des intérêts français, la présence
d'une importante colonie (près d'un million de personnes d'origine chrétienne ou juive, et de statut civil
français pour environ 8 millions et demi de musulmans en 1954), ont habitué à considérer l'Algérie comme
indissolublement liée à l'avenir de la Métropole. Cette satisfaction n'est pas de mise. Elle oublie la violence
et les difficultés d'une conquête vieille de moins d'un siècle. Elle ignore totalement les aspirations des élites
musulmanes, à peu près totalement écartées des responsabilités, en particulier par les dispositions qui lient
l'octroi de l'intégralité des droits civiques à la renonciation au statut personnel musulman. Elle méconnaît
la misère et l'éloignement de la masse des paysans algériens. Elle sous-estime la force des sentiments
identitaires qui amène, en particulier, l'immense majorité à rejeter le statut personnel français comme une
apostasie, sans doute culturelle et nationale autant que religieuse, sentiments que ne suffisent pas à dissiper
les contacts amicaux que, malgré tout, ont pu entretenir des éléments privilégiés des différentes
communautés. Dans l'entre-deux guerres sont apparus les principaux mouvements de remise en cause : les
modérés de Ferhat Abbas, d'abord tentés vers l'assimilation, mais qui, déçus par l'absence de réformes
évoluent de plus en plus vers la conception d'une certaine autonomie ; les Ulema du cheikh Ben Badis,
religieux qui revendiquent moins l'indépendance que la reconnaissance de la personnalité arabo-
musulmane d'une nation algérienne différente de la nation française ; les radicaux de Messali Hadj (Étoile
nord-africaine, puis Parti du peuple algérien ou P.P.A.) partisans d'une indépendance immédiate.
La guerre précipite l'évolution : l'effondrement de mai 1940, l'épisode de Mers El-Kebir, la défaite de
Vichy en Syrie et au Liban et son occupation par les Britanniques, l'apparition des armées américaines au
Maghreb, sont, en dépit des efforts des Français libres, puis de l'armée d'Afrique, autant de témoignages
cruels d'une déchéance française qui peut paraître sans remède. Si les espoirs nourris par certains
nationalistes de voir balayé l'ordre colonial d'avant-guerre par une victoire des troupes de l'Axe disparaît
dès 1943, les proclamations des vainqueurs semblent autoriser des perspectives encourageantes pour la
majorité d'entre eux. Dans les derniers mois de la guerre, beaucoup de Maghrébins espèrent que la
Conférence de San Francisco, destinée à établir la Charte de la future organisation (mai 1945) proclamera
leur droit à l'indépendance. D'autres font plutôt confiance à la Ligue arabe, fondée au Caire le 22 mars
1945, et à laquelle l'émancipation des pays arabes tiendra longtemps lieu de programme.
Les revendications des Algériens sont résumées dans un texte essentiel, l'Algérie devant le conflit mondial.
Manifeste du Peuple algérien (12 janvier 1943), qui réclame une constitution propre, impliquant l'égalité
complète des Européens et des musulmans, mais aussi une réforme agraire, et la reconnaissance de l'arabe
comme langue officielle. Élaboré par Ferhat Abbas, ce texte est complété, à l'initiative de Messali Hadj, par
un additif (Projet de réformes faisant suite au Manifeste du Peuple algérien) qui fait allusion à la « nation

2
algérienne », et exige que la future constitution soit, non pas octroyée, mais élaborée par une assemblée
constituante. A ces demandes, le Comité français de libération du général de Gaulle répond par le statut du
7 mars 1944, qui reprend des dispositions envisagées, mais non appliquées, par le Front populaire de 1936
(projet Blum-Viollette), en accordant en particulier à 70.000 musulmans la citoyenneté et l'accession au
collège électoral des citoyens français (dit « premier collège ») sans modification de leur statut personnel,
promesse étant faite aux autres d'une évolution identique dans un délai rapproché.
Ces mesures, très critiquées par les milieux français, paraissent très insuffisantes aux nationalistes, mais leur
refus n'entame pas la détermination du gouvernement, décidé à ne pas engager d'autres réformes avant la
fin du conflit. Autant que l'absence d'initiatives politiques, les Algériens musulmans souffrent de cinq ans
de famine, d'autant plus mal acceptées, comme le fera observer Albert Camus, qu'elle se sont
accompagnées de discrimination en matière de rationnement. Alors que la France célèbre la capitulation
allemande, les événements de mai 1945 manifestent la gravité des tensions accumulées. A l'initiative des
militants nationalistes, des manifestations sont organisées à l'occasion de la fête de la victoire. Mais
l'initiative leur échappe. De véritables émeutes enflamment le Constantinois. La grande peur des Français
d'Algérie, aussi vieille que la colonisation, se réveille à la description de la mise à mort d'une centaine
d'entre eux, massacrés dans les rues des villes (Sétif, Guelma), ou dans leurs fermes isolées.
La réaction répression française est d'autant plus brutale que les autorités ne peuvent compter que sur des
effectifs réduits. Elle fait au moins 1.500 victimes. Il n'est pas question, pour les Français, d'accepter de
voir se disloquer un empire dont le rôle a été si important dans le redressement survenu depuis 1940, alors
que, depuis septembre 1945, les troupes du général Leclerc reprennent pied en Indochine. Déjà peu
attentive aux changements avant 1939, détournée par l'occupation, puis la Libération, et désormais par les
soucis de la Reconstruction, des problèmes d'outre-mer, l'opinion est d'abord profondément ignorante des
difficultés qui peuvent s'y manifester. Pour ceux qui peuvent en avoir connaissance, la tentation est aisée
d'attribuer ces difficultés à l'action exclusive de l'étranger : britannique, avec quelque fondement pour ce
qui concerne le Levant ; voire nazi, comme le proclame, de façon peu crédible, le parti communiste au
lendemain des émeutes de Sétif. Il est difficile de concilier avec la revendication d'indépendance l'image,
toute récente, du loyalisme des populations et surtout des soldats musulmans.
Nouvelles occasions perdues (1945-1954) :
En dépit du lourd passif que constituent les événements de 1945, tous les chemins d'une évolution ne
sont pas fermés. Des représentants (dont 13 Algériens musulmans) sont appelés à siéger dans l' Assemblée
constituante élue en octobre 1945. La majorité des constituants n'est pas a priori hostile à des réformes.
Une amnistie est votée, les prisonniers politiques libérés. La loi Lamine-Gueye du 7 mai 1946 confère la
qualité de citoyens à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer (Algérie comprise). Les péripéties de

3
la vie politique française (départ du général de Gaulle, élaboration difficile d'une constitution) amènent le
vote, par la première Assemblée nationale de la IVème république, du statut de septembre 1947. Ce texte est
à la fois généreux dans ses principes proclamation de l'égalité effective de tous les Algériens, en particulier
dans l'accession aux emplois) et timide dans ses dispositions (maintien de l'expression « groupe de
départements français », maintien du système du double collège). Il n'est pas cependant dénué de
potentialités, puisqu'il remplace les vieilles Délégations financières, symbole du système colonial, par une
Assemblée algérienne dotée de vastes pouvoirs en matière de réformes, promet une réorganisation des
institutions municipales, reconnaît la place de la langue arabe.
Mais, dans les années suivantes, l'immobilisme domine les gouvernements, préoccupés par les tâches de la
reconstruction, la guerre froide, le conflit indochinois, et affaiblis au surplus par une instabilité chronique.
En Afrique du nord, ils cherchent avant tout à maintenir l'ordre français, en imposant aux deux
protectorats de Tunisie et du Maroc, tentés par la récupération de leur totale souveraineté, des liens
indissolubles avec la France. Ces efforts, marqués par la déposition du roi Mohammed V et son
remplacement par Ben Arafa (1953), et la lutte contre le néo-destour de Bourguiba, aboutissent au début
de 1954 à une agitation qui menace de tourner à la guérilla (dans les campagnes tunisiennes, le sud en
particulier, apparaissent les premiers maquis dont les combattants sont désignés par les Français du vieux
mot de fellaghas, littéralement coupeurs de routes.) Le calme de l'Algérie contraste alors avec les troubles de
ses deux voisins. Les positions françaises paraissent même avoir été renforcées. Les « départements
français d’Algérie » ont été inclus en 1949 dans la zone couverte par le pacte de l'Atlantique nord, ce qui
constitue une reconnaissance de légitimité de la part des Américains. L'organisation spéciale (O.S.) mise
sur pied en 1947 par un congrès du M.T.L.D. (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques,
qui a succédé au P.P.A. dissous) pour préparer la lutte armée est démantelée par la police française au
printemps de 1950 après quelques coups de main audacieux comme le hold-up de la poste d'Oran sous la
direction d'Aït Ahmed. Toutes les élections donnent aux candidats patronnés par le gouvernement général
des majorités confortables.
Mais ce repos est largement trompeur. Les événements de Tunisie et du Maroc sont connus et
commentés, d'autant plus que les contacts entre militants maghrébins sont étroits. La représentativité des
élus indigènes est très faible, en raison des trucages électoraux pratiqués sous la responsabilité du
gouverneur, le socialiste Marcel-Edmond Naegelen. Les programmes ambitieux de développement
économique et social sont mis en veilleuse. Cette situation fait le jeu des attitudes extrémistes. Côté
français, des lobbies influents, dans lesquels pèsent lourdement les intérêts de l'agriculture et du
commerce, s'emploient à paralyser les velléités de réformes, en exploitant les inquiétudes des « Pieds-
Noirs. » Côté algérien, les partisans d'une guerre révolutionnaire soulignent les impasses d'une solution
électoraliste. Les défaites de l'armée française en Indochine les décident à passer à l'action.

4
Le déclenchement du conflit :
Les premiers « événements » en Algérie compromettent cependant les chances d'une évolution maîtrisée.
Dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre 1954, 70 attentats répartis sur l'ensemble du territoire algérien
font 8 morts, et d'importants dégâts matériels. Le 31 octobre, le (F.L.N.) fait connaître ses buts de guerre :
négociations immédiates avec les « porte-paroles autorisés » du peuple algérien, sur la base de la
reconnaissance de la souveraineté algérienne ; abrogation de tous les textes « faisant de l’Algérie une terre
française », au déni de « l’histoire, de la géographie, de la langue, de la religion et des mœurs du peuple
algérien ». Dans une proclamation du premier novembre, il appelle à la « restauration d’un État algérien
souverain, démocratique et social, dans le cadre des principes islamiques. »
L'événement, rétrospectivement considéré comme le point de départ d'une guerre de sept ans, crée peut
être alors une situation moins irrémédiable qu'il n'y paraît. Après la vague d'attentats, un certain calme s'est
rétabli. Il n'est pas totalement impossible d'espérer une accalmie comparable à celle que connaît, au même
moment, la Tunisie, où après l'engagement par le gouvernement de Pierre Mendès-France d'une politique
d'autonomie interne, les fellaghas commencent à rendre leurs armes. Les « chefs historiques » qui donnent
l'ordre d'insurrection en Algérie apparaissent à la fois comme des spécialistes de l'action clandestine (ce
sont pour la plupart d'anciens responsables de l'O.S.) et comme des militants déçus de l'incapacité de leur
parti (le M.T.L.D.) à surmonter la crise. Leur passage à l'action vise surtout à forcer les événements en
obligeant les Algériens à choisir leur camp, selon une stratégie révolutionnaire éprouvée ; il ne traduit pas
le mouvement irrésistible d'une majorité unanime sur les moyens, sinon sur le but final de l'indépendance.
Peut-être à ce moment encore, un train de réformes urgentes, accompagnées d'une répression mesurée,
pourrait éviter l'épreuve de force et consolider les espoirs des nationalistes modérés. Mais il conviendrait
d'agir très vite. Depuis juillet 1954, l'Égypte dispose, en la personne du colonel Nasser, porté à la tête de
l’État par l'éviction du général Néguib, d'un chef énergique, soucieux de faire de son pays le leader du
monde arabe, et de travailler à son unité et à son émancipation. L'anticolonialisme accède à une dignité
nouvelle avec la tenue de la conférence des pays afro-asiatiques de Bandoung (avril 1955), à laquelle ont
participé des délégués du Maghreb. Il faut aussi-et peut-être surtout- remarquer que l'appui des États-Unis
est appelé à se dérober de plus en plus : précisément en ce mois de juillet 1954 où Mendès-France tentait
de débloquer la situation au Maghreb, Washington poussait Londres et Le Caire à signer un accord
prévoyant l'évacuation de l'Égypte par les troupes britanniques, et se faisait concéder par la Libye
nouvellement indépendante l'utilisation de la base de Wheelus. Assurés d'une position solide en Afrique du
Nord, et ayant obtenu dès l'automne 1954 la création d'une armée allemande, qui a suivi le rejet du projet
de C.E.D. par l'Assemblée nationale française (30 août) les Américains ne sont pas en position de
demandeurs.

5
Mais peu de Français sont prêts à accepter des révisions déchirantes. Le programme du F.L.N. est trop
radical pour paraître acceptable, ses chefs trop peu, trop mal, ou trop défavorablement connus pour être
crédibles. Les adversaires de toute réformes (et notamment les représentants des Français d'Algérie),
effrayés par l'affirmation arabo-musulmane du programme des « terroristes », et ne sont rassurés ni par la
promesse de respecter les personnes et les biens « honnêtement acquis », ni par l'assurance qu'un traité
maintiendra certains liens avec la France. Les partisans de Mendès-France sont loin de rassembler une
majorité de militants anticolonialistes, comme suffirait à le prouver la présence, aux côtés de vieux
militants socialistes aussi indiscutablement engagés que le professeur Charles-André Julien, ou l'homme
politique Alain Savary, de grandes figures comme celles du général Catroux, du grand orientaliste Louis
Massignon ou d'Albert Camus, plus soucieux de défendre respectivement une certaine conception de la
France, du message chrétien ou de l'humanisme, et de travailler à l'émancipation politique des Algériens
dans un cadre français, que d'envisager l'indépendance. De leur côté, le président du conseil et ses
ministres souhaitent avant tout rénover l'ordre français et de le rendre compatible avec les aspirations des
peuples de l'Afrique du Nord et avec les idéaux républicains. Le Maghreb, et encore moins l'Algérie, ne
constituent pas des tâches prioritaires, en comparaison des questions de défense européenne, puis des
tentatives de réforme constitutionnelle. Il en va de même du personnel politique. Dans la coalition qui se
forme contre le gouvernement dès la fin de 1954, on trouve bien sûr des adversaires de ses projets
libéraux, réels ou redoutés, en Afrique du Nord, conduits par le leader radical René Mayer, mais aussi les
communistes et le M.R.P., hostiles, pour des raisons opposées, à sa politique européenne.
Ainsi le bilan est-il médiocre. Les premières réactions du gouvernement à la nouvelle de l'insurrection
algérienne (et en particulier celles du ministre de l’intérieur François Mitterrand) sont essentiellement
consacrées à la réaffirmation de la souveraineté française, et au refus de tout compromis avec les
« rebelles. » Des mesures répressives inadéquates (dissolution du M.T.L.D., arrestation de ses militants)
facilitent les ralliements au F.L.N. En Algérie, le gouverneur Jacques Soustelle, qui a pris ses fonctions avec
des intentions réformistes, en est aux premiers contacts lorsque Mendès-France est renversé (février 1955.)
L'accélération de l'histoire :
Les mois qui suivent ne marquent pas de changement notable dans la politique de Paris. Le gouvernement
Edgar Faure, sans doute autant pour éviter de heurter de front une opinion peu préparée aux changements
que par difficulté d'élaborer une politique, se garde d'afficher des intentions nettes. C'est seulement en juin
1955 que sont signées les conventions franco-tunisiennes qui établissent l'autonomie interne. Au Maroc, le
résident Gilbert Granval cherche à imaginer une solution qui permette d'écarter Ben Arafa sans recourir
au rappel de Mohammed V. Le programme engagé par Soustelle, encouragé par des conseillers plein de
générosité et d'imagination, comme le commandant Vincent Monteil et l'ethnologue Germaine Tillion, et
qui sera celui de ses successeurs, ne manque ni d'ambition ni de générosité. Guidé par l'idée d'intégration
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%