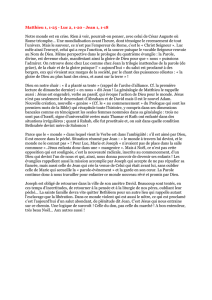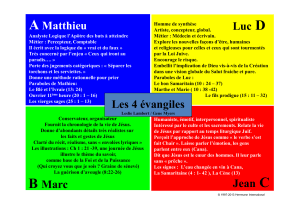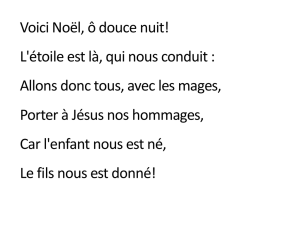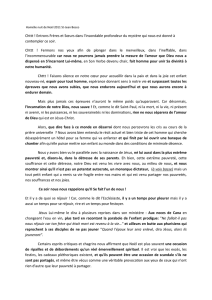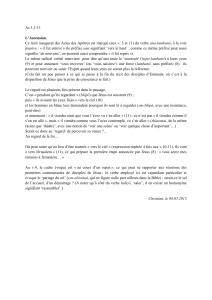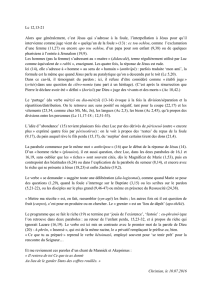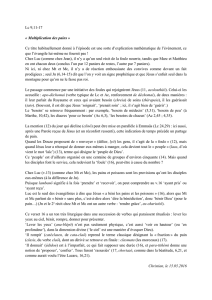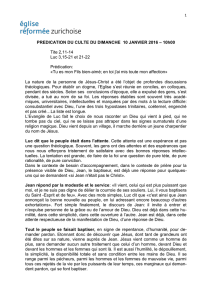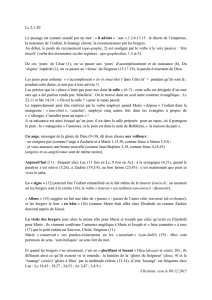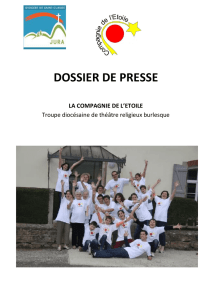Le cœur,

Le cœur,
foyer de la prière
Lc 2, 19 et 51.
Deux fois, dans des termes presque identiques, Luc présente Marie ainsi : « Marie, de son côté,
gardait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur » (Lc 2, 19). « Et sa mère
conservait fidèlement toutes ces choses en son cœur » (Lc 2, 51).
Marie est présentée comme la femme qui garde et médite dans son cœur tout ce qui arrive à
son Fils. Le cœur, dans la bible, est la partie la meilleure d’une personne, comme son
sanctuaire, là où elle est vraie ; là où Dieu se fait présent. C’est dans le cœur que Marie prie en
gardant avec soin tout ce qui se dit de son Fils. Garder dans le cœur est une action longue,
quotidienne, qui caractérise une personne qui vit au-dedans. Nous trouvons Marie dans cet
état le jour de Noël et douze ans après, quand Jésus est perdu puis retrouvé dans le Temple.
C’est une habitude chez Marie.
Que garde-t-elle avec soin, fidèlement, dans son cœur ? Ce sont tous les messages qui lui
viennent et qui l’éclairent sur Jésus. Tout ce que Gabriel lui a dit, puis Elisabeth, les anges, les
bergers, Syméon et Anne et la réponse même de Jésus : « Ne saviez-vous pas que je me dois aux
choses de mon Père ? » Marie est constamment évangélisée par d’autres. Tout cela elle le médite,
l’approfondit, le prie et devient en elle une vision de plus en plus limpide du Fils. Il lui arrive
de ne pas comprendre : ce que Syméon dit de l’enfant, ce que Jésus, jeune adolescent, répond.
Mais elle a l’attitude la plus juste de celui qui croit : elle met cela dans son cœur où dans la
prière, la lumière un jour se fera.
Les deux cas rapportés par Luc paraissent semblables, en fait ils sont très différents.
L’impression est que, dans un premier temps, Luc avait terminé son deuxième chapitre avec la
visite des bergers et la circoncision, conclusion normale pour le cycle des événements de Noël
et le parallèle que Luc avait tracé entre le cas de Jean Baptiste et celui de Jésus. Le climat y est à
la joie, comme le confirme l’ange : « Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera grande joie pour
tout le peuple. Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est Christ Seigneur » (Lc 2,
10-11). Après cette première conclusion, Luc ajoute la Présentation au Temple, (Lc 2, 22-38),
et la perte de Jésus à Jérusalem, (Lc 2, 41-52). Ces deux événements présentent l’annonce de la
souffrance : l’épée qui va transpercer l’âme de Marie et le fait de perdre l’enfant, pendant trois
jours, à Jérusalem, au temps de Pâques : premier pénible entraînement à la Passion. Dans les
deux cas Luc emploie le verbe « garder », en grec « terein », mais il fait précéder le verbe d’un
préfixe différent. Pour la joie de Noël il écrit « synterein », car les divers éléments s’unissent
d’eux-mêmes, ils ont un mouvement centripète. Le préfixe « syn » indique cela, comme dans
les mots symphonie, sympathie, symposium, synthèse… Dans le deuxième cas, quand le
douleur domine, les éléments ont un mouvement centrifuge et il est bien plus difficile de les
garder ensemble. Dans ce cas Luc emploie le préfixe « dia », « diaterein ». Ce préfixe indique la
tendance à la séparation comme dans les mots diaphragme, dialyse, diamètre, et surtout diable,
qui est le grand diviseur du cœur de l’homme.
Dans la joie et dans la peine, Marie sait rassembler toutes les choses dans son cœur, les garder
dans la prière et dans l’effort intellectuel pour les comprendre. C’est cela qui permet de dire
que Marie est la première mystique et la première théologienne chrétienne.

Actions suggérée :
Cherche comment Marie est ici le modèle même de l’évangéliste, de tout chrétien qui vit
avec la Parole de Dieu, et plus encore Marie est l’image de l’Eglise.
Préface
La préface de la fête du cœur immaculé de Marie dit bien les qualités de ce cœur :
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Car tu as donné à la Vierge Marie
un cœur sage et docile
pour qu’elle accomplisse parfaitement ta volonté ;
Un cœur nouveau et doux
où tu pourrais graver la loi de l’Alliance nouvelle ;
Un cœur simple et pur,
pour qu’elle puisse concevoir ton Fils en sa virginité
et te voir à jamais ;
Un cœur ferme et vigilant
pour supporter sans faiblir l’épée de la douleur
et attendre avec foi la résurrection de ton Fils.
1
/
2
100%