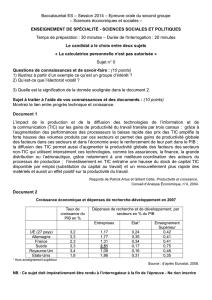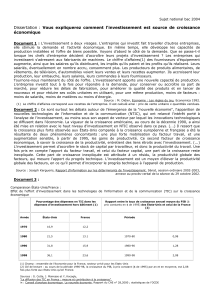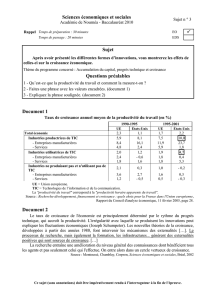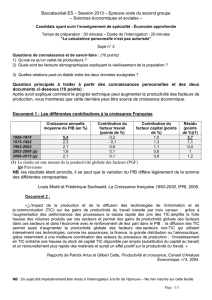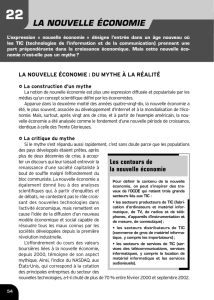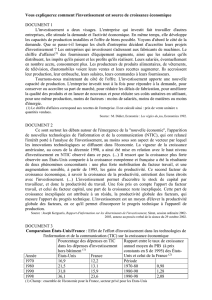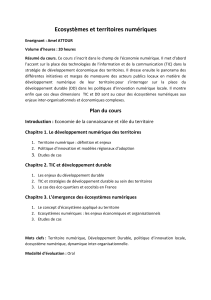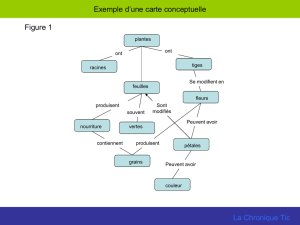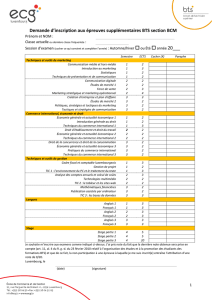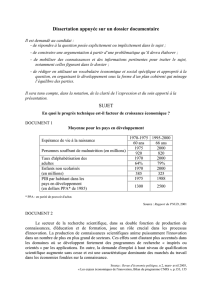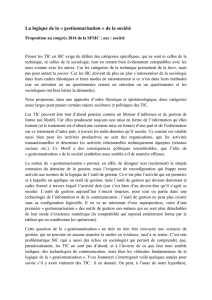a. Nouvelle économie

Orga2004 E-Economie
1
INTRODUCTION :
À l’aube du troisième millénaire, les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus
complexe et changeant. Des marchés saturés, une compétitivité croissante des pays à faibles coûts
de production, une compétition accrue de la part des firmes multinationales, une plus grande
accessibilité au savoir, des clients plus exigeants et moins fidèles et des modifications au tissu
démographique sont autant de défis que doivent relever les entreprises modernes. De plus, la
complexité et la rapidité des changements, qu'ils soient d'ordre social, économique ou
technologique créent des conditions qui remettent en question les prémisses sur lesquelles la
plupart des organisations modernes ont été construites.
La nouvelle économie n’est pas si nouvelle. Elle se situe dans un mouvement long de
transformation de nos économies qui d’agricoles, puis industrielles, sont devenues surtout des
économie de services, et plus fondamentalement des économies de la connaissance et du savoir («
the knowledge based economy »). La dimension intellectuelle des activités économiques est de
plus en plus importante, y compris dans les activités les plus matérielles et pratiques. Les
ressources nécessaires à cette transformation augmentent fortement. Les activités de création et
d’acquisition de nouveaux savoirs, de recherche et de diffusion de nouveaux procédés, produits et
modes d’organisation deviennent essentielles. Les investissements dits intangibles en recherche-
développement et innovation, en éducation et en formation croissent plus rapidement que les
investissements tangibles traditionnels.
La « nouvelle économie », et c’est là sans doute ce qui la distingue surtout de l’ancienne
économie, résulte en fait de l’interaction forte entre le mouvement long de l’économie de la
connaissance et la révolution formidable des technologies de l’information et de la
communication (TIC), et notamment la rapidité sans doute sans précédent des progrès des
performances techniques des matériels et des logiciels informatiques.

Orga2004 E-Economie
2
I. L’ECONOMIE DE L’INFORMATION, RAPPEL HISTORIQUE :
Dans ses structures comme dans son contenu, l’information s’était insérée, durant la
deuxième partie du XXème siècle, dans de multiples réseaux qui la liaient déjà à l’économie.
Les progrès enregistrés, après la deuxième guerre mondiale, dans le domaine des
télécommunications, ont rendu possible la transmission instantanée de l’information et ont
permis à la communication d’apparaître comme un pivot des relations économiques
internationales.
En réalité, communication et information ont été, depuis longtemps, plus ou moins associées à la
production et au travail, mais la corrélation entre l’économie et la communication s’est renforcée,
de telle sorte que la communication est devenue un réel facteur de développement, en même
temps qu’une force économique prépondérante.
I. 1. Contribution tangible au développement :
La contribution au développement s’était traduite par trois aspects ; stimulation du
changement, élargissement des horizons et renforcement de la participation du citoyen à
l’effort commun du développement et de l’interdépendance économique.
a. Stimulation du changement :
L’effet des moyens d’information dans le processus général de la modernisation et du
développement économique et n’est plus à démontrer.
Il convient de reconnaître, toutefois, que dans les pays en développement, l’évolution
des moyens d’information s’était fait en marge des planifications nationales et n’était pas
intégrée, initialement, au processus du développement économique et social. La radio, qui était
un moyen de communication pour l’élite est devenu un véritable moyen de communication de
masse. Les dirigeants des nations en développement ont donc fini par prendre conscience de
l’immense rôle que peuvent jouer les médias. Les journaux, la radio,devaient décider de ce qu’il
convenait de savoir et de faire.
Ce rôle d’informer, consistait à attirer l’attention de la population sur la nécessité de
transformation et sur les méthodes et les moyens à employer pour les réaliser.
Cette constatation est importante, parce qu’on pouvait orienter l’intérêt collectif vers
un mode de comportement nouveau ou une pratique agricole originale. En attirant l’attention sur
ces problèmes, les moyens d’information pouvaient également fournir des thèmes de discussions.
S’ils le pouvaient, les dirigeants d’un pays en développement iraient de groupe en groupe, pour
suggérer des points de vue, des innovations à méditer ou à discuter. Ce contact direct a été
prolongé par les médias, car les dirigeants ne pouvaient pas visiter individuellement tous les
villages, ni prendre contact avec tous les groupes.
b. Élargissement des horizons :
Les membres d’une société traditionnelle qui prenaient contact pour la première fois avec les
moyens d’information, attribuaient à ces moyens, une vertu magique. Par cette crédibilité qu’ils
inspiraient, les médias pouvaient aider les populations des pays en développement à connaître le
mode de vie des peuples étrangers et, par conséquent, à voir leur propre vie sous un jour meilleur.
Ils constituent une force de libération parce qu’ils suppriment les barrières de la distance et de
l’isolement.
En effet, selon D. Learner, contrairement aux sociétés modernes, la société traditionnelle est «
non participante » : les hommes s’y groupent par familles, en communautés isolées les unes des
autres. En l’absence d’une division du travail campagneville, il ne se crée guère de besoins,
exigeant une interdépendance économique. Faute d’interdépendance, l’horizon de chacun est
limité au cadre local et les décisions ne concernent que des personnes connues. Il est donc

Orga2004 E-Economie
3
impossible d’avoir une « idéologie » nationale, permettant à des gens qui ne se connaissent pas,
d’aboutir à un « accord » commun. Par contre, la société moderne est « participante » parce
qu’elle est fondée sur « l’accord mutuel » ; ceux qui prennent des décisions personnelles sur des
questions d’intérêt public traduisent forcément la volonté d’une large majorité ; c’est cela même
qui assure la stabilité d’un gouvernement. Cette forme historique d’organisation sociale est
assurée par des gens qui ont fréquenté l’école, qui lisent les journaux, et qui sont censés avoir une
opinion sur les affaires publiques.
Ainsi, en rapprochant ce qui est éloigné et en rendant compréhensible ce qui est étranger, les
moyens d’information élargissent l’horizon du citoyen et facilitent le passage de la société
traditionnelle à la société moderne. Les moyens d’information peuvent élever le niveau de vie
dans les sociétés en développement, les libérer du fatalisme ou du conservatisme et les
encourager à améliorer leurs conditions de vie.
C’est dans ce cadre que l’on peut évoquer le rôle positif de la publicité, comme étant
un mode d’information et de développement économique.
En effet, la publicité utilisée à bon escient, peut contribuer à atteindre des objectifs
socio-économiques, tels que le développement de l’épargne et de l’investissement, le
planning familial ou l’achat d’engrais pour améliorer la production agricole.
I.2. Une nouvelle force économique :
Cette nouvelle force s’était manifestée à travers quatre expressions complémentaires :
- Une association de l’information à l’industrie,
- La parution de nouveaux métiers,
- Une grande rentabilité,
- Un large fossé entre Nord et Sud,
a. Association à l’industrie :
Pour le simple citoyen et pendant longtemps, le monde de l’information se limitait aux
journalistes. En effet, seules quelques vedettes du petit écran et animateurs de radio, et très peu de
chevaliers de la plume, parvenaient à se faire connaître du grand public.
L’immense majorité (secrétaires de rédaction, metteurs en page, correcteurs, monteurs,
techniciens de transmission…) demeuraient dans l’anonymat. Mais les activités de la
communication et de l’information s’associaient, déjà, à d’importantes industries qui
occupaient une grande place dans l’économie, qu’on évaluait par le nombre d’usines ou
des emplois et des besoins en capital.
Les composantes les plus répandues de l’industrie de la communication existait à plus ou moins
large échelle dans pratiquement tous les pays : Journaux, revues et maisons d’édition, sociétés de
radio et de télévision, agences de presse, entreprises de publicité et de relations publiques,
chaînes de distribution de documents imprimés, visuels et sonores pour les journaux,
conglomérats de diffusion par radio et par télévision, services d’information
gouvernementaux, banques de données, producteurs de logiciel, fabricants de matériel
technique, ainsi que les premières applications de l’informatique.
Il fallait souligner aussi, les rapports étroits de la communication avec d’importantes
branches de l’industrie comme l’imprimerie, la production de papiers journal et l’industrie
électronique qui fournit aux médias les photocomposeuses, l’équipement de diffusion par
radio et télévision, les postes de télévision et de radio, etc. Elle est, à son tour, liée à de
nombreuses autres branches du complexe industriel telles que la fabrication d’ordinateurs,
de fibres optiques, de rayons laser et de satellites.
Il convient de relever, en outre, que l’industrie de la communication comprenait déjà
ce qu’il est convenu d’appeler « l’industrie culturelle » qui reproduit ou transmet des

Orga2004 E-Economie
4
produits culturels ou des oeuvres culturelles et artistiques par des techniques industrielles.
Certains sont allés plus loin dans leur analyse : ils ont englobé dans la définition du
secteur de la communication, une grande partie de l’éducation et de la science, la médecine
préventive et une partie des services de l’administration publique.
En outre, de nombreuses activités des trois secteurs : primaire, secondaire et tertiaire
ont été considérées comme des « emplois de la communication », dans la mesure où de
nouvelles techniques de traitement des données commençaient à envahir progressivement
l’activité économique.
b- Nouveaux métiers :
Le domaine de la communication s’est avéré, depuis quelques temps, comme secteur
générateur d’un grand nombre de profession et de métiers. Depuis 1972, dans certains pays
fortement industrialisés, notamment les Etats-Unis et le Japon, le secteur de la communication-
information aurait créé plus d’emplois que les activités réunies des trois secteurs. Selon une étude
sur le développement de la société d’information aux USA, de Marc Uri Porat (qui donnait un
sens très large au concept de l’information), près de 50 % de la population active occupaient, en
1975, des emplois dans les différents domaines de la communication (contre 13% seulement au
début du siècle). Près de la moitié du PNB aux USA, provenait de la production, de la
transformation et de la distribution des biens et des services de l’information.. Pour M. Fowler10,
Président de la Commission Fédérale Américaine de la Communication, le pourcentage des
activités de l’information et de la communication dans la vie économique, en Amérique, qui était
de 2% en 1880, a pu excéder en 1980 (soit un siècle après) 66% de la production nationale
américaine.
Selon Williams Davidson, le total des activités américaines dans l’information, ne pouvait être
inférieur à 150 milliards de dollars, en 1983, et le pourcentage des industries de l’information
doit dépasser 40 % du total des activités industrielles aux Etats-Unis d’Amérique, à la fin du
XXème siècle. Cette tendance ne se manifeste pas uniquement aux USA, et certains chercheurs
supposaient que les activités de l’information et de la communication (avec un sens plus
restrictif) ont dépassé toutes autres activités dans les pays qui ont atteint un degré élevé
d’évolution technologique. En effet, et selon un expert arabe, M. Hassan Saab, le taux de ces
activités auraient atteint 40% du total de l’activité économique au Japon et en Allemagne
Fédérale.
c. Une grande rentabilité :
M. Mehdi El Mandjara, chercheur marocain, a déclaré, en 1983, que « la rentabilité de
l’investissement dans l’information est estimée à 15%, alors qu’elle atteignait à peine
4 à 5% il y a 30 ans. En revanche, la rentabilité du capital, qui était environ de 10 à 12 %,
en 1930, est tombée, aujourd’hui à 4% par an ».
Ainsi, l’information qui devenait une ressource dont dépendaient les autres, prendra la
place du capital dans les sociétés post-industrielles, comme ce fut le cas pour les ressources
naturelles qui avaient été, il y a deux siècles remplacés par le capital.
d. Un fossé numérique :
Mais, selon M. El Mandjara, l’information est responsable, dans une large mesure, du
fossé numérique qui continuera à se creuser entre le nord et le sud : les pays développés
étaient vingt fois mieux équipés en la matière, que ceux du Tiers Monde, en 1980. Ce chiffre
passerait à 50, au début du XXIème siècle. De fait, la très grande expansion et le taux de
croissance des technologies de l’information, à l’intérieur de l’ensemble du complexe industriel,
dans les régions techniquement avancées, a accéléré le développement économique, social et
politique,alors que le développement des télés services a permit à certains pays endéveloppement,

Orga2004 E-Economie
5
d’améliorer leurs taux de croissance économique.
Il s’agit, par conséquent, pour les pays les moins avancés, de prendre conscience de
l’apport considérable de cette ressource et de l’utiliser à bon escient, en vue d’une
contribution soutenue au développement national.
II. DEFINITION DE LA NOUVELLE ECONOMIE :
Les technologies de l’information et les réseaux interconnectés sont en train de transformer
radicalement les systèmes mondiaux de la production. L’économie numérique, résultant de ces
technologies, dont la manifestation la plus spectaculaire est l’Internet a engendré de nouvelles
stratégies commerciales qui modifient la structure fondamentale sur laquelle reposait le marché
depuis des décennies.
Une nouvelle économie est née, fondée sur la refonte des règles de l’activité économique. La
nouvelle économie, par opposition à l’ancienne, reposerait en conséquence, sur le développement
des télé services, les activités à caractère immatériel, ainsi que sur l’ensemble des industries de
l’information et des télécommunications, auxquelles on ajoute le secteur des biotechniques,
industries caractérisées par un rythme très élevé d’innovations technologiques.
La question est de savoir, alors, si les changements intervenus depuis plusieurs années
et liés notamment à la diffusion des technologies de l’information, ne constituent pas les éléments
d’une nouvelle réorganisation du travail et d’une nouvelle conception de la gestion économique.
En effet, la question du rôle joué par l’information dans la croissance économique a longtemps
été négligée dans la littérature économique ; c’est peut être ce qui justifie l’hésitation des
théoriciens devant le choix des terminologies. En effet, les administrateurs semblent opter pour
les termes « d’économie numérique ou immatérielle », les littéraires préfèrent « l’économie du
savoir », et les communicateurs marquent leur préférence pour « nouvelle économie de
l’information », rappelant ainsi, le bien fondé des théories de Uri Porat, de Schramms, et de
Daniel Learner. Chadli Ayari, économiste chevronné, se rallie à ce choix, mais des économistes
plus pragmatiques ont retenu le terme « nouvelle économie ».
II.1.Comparaison entre ancienne et nouvelle économie :
a. Des phénomènes nouveaux :
Cette nouvelle économie, résultat de ces nouvelles technologies qui envahissent de
plus en plus la vie quotidienne, est fondée sur des phénomènes qui sont en train de
s’affermir et de s’imposer au fil des jours :
Les entreprises sont en train de subir une transformation radicale et massive quant à leurs
structures, leur fonctionnement et leurs stratégies pour mieux répondre aux exigences et
aux impératifs de cette nouvelle économie numérique.
Les transactions s’effectuent à la vitesse de l’éclair. Ainsi, « les bureaucraties
ensommeillées, les structures de gestion dirigistes ne sont plus de mise et l’avantage
comparatif de l’économie numérique est de plus en plus fondé sur l’agilité, la souplesse
et la rapidité de conclusion et d’exécution des transactions ».
La connaissance est l’actif essentiel des dotations en richesse : la transformation de
ressources naturelles rares cède la place « à une économie d’abondance » (abondance
d’informations et de moyens de communication). La richesse est donc la transformation
de laconnaissance en une innovation créatrice.
La transparence et l’ouverture constituent les atouts majeurs de l’agent économique, qu’il
soit Etat, entreprise, ménage, ou simple individu. Les marchés exigent une culture
d’ouverture et de transparence. Le secret des affaires et de la chasse gardée de tel ou tel
domaine ne garantit plus le succès de l’entreprise. L’ère de l’économie numérique exige
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%