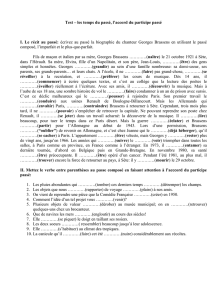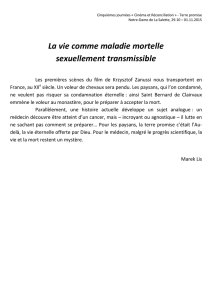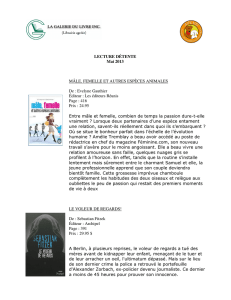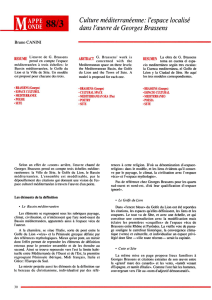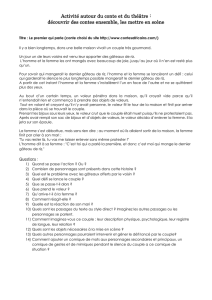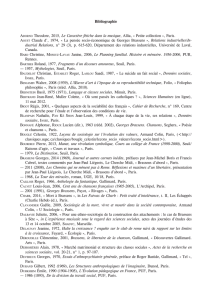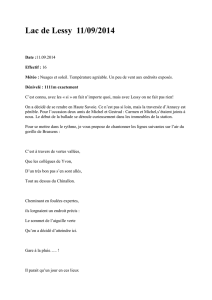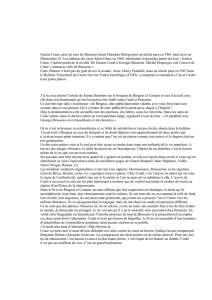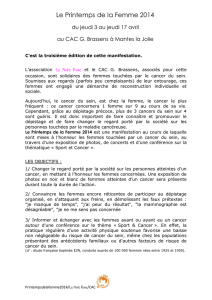Brassens, Stances pour un cambrioleur

Brassens,
Stances à un cambrioleur
INTRODUCTION : L’inspiration poétique de Brassens va très peu vers le fait divers,
c’est pourquoi
Stances à un cambrioleur
fait exception dans la production du
chanteur. Mais il s’agit davantage pour lui d’évoquer ses sentiments face à la
malhonnêteté que de raconter un événement qui le touche de près : le cambriolage
de sa propre maison de Crespières. Sentiments paradoxaux puisqu’ils mettent en
valeur le cambrioleur d’une manière distanciée et inattendue.
PREMIER AXE : UNE VALORISATION DU HORS LA LOI
Brassens, en véritable humaniste, met au cœur de son texte la notion de pardon.
Il évoque avec amusement les raisons qui le poussent à pardonner : on en compte
quatre (choisir sa maison, fermer la porte après le vol, dérober le strict nécessaire,
respecter l’outil du travailleur). Il s’agit donc presque d’un texte argumentatif qui
relève les causes d’une telle charité. Mais le ton général du texte nous indique aussi
que Brassens a décidé de faire de son cambrioleur un héros, ou plus exactement un
homme de valeur.
La première strophe débute par « Prince des monte-en-l’air », ce qui ressemble au
terme qui se trouve à la fin des ballades du moyen age : c’est une sorte d’envoi
qui entame le dialogue. C’est aussi le premier terme d’une liste d’expressions
valorisantes. Il existe donc, étrangement, un champ lexical de l’hommage : « en
ton honneur » (vers 4), « j’apprécie » (vers 5), « charme » (vers 31), « bon
souvenir » (vers 32), « meilleures mains » (vers 20). Brassens fait même une
distinction entre le voleur et le rôdeur (dans la 2e strophe) qui laisse supposer que le
voleur exerce un art, alors que le rôdeur est un homme malfaisant. L’association vol
– art apparaît nettement à la fin du poème, dans le post-scriptum. Il est amplifié par
deux termes laudatifs : « vocation » et « talent », ce qui renforce l’hommage. Bien
sûr, cet hommage est à la fois ironique et sincère. Ironique parce que Brassens
évoque le désagrément d’être volé (« ne te crois pas du tout tenu de revenir » au
vers 30) et c’est avec le décalage du second degré qu’il faut appréhender cet
hommage : le but de Brassens est de faire sourire. Mais il est aussi sincère, car
Brassens a toujours été un amoureux des humbles et des nécessiteux, un homme
sensible au monde des gueux, comme le montre beaucoup de ses chansons.
La valorisation se poursuit par deux symboles et une absence.
Les deux symboles sont les deux butins délaissés : le portrait offert à son
anniversaire (qui permet au chanteur d’évoquer le voleur comme un homme de
goût : il met entre virgules un mot frappant « dédaigneux ») et la guitare (qui lui
permet d’exprimer sa reconnaissance). Notons que chez Brassens les deux valeurs
auxquelles il ne faut pas toucher se résument souvent par sa guitare et ses chats.
Une absence est frappante aussi dans ce texte : le lecteur ne sait pas ce que le
voleur a dérobé. L’allusion au strict nécessaire est la seule piste qu’il peut avoir. Ce
« trou » dans la narration est évocateur de l’esprit anarchiste de Brassens, très peu
tourné vers une conception matérialiste de la vie (il ne regrette aucun objet volé).
Sur le plan rhétorique, on s’aperçoit aussi que la valorisation du voleur et du vol
s’accompagne d’une dévalorisation du poète, c’est-à-dire du narrateur, c’est-à-
dire de Brassens lui-même. Un champ lexical assez frappant apparaît : « gaudrioles »
(plaisanteries grivoises), « chansonnettes » (avec le suffixe diminutif), le verbe

« colporter » (qui évoque le transport de marchandises pour les vendre) et le mot
« artisanat » (qui pour Brassens définit sa production poétique). Ces termes donnent
une image modeste du statut de chanteur (c’est-à-dire un brave voyageur qui
vend ses chansons) et renforce par opposition le statut du voleur (c’est le hors-la loi,
l’homme qui prend des risques : nous avons 3 mots qui les signalent :
« gendarmes », « prison », « flics »).
Enfin, on se rend compte que Brassens se souvient certainement des histoires
policières de la littérature populaire (type Arsène Lupin) qui met, avec panache et
légèreté, la sympathie du côté du hors-la-loi.
DEUXIEME AXE : UNE COMPLICITE PARADOXALE
Tout d’abord, la chanson prend la forme d’une lettre. En témoigne le « Post-
scriptum » de la fin. Ce texte a donc un destinataire concret et privilégié. On
note par exemple au vers 21, l’expression « moi qui te parle » qui installe un lien
direct et unique. Le lecteur semble absent des préoccupations du poète. Le registre
est lyrique : Brassens confie ses sentiments à la première personne. On peut noter
deux phases dans ses réactions : un implicite ressentiment traduit par une réflexion
sur l’acte comme l’indique l’expression « mûr examen » (vers 18), puis la générosité
du pardon que nous avons déjà évoqué et qui va jusqu’à l’imploration à Mercure (le
dieu des voleurs, au vers ).
La familiarité avec le voleur est exprimé par les possessifs « mon » et la
gradation ascendante vers la complicité que nous voyons tout au long du poème :
« mon salaud » (qui peut être considéré comme un hypocoristique, au vers 12),
« mon vieux » (vers 19), « mon ami » (vers 33). Cette familiarité s’installe aussi
grâce à une série de conseils. Le paradoxe ici consiste à imaginer l’homme volé qui
souhaite à son voleur de faire un bon usage de son larcin (« que mon bien te
profite », vers 33). Examinons les deux conseils les plus saillants :
le premier évoque les difficultés du marchandage. Le voleur peut être la victime
des receleurs. Il s’agit pour Brassens de mettre en garde son ami.
Le deuxième conseil prend la forme d’une provocation (« mets toi dans les
affaires » au vers 39) puisque Brassens fait un amalgame entre le voleur et l’homme
d’affaire. L’homme d’affaire étant un voleur à grande échelle. Les amis de Brassens
avaient d’ailleurs averti le chanteur que cette dernière strophe était trop polémique
ou trop satirique pour être conservée. Brassens a donc souhaité, en la conservant,
mettre en valeur un message provocateur, une critique sociale.
Mais l’aspect le plus paradoxal de ce texte tient dans une fiction à forme
hypothétique (introduite par « si ») au vers 22. La complicité des deux hommes
n’est pas que factuelle, elle délivre un message moral. Brassens évoque la fragile
frontière entre le bien et le mal, et il fait naître une seconde complicité : celle qui unit
deux malfaiteurs virtuels dans l’exercice de leur art. Brassens montre avec brio, dans
une question rhétorique frappante (« qui sait ? »), que chaque homme peut être
amené par les circonstances (voir le verbe « rencontrer ») à côtoyer le mal. Le voleur
est peut-être un poète qui a mal tourné. Le message moral met donc le chanteur
célèbre et le voleur inconnu à égalité.
Enfin, cette chanson est une manière de faire payer à son voleur un tribut : ils sont
quittes parce que le poète a fait acte de création (vers 36). En écrivant une
chanson, Brassens rétablit l’équilibre. C’est aussi un moyen simple de dépasser
le malaise du vol, de ne plus se sentir lésé (une sorte de thérapie artistique)...

CONCLUSION : En écoutant la musique qui accompagne le texte, on s’aperçoit d’une
double intention du poète : créer une réaction paradoxale de complicité avec le
voleur (l’air de guitare) mais aussi délivrer des messages moraux plus graves, plus
essentiels (l’air lancinant de contrebasse). C’est pourtant le premier aspect de ce
texte qui étonne le lecteur car c’est avec la distance du sage que Brassens s’amuse à
faire de son voleur un brave type...
1
/
3
100%