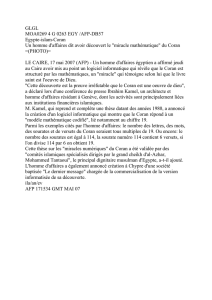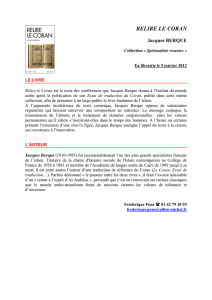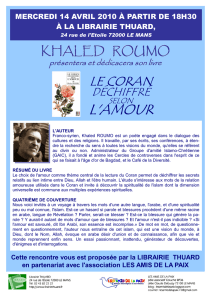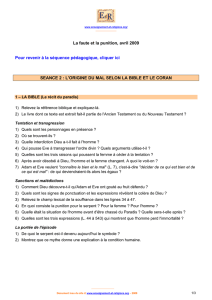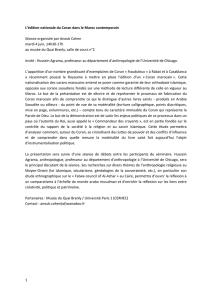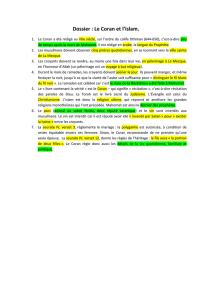Les traductions du Coran. P. Borrmans

1
1
Les traductions françaises du Coran : présentation et évaluation
A la différence des juifs de la diaspora égyptienne au temps des Ptolémées qui traduisirent la Bible
(l’Ancien Testament) en grec (la fameuse traduction dite des Septante)
1
et à la différence des
chrétiens qui, très vite, transmirent le message évangélique dans toutes les langues des pays et des
cultures où la « bonne nouvelle » avait à être proposée, le monde musulman s’est refusé, pendant
longtemps, à accepter ou à entreprendre des traductions du Coran en d’autres langues (qu’il suffise
de se rappeler le débat instauré dans le Tafsîr al-Manâr sur la licéité de sa traduction en turc, il y a
moins d’un siècle !)
2
. Le mérite revient aux occidentaux, et donc à des non musulmans, d’en avoir
entrepris la traduction d’abord en latin
3
, puis dans les diverses langues européennes, et cela depuis
plusieurs siècles. Il s’avère qu’aujourd’hui abondent également les éditions du Coran accompagnées
de « la traduction de ses significations » assurées par des musulmans qui ont pris conscience que la
majeure partie de leurs coreligionnaires dans le monde ne maîtrisent pas la connaissance de la
langue arabe. Et c’est le mérite du Professeur indien Muhammad Hamidullah de fournir une liste
exhaustive de toutes les traductions existantes dans la nouvelle édition bilingue de sa traduction Le
Saint Coran de 1989
4
.
Chacun sait que, depuis sa création en 1984, le Complexe du Roi Fahd, à Médine (Arabie saoudite),
imprime et diffuse des millions d’exemplaires du muṣḥaf bilingue en toutes langues actuellement
pratiquées dans le monde entier. Notre propos est donc d’établir un premier bilan des traductions du
Coran en français pour ensuite en faire une évaluation où seront évoqués tour à tour les problèmes
spécifiques de cette traduction de l’arabe au français, les difficultés singulières que soulève la
compréhension des hapax, les choix nécessaires que suppose la traduction des termes
christologiques et les inévitables ambiguïtés que suscite le passage d’une langue à une autre. Avant
de conclure, on suggérera alors de recourir à ce que nous appelons la symphonie interprétative des
multiples versions du texte ainsi traduit.
Quelles sont actuellement les traductions françaises du Coran les plus connues ?
- La 1ère traduction française du Coran fut réalisée par le Sieur du Ryer en 1647, L’Alcoran de
Mahomet.
- Puis il y eut celle de Claude Etienne Savary, Le Koran, en 1783 ;
1
Tout est dit de cette traduction de la Bible (Ancien Testament) en grec par Alexis Leonas dans son étude
L’aube des traducteurs. De l’hébreu au grec : traducteurs et lecteurs de la Bible des Septante (IIIème s. av. J.-
C.- IVème s. apr. J.C.), Paris, Cerf, 2007, 239 p.
2
Cf. ce qu’en dit Jacques Jomier aux pages 338-347 de son livre Le commentaire coranique du Manâr
(tendances modernes de l’exégèse coranique en Egypte), Paris, G.-P. Maisonneuve, 1954, 363 p.
3
La première traduction du Coran en latin fut réalisée à Tolède, vers 1150, sur l’initiative de Pierre de Cluny
(1094-1156), par Robert de Ketton aidé de Muhammad, un musulman engagé par ce même Pierre, afin que la
traduction soit assurée « avec la plus grande fidélité et que rien ne soit omis par dissimulation ».
4
Le Saint Coran, traduction et commentaire de Muhammad Hamidullah avec la collaboration de M. Léturmy,
Société Al Rajhi pour le commerce et l’industrie, Amana Corporation, Maryland 20722, U.S.A., 1989, arabe,
604 p. ; français, 619 p. Cette liste des traductions du Coran en langues européennes s’y trouve aux pp. XLI-
LXXXIX. La 1ère traduction du Pr Md Hamidullah fut publiée en 1959. Depuis lors, elle a connu de multiples
remaniements et de nombreuses éditions.

2
2
- celle d’Albert de Biberstein Kasimirski, Le Koran, en 1840
5
;
- celle de Fatma-Zaïda, L’Alkoran, en 1861 ( ?) ;
- celle d’Edouard Montet, Le Coran, en 1925 ;
- celle d’Ahmed Laimèche et B. Ben Daoud, Le Coran, lecture par excellence, en 1931 ;
- celle d’O. Pesle et Ahmed Tidjani, Le Coran, en 1946 ;
- celle de Régis Blachère, Le Coran, en 1945-1951
6
et 1957
7
;
- celle de Denise Masson, Le Coran, en 1967
8
; celle de Si Hamza Boubakeur, Le Coran, en
1972
9
;
- celle de Jean Grosjean, Le Coran, en 1979
10
;
- celle de Sadok Mazigh, Le Coran, en 1985
11
;
- celle de Jacques Berque, Le Coran, en 1990
12
;
- celle de René R. Khawam, Le Qoran, en 1990
13
;
- celle d’André Chouraqui, Le Coran, en 1990
14
;
- celle de Mohammed Chiadmi, Le Noble Coran, en 2004
15
,
- celle de Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh, Le Coran, en 2008
16
- et celle de Malek Chebel, Le Coran, en 2009, doublée d’un Dictionnaire encyclopédique du
Coran. Ce ne sont là que les traductions les plus importantes : on sait que nombreux ont été
5
Elle a été souvent reprise, étant devenue un « classique » du genre. On a utilisé l’édition de 1970, Garnier-
Flammarion, avec une introduction de Mohammed Arkoun, intitulée « Comment lire le coran ? » (pp. 11-36).
6
En trois volumes, les sourates étant re-classées selon l’ordre chronologique.
7
Les sourates étant remises dans leur ordre habituel.
8
En 1967, il n’y a que la traduction française, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, Ed. Gallimard, 1087 p.. C’est en
1975 qu’en est publiée l’édition bilingue, par Dar al-kitab allubnani, à Beyrouth, avec en sous-titre Essai
d’interprétation du Coran inimitable, la traduction ayant été révisée par le shaykh Dr. Sobhi El-Saleh, 833 p.
arabe, 892 et LXIV p. français.
9
Le Coran (traduction nouvelle et commentaires), Paris, Fayard-Denoël, 1972, 2 vol.
10
Le Coran (traduction, précédée d’une étude de Jacques Berque), Paris, Philippe Lebaud, 1979.
11
Le Coran (essai d’interprétation du Coran inimitable), Paris, Ed. du Jaguar, 1985.
12
Le Coran (essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude exégétique), Paris, Ed. Sindbad, 1990, 840
p.
13
Le Qoran (traduction sur la Vulgate arabe), Paris, Maisonneuve et Larose, 1990, 441 p.
14
Le Coran (L’appel), Paris, Robert Laffont, 1990.
15
Le Noble Coran (nouvelle traduction du sens de ses versets), Lyon, Tawhid, 2004 (arabe, 604 p.; français,
760 p.)
16
Avec, en sous-titre, texte arabe et traduction française par ordre chronologique selon l’Azhar avec renvoi aux
variantes, aux abrogations et aux écrits juifs et chrétiens, Vevey (Suisse), Ed. de l’Aire, 2008, 579 p. Une
recension très positive en a été faite par Michel Lagarde in Islamochristiana, Roma, PISAI, 34 (2008), pp. 287-
289.

3
3
les ouvrages qui se sont contentés d’être une « anthologie de morceaux choisis » et le
Professeur Md Hamidullah les cite tous. Très longtemps, la seule traduction française était
alors publiée, enrichie parfois d’une « vie de Mahomet » et d‘une « présentation de l’islam ».
L’habitude s’est imposée à partir de 1975 d’éditer, en vis-à-vis, le texte arabe du Coran et sa
traduction française, et c’est bien ce qu’a fait le Complexe du Roi Fahd en éditant Le Saint
Coran et la traduction en langue française du sens de ses versets, « sous l’égide du Ministère
du ‘Hajj et des Waqf’ du Royaume d’Arabie Séoudite », en 1410/1989
17
. Comme on peut le
constater grâce à cette liste, ce n’est que tout récemment que s’est développée l’habitude
d’éditer la traduction vis-à-vis du texte arabe d’origine, page par page, ce qui assure à ces
ouvrages une marque d’orthodoxie : on n’en traduit que les « signifiés » (les ma‘ânî). Rares
sont les traducteurs qui, dans une introduction toute personnelle, s’expliquent sur la
méthode par eux adoptée, les sources par eux consultées et les traductions antécédentes par
eux explorées. Une étude serait à faire qui consisterait à regrouper par familles ces diverses
traductions qui, très souvent, sont débitrices les unes des autres, tout comme certaines, les
plus anciennes, ont largement utilisé l’excellente traduction du Coran en latin réalisée à
Rome, au XVIIème siècle, par Ludovico Marracci
18
, et publiée en arabe et en latin à Padoue,
en 1698.On utilisera certaines des traductions ici signalées quand il s’agira, plus loin, de faire
du comparatisme entre traducteurs
19
.
Quelles sont les difficultés rencontrées et quels sont les mérites des traducteurs ?
Une bonne connaissance de la langue et de la culture, tant du côté arabe que du côté français, fait
bien vite apparaître un ensemble de difficultés qui obligent le traducteur à faire des choix qui ne sont
pas sans importance. S’agissant de la segmentation du texte, le système de ponctuation du français
exige qu’on introduise celle-ci dans un texte arabe qui l’ignore, d’où bien des problèmes
d’interprétation : où mettre les points (d’affirmation, d’interrogation ou d‘exclamation), les points
virgules et les virgules, les deux points et guillemets introduisant et encadrant les citations, sans
17
Plus exactement sous l’égide de « La Présidence Générale des Directions des Recherches Scientifiques
Islamiques, de l’Iftâ’, de la Prédication et de l’Orientation Religieuse », Médine, en 1410 de l’hégire (arabe, 604
p. ; français, 604 p.). Une 1ère Commission « avait suggéré que la traduction du Saint Coran réalisée par le
Professeur Muhammad Hamidullah devait être retenue en raison de sa clarté et de sa fidélité très proche du Texte
sacré », mais, par la suite, elle a procédé à une révision approfondie de la traduction ». Il en fut de même,
ensuite, par une 2ème Commission, puis une 3ème, et enfin une 4ème chargée « de réviser toutes les notes
explicatives pour les purifier de toutes les erreurs aux questions ayant trait au dogme et aux opinions juridico-
philosophiques ». Elle décida de maintenir dans le texte français les termes Allah, Islâm, as-Salât, az-Zakât, as-
Siyyâm (sic), al-Hajj, al-Imâne (sic).
18
Cf. Maurice Borrmans, « Ludovico Marracci et sa traduction latine du Coran », in Islamochristiana, PISAI,
Roma, 28 (2002), pp. 73-86. C’est en même temps l’une des premières tentatives réussies d’« imprimer » le texte
coranique avec des caractères arabes. Pendant longtemps (jusqu’au début du XXème siècle, semble-t-il) les
éditeurs arabo-musulmans utiliseront la lithographie pour reproduire le texte arabe du Coran. Cf. Maurice
Borrmans, « Observations à propos de la première édition arabe imprimée du Coran à Venise », in Quaderni di
Studi Arabi, Venezia, 8 (1990), pp. 3-12 et « Présentation de la première édition imprimée arabe du Coran à
Venise », in Quaderni di Studi Arabi, Venezia, 9 (1991), pp. 93-126).
19
Du côté anglais, signalons simplement les plus importantes traductions, celle d’Alexander Ross, The Alcoran
of Mahomet en 1648 ; celle de George Sale, The Koran, en 1734 ; celle de Marmaduke William Muhammad
Pickthall, Meaning of the Glorious Koran, en 1930 ; celle d’Abdullah Yusuf Ali, The Illustrious Qur’an, en
1935 ; celle de Richard Bell, The Quran, en 1937-1939
19
; et celle d’Arthur John Arberry, The Quran
Interpreted, en 1955.

4
4
parler des tirés et des parenthèses parfois nécessaires à ces dernières ? Comment repérer les
phrases elles-mêmes, et les propositions principales et subordonnées ? Faut-il diviser le texte-source
en unités littéraires ou péricopes, avec sous-titres ajoutés (comme le font le professeur Blachère
dans sa traduction et certains mufassirûn dans leurs commentaires) ? Problèmes sans fin qui
supposent une interprétation conforme à une certaine analyse logique du texte mais en fonction de
quelles règles rhétoriques (grecques ou sémitiques) ? Qui plus est, l’écriture arabe ne connaît pas de
majuscule, tandis que le français l’exige pour tout nom propre (ism ‘alam) de personne ou de lieu,
d’autant plus qu’un nom commun (ism ǧins) le requiert parfois, lorsqu’il est pris dans un sens
spécifique. Quant à l’expression du temps, les langues sémitiques, seulement soucieuse de l’accompli
et de l’inaccompli, n’ont pas toutes les nuances du passé simple, du passé composé, du passé
antérieur, de l’imparfait et du plus que parfait de la langue française, d’où une marge de liberté qui
n’est pas sans poser bien des problèmes au traducteur. Une telle entreprise suppose donc une
compréhension exacte du texte dans « ce qu’il doit signifier, ce qu’il peut signifier, ce qu’il veut
signifier », et ce sont là des nuances d’importance. C’est pourquoi tout traducteur honnête se doit
d’interroger les divers commentaires qu’ont faits du texte-source ceux qui en pratiquent la langue et
en ont médité le contenu. C’est bien là ce qu’ont fait les divers traducteurs du Coran dont on a
signalé les noms, d’où leurs mérites incontestables, même si l’on peut légitimement critiquer le
résultat auquel ils sont parvenus. D’autant plus qu’une autre question se pose en toute traduction
d’un texte sacré : celle-ci est-elle destinée à être seulement lue avec les yeux, individuellement, ou
bien a-t-elle vocation à être proclamée oralement au sein d‘une communauté ? Les mots et le style
ne dépendent-ils pas étroitement de ce choix préalable ? Qui plus est, quand on sait qu’à l’origine le
texte-message fut d’abord proposé oralement avant d ‘être ensuite mis par écrit, comment alors
reproduire son « oralité » ? Une dernière question se pose enfin : faut-il adopter un vocabulaire
religieux avec lequel le destinataire francophone est habitué, au risque de « christianiser » la
traduction, ou bien faut-il s’en tenir à un vocabulaire dépouillé de toute connotation religieuse, au
risque, alors, de le « laïciser » outre mesure ? C’est ainsi que certaines traductions du Coran
préfèrent utiliser le terme Allâh au lieu du vocable Dieu qui lui correspond en français, afin de bien
souligner la différence qui existe entre Bible et Coran.
Comment résoudre le problème ardu de la traduction des hapax ?
Si tout traducteur s’efforce d’être personnellement fidèle au glossaire qu’il s’est fixé de manière à
toujours traduire de la même façon les mots-clés du texte-source grâce aux divers contextes où il les
retrouve très souvent, il n’en est pas de même dans le cas des hapax coraniques, de ces termes qui
n’y apparaissent d’une seule fois. Comment les comprendre alors et en assurer une juste traduction ?
Qu’il suffise d’en évoquer trois cas, pour faire bref.
Il y a d’abord ce très beau nom d’al-Ṣamad de la sourate 112, 1-2 : Qul : Huwa Lhâhu aḥad, Allâhu l-
Ṣamad. « Dis : ‘Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons’ », selon la
traduction-paraphrase de Médine. Hamidullah et Mazigh traduisent : « Dis : ‘Lui, Dieu, est unique,
Dieu l’Absolu’ », Boubakeur leur préfère : « Dieu, l’Imploré » et Chiadmi interprète : « Dis : ‘C’est Lui,
Dieu l’Unique, Dieu le Suprême Refuge’ », tandis que Blachère propose : « Dis : ‘Il est Allah, unique,
Allah le Seul’ », que D. Masson traduit : « Dis : ‘Lui, Dieu est Un ! Dieu ! L’Impénétrable’ » et que
Kasimirski disait : « Dis : ‘Dis : Dieu est un. C’est le Dieu éternel ». Bien d’autres traductions

5
5
ajouteraient à cette richesse sémantique de ce très beau nom qui donne à l’affirmation du pur
monothéisme toute sa grandeur, car il s‘agit bien du « Dieu de plénitude » comme traduit J. Berque.
Il y a ensuite le terme mystérieux de ṣibġa, deux fois répété dans un même verset de la sourate 2,
138 : Ṣibġata Llâhi wa-man aḥsanu min Allâhi ṣibġatan ? « A la couleur de Dieu ! Et qui est plus que
Dieu beau en couleur ? » traduit Hamidullah, tandis que Médine lit : « Nous suivons la religion
d’Allah ! Et qui est meilleur qu’Allah en Sa religion ? », que Mazigh traduit : « Onction de Dieu ! Mais
qui saurait donner meilleure onction, sinon Dieu Lui-même ! », et que Chiadmi préfère dire :
« Baptême de Dieu ! Qui donc peut donner le baptême mieux que Dieu lui-même ? ». Boubakeur fait
le même choix : « Baptême de Dieu ! Qui peut donc administrer le baptême hormis Dieu lui-
même ? ». Pour Blachère, il faut lire : « Onction ( ?) d’Allah ! Qui donc est meilleur qu’Allah en [Son]
onction ? », pour D. Masson : « L’Onction de Dieu ! Qui peut, mieux que Dieu, donner cette
onction ? » et pour J. Berque : « Une teinture de Dieu ! Mais qui peut mieux teindre que Dieu ? »,
alors que Kasimirski disait : « C’est une confirmation de la part de Dieu ; et qui est plus capable de
donner une confirmation que Dieu ? ». Qui ne voit alors qu’il s’agit bien là d’un terme d’origine
syriaque qui fait allusion au baptême-confirmation des chrétiens ?
Il y a enfin le terme qirṭâs de la sourate 6, au singulier au verset 7, wa-law nazzal-nâ ‘alay-ka kitâban
fî qirṭas et au pluriel au verset 91, Qul man anzala l-kitâba llaḏî ǧâ’a bi-hi Mûsâ nûran wa-hudan li-l-
nâsi taǧ‘alûna-hu qarâṭîs. Pour Hamidullah, il s’agit d’ « un Livre de papier… que vous mettez en
pages », à Médine on lit : « un Livre en papier… Vous le mettez en feuillets » (le papier existait-il
alors ?), avec Boubakeur on comprend : « un livre (contenant ma révélation, écrite entièrement) sur
un feuillet… vous l’écrivez sur des rouleaux de parchemin », selon Mazigh il faut comprendre : « un
vrai livre écrit sur parchemin… (et) quelques fragments transcrits sur des feuillets » et Chiadmi
traduit : « un Livre écrit sur parchemin… que vous écrivez sur des feuillets ». Blachère y comprend :
« une Ecriture [contenue] dans un [rouleau] de parchemin… vous le mettez en [rouleaux]
parchemin ». D. Masson y lit : « un Livre écrit sur un parchemin… vous L’écrivez sur des parchemins »
et J. Berque interprète : « un Ecrit sur une feuille… vous le réduisez à des rouleaux (que vous
exhibez) », alors qu’on lisait dans Kasimirski : « le livre en feuillets… ce livre que vous écrivez sur des
feuillets ». Tous les traducteurs se trouvent ainsi devant des difficultés insurmontables quand les
termes à traduire ne se présentent qu’une seule fois dans le livre à transposer dans une autre langue.
Quel choix nécessite l’approche différenciée des termes christologiques ?
Mais lorsque le terme à traduire se présente très souvent ou exprime une réalité d’importance, un
choix s’avère nécessaire que le traducteur se doit d’assumer. C’est déjà le cas de la formule qui
introduit toutes les sourates sauf la 9ème : le bi-smi Llâhi r-Raḥmâni r-raḥîm ne se voit-il pas traduit de
trop nombreuses manières ? Et que dire du terme Kitâb ou al-Kitâb dont l’occurrence est si
fréquente dans le Coran (12 fois sans l’article, 230 fois avec l’article) qui s’y trouve traduit « le
Livre », « l’Ecrit », « l’Ecriture » ou « le Coran » suivant les contextes ? Et s’agissant du vocable
Naṣârâ (14 occurrences), très souvent traduit par « chrétiens », comment s’expliquer qu’Hamidullah
et Boubakeur le traduisent toujours par « nazaréens », ainsi que la traduction de Médine dans
certains cas (2, 62 ; 22, 17) ? Qu’en est-il alors des termes qui désignent Jésus dans le Coran et
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%