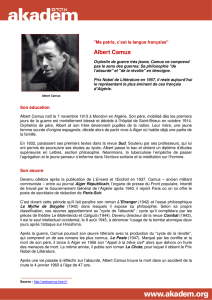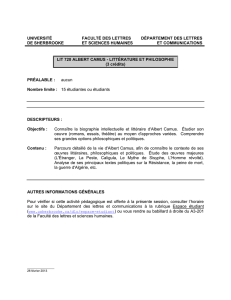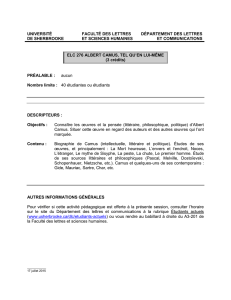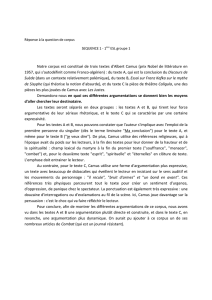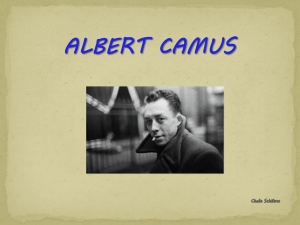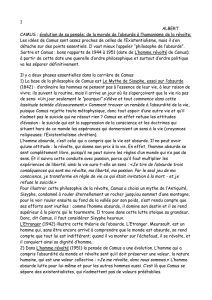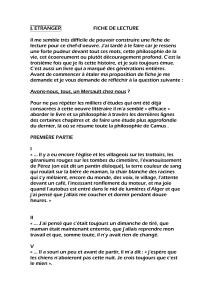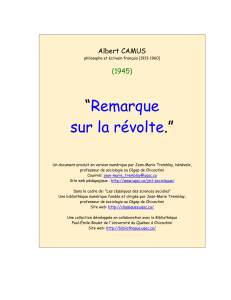En quoi penser est-ce se mettre en danger

1
En quoi penser est-ce dangereux ?
Oh la surprenante question que voilà ! Il n’est pas habituel me semble-t-il de
présenter la pensée comme l’occasion d’un péril pour soi même et les autres. En effet, on
aurait plutôt coutume de mettre en avant le cogito, de promouvoir l’activité qui consiste à
penser, de l’entraîner, de la susciter, de la favoriser (notamment dans cette maison de
quartier !) mais certainement pas de s’en prémunir ! C’est dire que la possibilité d’une mise
en danger n’est pas la première réflexion qui vienne à l’esprit de celui qui se décide à penser.
Au contraire, toute notre culture tend à faire croire que l’exercice de la pensée, reconnu pour
être un exercice difficile, laborieux, nécessitant rigueur et méthode, reste, quoiqu’on en dise
un exercice payant. Payant au sens de rémunérateur : j’obtiens un gain en pensant, gain que je
n’obtiens pas en m’en abstenant. Penser, c’est du bonus ! Alors, qu’est-ce donc que cette
histoire de malus et de mise en danger ? Comment concevoir le paradoxe d’une activité
rémunératrice promesse de banqueroute ?
Pour débuter notre réflexion, il n’est pas inutile d’éliminer une proposition juste
mais que nous survolerons dans le cas présent. Ainsi, chacun songera aux intellectuels
persécutés par les différents régimes autoritaires, aux penseurs résistants traqués par les
dictatures et dont les œuvres brûlèrent dans des feux de haine et de bêtise. Penser, dans
certaines circonstances est un véritable acte de bravoure, de courage, de mise en danger de sa
personne. Nous laisserons pour le moment de côté ce type de péril en tirant notre chapeau à
celles et ceux qui acceptent de le courir et en considérant que, peut-être, à la faveur de ces
circonstances qui font l’histoire et les héros, nous serons ou pas de ceux-là.
En l’occurrence, le péril dont il s’agira pour nous ce soir est d’ordre plus radical
puisqu’il découle de la manière la plus naturelle qui soit de cette activité proprement humaine
qu’est « penser », une activité qui entretient toujours un rapport tangentiel à la folie. Pour bien
saisir cette activité spécifique, cette infinitif qu’est « penser », cet infini pour l’homme
dirions-nous, encore faut-il qu’il soit défini.
Peut-être pourrait-on commencer par dire ce que penser n’est pas ou ne sera pas
pour nous ce soir. Ainsi, penser ne sera pas réductible au simple produit d’activité du viscère
cérébral. Si un électroencéphalogramme plat est indiscutablement le signe que penser est une
affaire compromise, l’existence d’un tracé normal n’est pas suffisante pour attester que sous
les électrodes il y a un sujet en train de penser.
Penser ne sera pas non plus la somme des fonctions intellectuelles huilées et
emboîtées les unes aux autres, mises au service de l’assouvissement des besoins de chacun.
Prenons un exemple. Moi vouloir femme. Moi mettre parfum, moi me souvenir que parfum
utile, moi sortir, m’orienter, chercher boîte de nuit. Moi repérer joli dame. Moi éduqué, reçu
instructions. Moi souvenir quoi bien, quoi mal. Donc, moi pas sauter sur la madame. Moi
attentif, parler d’abord. Moi dire à elle gentilles choses. Moi content car dame m’emmène
chez elle…. Arrêtons là ce récit bucolique, fleuri et captivant dans lequel chacun aura reconnu
cette faim printanière de prédateur qui nous pousse à mettre la pensée dans ce qu’elle a de
plus nécessaire au service de nos appétits les plus pressants, ici sexuels. Cette forme de pensée,
commune à l’homme et l’animal, ressorti d’une conscience immédiate du monde extérieur et
de ses propres besoins. Ce sentiment de soi et du monde qui ne distingue pas l’homme de la

2
bête est radicalement différent de la conscience de soi qui hisse l’homme au dessus du reste
du vivant pour son plus grand malheur ou son plus grand bonheur ; c’est selon.
L’infinitif penser ne sera pas réductible au seul sentiment de soi mais précisément,
penser pourra s’envisager dès l’instant précis où quelque chose de soi se saisit lui-même en
tant que sujet connaissant et objet de connaissance. C’est donc à l’aube de la conscience de
soi que débute la possibilité de penser, que l’humanité mérite d’être remarquée puisqu’en
deçà règne le vivant dans son décor naturel et son plus simple appareil. Du reste, voici la
convention rassurante qui nous est classiquement proposé.
Mais que reste-t-il de cette convention qui sépare l’humanité de l’animalité à la lueur
des événements passés ? Qu’est l’homme devenu à force de cultiver cette conscience de soi, à
force de penser et de se penser dans l’ordre de l’univers ? Le fossé qui nous sépare de
l’animal s’est-il élargi ? L’homme s’est-il arraché à cette condition cruelle, sauvage et
terrestre pour se hisser, grâce à cette conscience de lui-même, dans des cieux confortables et
protecteurs ?
Celui qui répondrait affirmativement à cette question passerait pour un fou ou un
naïf. Car comment comprendre que l’homme occidental, au fur et à mesure qu’il se pense,
que s’aiguise une conscience pensant sa condition, comment se peut-il que cet homme là
puisse engendrer dans son sillage autant de crimes et de génocides ? Le nazisme, le stalinisme,
ou, plus loin de nous, la Terreur révolutionnaire constituent des entreprises criminelles
éclairées, pensées, méditées, préméditées. Chaque crime commis constitue un démenti formel
à cette convention que nous rappelions à l’instant : loin d’éloigner la bête de l’homme, penser
semble la rameuter. C’est pourquoi sur la tombe de l’homme du 20ème siècle on aurait pu
graver : ci gît la bête. Mais quelle épitaphe pour l’homme du siècle à venir, épitaphe qui
démentira cette vérité orwellienne qui veut que les intellectuels soient portés au totalitarisme
bien plus que les gens ordinaires?
Ecoutons Camus (qui nous sera d’une aide précieuse ce soir) dans L’homme révolté :
il y a des crimes de passion nous dit-il, mais surtout des crimes de logique. Nazisme,
stalinisme, Terreur appartiennent tous à la seconde catégorie, la catégorie des crimes logiques
qu’autorise l’infinitif penser, catégorie de crimes qui n’auraient pas pu être perpétrés
justement sans le recours à un penser meurtrier. Ces crimes sont bien l’aboutissement d’une
réflexion, la consécration d’une raison achevée dans le crime qui, sûre d’elle-même, s’autorise
à accomplir le mal au nom d’un souverain bien. Bien sûr, la question du mal sera centrale
dans le débat de ce soir. Si le mal rôde avant tout dans l’univers éthéré de la conscience, alors
la simple idée d’un penser innocent ne devient-elle pas suspecte ? N’y a-t-il pas là un piège
dangereux à éviter ?
Et si donc penser ne saurait-être une affaire innocente (le crime de penser n’entraîne
pas la mort écrit Orwell qui relie pensée et crime), comment s’assurer que le fruit de notre
travail ne sera pas une arme au service de mobiles que condamneront nos enfants?
Il faut s’arrêter un instant sur l’œuvre de Camus, dont nous célébrons le 50ème
anniversaire de sa mort, et lui reconnaître la justesse avec laquelle il instruit le procès de la
raison. Ce procès est entrepris en réponse à l’absurdité de goulags érigés au nom de la
libération du genre humain, en écho « aux massacres justifiés par l’amour de l’homme ou le
goût de la surhumanité ». Pour comprendre comment l’infinitif penser, propre à l’homme,
peut dangereusement dériver il faut partir de cette conscience de soi et de la révolte qui lui est

3
consubstantielle. Un homme révolté nous dit Camus, c’est un homme qui dit non. Et,
précisément, penser c’est dire non. Mais, dans le même temps où il refuse la condition dans
laquelle il se trouve, l’homme, par ce refus affirme l’existence d’une frontière, d’un horizon,
une valeur qui vaut la peine de protester, de ne pas en rester là. Penser, se révolter ne
consistent pas seulement en un refus de ce qui est, c’est aussi une affirmation de ce qui
manque et gagnerait à être, c’est le vœu formulé d’un préférable. Au moment où un
préférable est proclamé par le révolté, le révolté qui pense et objecte un non franc à l’ordre
des choses, un révolté qui conspue Dieu, qui de Spartacus à la classe ouvrière refuse de se
maintenir à la place que l’histoire lui assigne ; à partir de ce moment là, tout est prêt pour que
démarre une tragédie dont nous connaissons au moins la fureur des premiers actes mais dont
les ressorts nous échappent sauf à lire attentivement Camus et le critiquer. Cette tragédie est
l’expression directe d’une conscience humaine qui à force de penser, de se penser, s’égare
dangereusement semant des cadavres sur son chemin.
Soyons lapidaires : l’individu qui ne se pense pas, qui ne voit pas dans la condition
qui est la sienne matière à polémiquer et s’insurger, celui qui ne conçoit pas le caractère cruel
du sort qui lui est réservé, celui là est l’homme d’avant la révolte, l’homme qui se contente
d’être… D’être quoi ? Nous dirions d’être le jouet du destin ou, dans un monde où la
transcendance est liquidée, d’être la marionnette consentante des intérêts de plus puissants que
lui. Avec la révolte et la conscience qu’il a de lui-même apparait pour l’individu un horizon,
un préférable comme nous disions à l’instant, un lointain accessible qui fera de lui un
affranchi. Le sel de cette liberté à portée de conscience autorise alors le sacrifice. Camus nous
dit : « [L’esclave] accepte la déchéance dernière qui est la mort, s’il doit être privé de cette
consécration exclusive qu’il appellera, par exemple, sa liberté. Plutôt mourir debout que de
vivre à genoux. »
En acceptant le risque de mourir pour échapper à une condition qu’il refuse pour
l’avoir pensée, l’homme place au dessus de lui la révolte et les valeurs qui l’accompagnent. Il
accepte de jouer sa vie au nom d’une valeur commune à ceux qui, comme lui, prennent
conscience que les règles du jeu méritent d’être reconsidérées. Qu’on ne se méprenne pas : la
révolte n’est pas réductible à une lutte des classes car l’opprimé n’est pas le seul à se dresser.
Il est des dominants, des maîtres ou des patrons qui eux aussi refusent les règles d’un jeu qui
pourtant sert leurs intérêts immédiats. « S’ils refusent c’est par identification de destinées »
nous dit Camus. « Dans la révolte, l’homme se dépasse en autrui et, de ce point de vue, la
solidarité humaine est métaphysique » C’est ainsi que Camus postule, face à l’absurdité sur
laquelle bute l’infinitif penser, l’équivalent du cogito cartésien : « je me révolte donc nous
sommes. » Le je individuel s’articule au nous collectif.
Nous considérerons ce point essentiel de la pensée de Camus, point insoutenable
pour celui qui s’y trouve: penser c’est dans le même temps dire non et oui. Non à une
condition injuste vouée aux gémonies, oui à une nature commune à tous et des valeurs
consenties. Arrivés à ce point de notre introduction, et pour aborder le caractère dangereux du
penser humain, si vous êtes d’accord nous dirons ceci : penser dans un premier temps c’est
renoncer à l’innocence, c’est opposer un refus catégorique au mal métaphysique dont chacun
est injustement frappé ; puis dans un second temps penser c’est proposer des remèdes
terrestres à l’injustice du ciel ou de l’Histoire, c’est bâtir ici-bas un royaume des fins dont les
moyens seront à définir. Penser, dans ce temps d’après la prise de conscience, d’après la
révolte, devient le temps de choisir les moyens : jusqu’où irons-nous pour établir le royaume
des hommes sans Dieu ? A quels sacrifices devront nous consentir ? Quels moyens seront à
employer ?

4
Pourquoi le mot insoutenable trouve sa place ici ? Si l’infinitif penser livre à ses
pieds des hommes qui se soudent par la révolte devant la question de l’action nécessaire à
l’avènement du salut et de la liberté, aucune attitude contemplative ne sera permise permise:
« Tout spectateur est un lâche ou un traître » s’écrie Frantz Fanon dans Les damnés de la
terre. Il faut agir, une position doit être prise et quelque chose doit être tenté. « Il faut
compromettre tout le monde pour le salut commun » clame Fanon. On retrouve Marx, pour
qui il ne s’agit plus de se contenter de penser mais de transformer le monde. Aussi, reste à
définir la méthode : quelle philosophie de l’action sera possible qui ne soit pas un reniement
des principes même que découvre le révolté dans son cogito. Car c’est précisément cette
tension du « je me révolte » articulé à un « donc nous sommes » qui risque de devenir
difficile à soutenir dans une philosophie de l’action. Il faut, en quelques sortes, ménager la
chèvre et le chou, le je et le nous, le oui et le non que nous évoquions à l’instant. L’histoire
abonde de forfaits, dans lesquels nous constatons que, faute d’avoir respectée cette tension, la
révolte s’est niée dans ses fondements et a liquidé l’un ou l’autre de ses termes : « Je me
révolte n’importe comment donc nous ne sommes plus ». Le je du tyran écrase le nous
collectif ou encore le nous de la masse empêche le je de l’individu d’advenir.
Égrenons le chapelet de notre histoire : que trouvons-nous ? Nous y découvrons la
dangereuse question du mal déclinée sous toutes ses formes et des tentatives pour y répondre.
D’abord, en toile de fond il faut insister sur l’empreinte culturelle très forte du
christianisme. Le Christ, fils de Dieu, répond à la question du mal et de la mort qui frappe si
injustement les hommes. Par la souffrance qu’il assume au nom de tous et à la demande de
son Père, le Christ réconcilie la Terre et le Ciel comme nul autre avant lui. Les hommes
souffrent certes, mais les voilà entendus, ils ne sont plus seuls. Toutefois reste en suspend la
question de l’origine et de la nécessité du mal au sein de la Création, question chère à Ivan
Karamazov, qui faute de réponse, en bon mécréant, ôte au Créateur toute crédibilité.
Dieu est amour et la grâce au bout du chemin, nous dit-on. En attendant, une chose
est certaine : le Christ crucifié prononce cette dernière parole : « Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? ». A cet appel criant, à cet aveu déchirant la nuit, nul réponse lumineuse ne
parvient. Le christ meurt en homme : livré à l’angoisse, abandonné à lui même, sur la croix,
seule chose dont on soit assuré. Le royaume de l’amour et de la grâce est suspect. Seul celui
de la justice des hommes peut être garanti. N’attendez pas le jugement dernier, il a lieu tous
les jours clame Camus. Et quand bien même la grâce coifferait la mort au poteau, elle ne
justifierait pas la souffrance ici-bas, notamment celle des enfants (à l’instar du père Paneloux
dans le second prêche de La Peste). Pour beaucoup, le christianisme échouera dorénavant à
répondre de manière satisfaisante à la question du mal.
L’histoire récente peut se lire comme la traduction directe de ce refus d’attendre en
pariant sur un au-delà. La réponse est ici-bas. L’homme conteste Dieu et lui ravit sa place. A
cette place, « rien n’est vrai » dit Nietzsche, et surtout « tout est permis » proclame
Dostoïevski. Ce « tout est permis », fruit d’une pensée qui refuse de faire allégeance à la
transcendance, n’est-il pas dangereux ? On connait le sort réservé aux penseurs nihilistes
accrochés au seul contenu négatif de la révolte, au non. Ivan Karamazov devient fou. Le
Kirilov des Possédés décide de devenir Dieu et se suicide.
Nietzsche, quant à lui, conscient de l’impasse, fait de l’absence de foi une méthode
qui guide sa pensée dans le travail de destruction des idoles, résidus de Dieu. Mais en
découvrant que rien n’est vrai il proclamera que rien n’est permis, pensant ainsi parer au

5
danger qui se profile. Loin d’un nihilisme destructeur, il fait œuvre d’architecte et pense que
vivre libre ne peut se faire sans loi et qu’il faut prendre le pari d’adhérer sans fléchir et avec
exaltation au monde tel qu’il est. Nietzsche dit oui à la création mais refoule le non du révolté,
accepte l’inacceptable, pose le salut de l’homme non en Dieu mais ici-bas puisque, dit-il, « la
tâche de gouverner les hommes va nous échoir ». Nietzsche ouvre la brèche par laquelle les
nazis le récupéreront pour l’incorporer à leur mythologie délirante. Reste à savoir si la pensée
nietzschéenne peut être qualifiée de dangereuse sous prétexte qu’elle fut récupérée par des
fous et que son auteur n’a pas su la dresser comme une citadelle inviolable… N’est-ce pas là
un problème qui se pose de manière cruciale à tout philosophe ?
Mais avant Nietzsche, en 1845, un certain Stirner abat Dieu et toutes ses
incarnations : l’Etat, la société, l’Humanité. Il pose l’individualisme comme une fin que rien
ne doit contrarier, légitime le meurtre si celui-ci permet la promotion du règne de l’individu.
Une pensée qui coïncide avec le suicide collectif explique Camus ne peut pas ne pas être une
pensée éminemment dangereuse. Dans le sillage des penseurs russes comme Pissarev ou
Dobrolioubov, la constellation terroriste scintillera, l’étoile d’un Netchaïev brillera dans toute
sa violence. L’entreprise terroriste menée par Kaliayev, en 1905, mérite notre attention. Son
mouvement projette d’assassiner le grand-duc Serge. Au dernier moment, Kaliayev se rétracte,
refusant d’entraîner dans l’explosion de la calèche qui doit consumer le duc, sa femme et ses
enfants qui sont innocents. Ceci est un modèle de rigueur et de fidélité aux fondements de la
révolte nous dit Camus, qui écrira sa pièce nommée Les justes à partir de cet attentat censuré
par les terroristes eux-mêmes. Pour ces penseurs, pour ces révoltés qui choisissent le
terrorisme, le meurtre est inexcusable et nécessaire, il est les deux faces d’une même pièce :
nous aurons à tuer parce qu’il le faut puis à mourir car rien ne justifie le meurtre. « Le meurtre
s’est identifié avec le suicide dit Camus. Une vie est alors payée par une autre vie et, de ces
deux holocaustes, surgit la promesse d’une valeur. » Vous l’aurez reconnue, c’est bien la
figure du kamikaze qui se profile et que Camus semble approuver au moins dans sa fidélité
aux fondamentaux de la pensée révoltée. De fait, la pensée de Camus n’est-elle pas
dangereuse et peut-on considérer comme juste, pour reprendre ce terme cher à l’auteur,
l’action kamikaze ?
Il me faut encore mentionner avant de vous laisser la parole, le rôle particulier que
l’art entretient avec la pensée, son pouvoir subversif certes, mais surtout sa fonction vitale
pour nous. Quel monde habiterions-nous si à la fureur des fusils ne répondait nulle symphonie
de Schubert ? Quelle vie possible si entre les prisons, les commissariats, les tribunaux ne
poussaient ni théâtres ni musées ? De quelle monstrueuse culture serions-nous les enfants si
nos bibliothèques ne fleurissaient que de codes pénaux, de vade mecum, de notices, de
dictionnaires et si de leurs étagères avaient désertés la poésie de Baudelaire et les romans de
Zola ? Quel type d’hommes serions-nous si nous n’étions bons qu’à mettre froidement en
équations notre condition sans jamais porter un regard attendrit vers la beauté et l’amour
qu’offre cette condition ? Comment comprendre la haine vouée aux artistes et à l’art par un
Pissarev proclamant qu’ « il vaut mieux être un cordonnier russe qu’un Raphaël russe » ?
Pourquoi l’art effraie-t-il tant? Que peut bien détenir l’artiste qui lui vaille d’être le premier
homme à abattre dans les régimes autocratiques où la pensée est devenue folle ? Ne faut-il pas
considérer l’artiste comme le véritable garde-fou, celui qui détient les clés? Les clés de quelle
porte ? D’une porte qui ouvre sur quoi ?
********
 6
6
1
/
6
100%