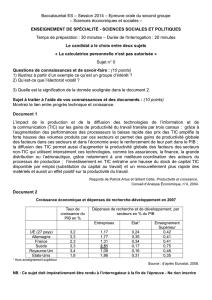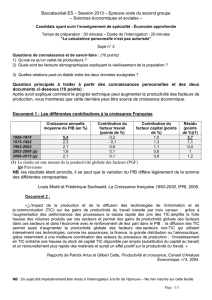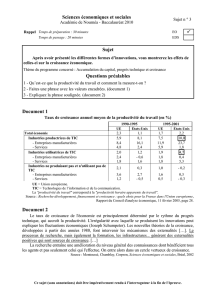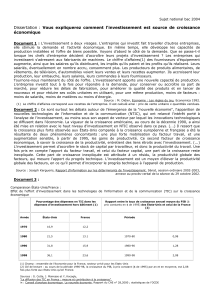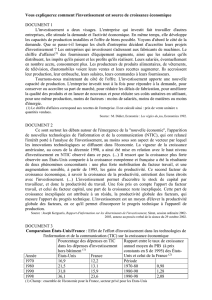Mardi 9 avril 2013. Classe de TES1, TES2. Devoir blanc 4 h. (13 h à

Mardi 9 avril 2013. Classe de TES1, TES2. Devoir blanc 4 h. (13 h à 17 heures)
Calculatrice interdite
Le devoir comporte 2 sujets au choix : épreuve composée ou dissertation + deux sujets au choix de
Sciences sociales et Politiques pour les élèves suivant cet enseignement
Sujet n°1 : épreuve composée sur 20 points
Cette épreuve comprend trois parties.
1 – Pour la partie 1 (Mobilisation des connaissances), il est demandé au candidat de répondre aux
questions en faisant appel à ses connaissances personnelles dans le cadre de l’enseignement
obligatoire.
2 – Pour la partie 2 (Étude d’un document), il est demandé au candidat de répondre à la question
en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de présentation du document, de collecte et
de traitement l’information.
3 – Pour la partie 3 (Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé au
candidat de traiter le sujet :
- en développant un raisonnement ;
- en exploitant les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;
- en composant une introduction, un développement, une conclusion.
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la
présentation.
Première partie : Mobilisation des connaissances (6 points)
Q1. Quels sont les principaux déterminants de l’offre et de la demande de
devises ? (3 points)
Q2. Distinguez les instruments économiques des politiques climatiques qui recourent à
l'incitation de ceux qui recourent à la contrainte. (3 points)
Deuxième partie : Étude d’un document (4 points)
Distribution des niveaux de vie avant et après redistribution monétaire en 2010

Vous présenterez le document puis vous évaluerez l'efficacité de la redistribution
dans la réduction des inégalités de niveau de vie en France.
Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10
points)
À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez
comment le progrès technique favorise la croissance économique.
Document 1 :
Document 2 :
Les écarts de gains de productivité entre l'Europe et les Etats-Unis : la production et la
diffusion des TIC...
L’impact de la production et de la diffusion des technologies de l'information et de la
communication (TIC) sur les gains de productivité du travail transite par trois canaux
• grâce à l'augmentation des performances des processeurs la baisse rapide des prix des TIC
amplifie la forte hausse des volumes produits par ces secteurs et permet des gains de
productivité globale des facteurs dans ces secteurs et dans l'économie avec le renforcement de
leur part dans le PIB ;
• la diffusion des TIC permet aussi d'augmenter la productivité globale des facteurs des
secteurs non-TIC qui utilisent intensément ces technologies, comme les assurances, la
finance, la grande distribution ou l'aéronautique, grâce notamment à une meilleure
coordination des acteurs du processus de production ;
• l'investissement en TIC entraîne une hausse du stock de capital TIC disponible par emploi
(substitution du capital au travail) et un renouvellement plus rapide des matériels et aurait un
effet positif sur la productivité du travail.
Rapports de Patrick Artus et Gilbert Cette, Productivité et croissance, Conseil d'Analyse
Économique, n°4,2004.
Document 3 : Schématisation

Sujet n°2 Dissertation appuyée sur un dossier
documentaire sur 20 points
Il est demandé au candidat :
de répondre à la question posée explicitement ou implicitement dans le sujet ;
de construire une argumentation à partir d’une problématique qu’il devra élaborer ;
de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment
celles figurant dans le dossier ;
de rédiger en utilisant un vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la
question, en organisant le développement sous la forme d’un plan cohérent qui ménage
l’équilibre des parties.
Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la
présentation.
Sujet : Comment peut-on expliquer les stratégies d’implantation des
Firmes Multinationales ?
Document 1 : Principaux pays d'accueil des flux d'IDE (montants en milliards de
dollars)
Augmentation de
la demande
Innovations
de produit
Hausse possible des
salaires
Gains de
productivité
Hausse
possible des
profits
Amélioration de la
compétitivité
Augment
ation des
investis-
sements
Augmentation de
la
consommation
Baisse
possible des
prix
Hausse
possible des
exportations
Innovations
de procédé
Croissance de
la production

Document 2 :
Question : Le coût du travail est souvent présenté comme un facteur clé de la compétition économique
internationale. Les entreprises seraient en permanence à la recherche d'une main-d'œuvre moins
coûteuse sur un marché du travail de plus en plus globalisé. Est-ce ce que vous avez observé ?
Suzanne Berger : Notre équipe, composée d'ingénieurs et de chercheurs en sciences sociales du MIT, a
étudié 500 entreprises sur une période de 5 ans. Une de nos conclusions est qu'on tend à surestimer
l'importance du coût du travail dans la décision de transférer un système de production vers un pays
à bas salaire. Même dans des industries comme le textile/habillement, le coût du travail n'est qu'un
facteur parmi d'autres du coût total lié à une délocalisation : transport, matériaux, capital, mais aussi
incertitude quant à l'infrastructure sur place, corruption des autorités publiques, arbitraire politique,
etc. Pour les entreprises que nous avons étudiées, tous ces facteurs jouent un rôle beaucoup plus
important que le seul coût du travail. C'est uniquement quand tous ces éléments ont été maîtrisés que
le coût du travail s'impose comme décisif. [...] Dans le secteur électronique [...] une fois délocalisé, le
système de production doit être en mesure de se réinventer en permanence pour s'adapter aux
nouvelles technologies et aux nouveaux besoins du marché. Ceci suppose une main-d’œuvre
extrêmement qualifiée qui fait souvent défaut dans les pays émergents. Les Japonais l'ont compris : ils
ont instauré une division du travail avec la Chine, fondée sur la complexité et le cycle de vie du
produit. Ils délocalisent la fabrication des produits à longue série, mais gardent au Japon la fabrication
des produits avec un cycle de vie court. La raison en est que les employés japonais restent plus
qualifiés et savent mieux comment adapter rapidement la fabrication.
Entretien avec Suzanne Berger, auteur de Made in Monde. Propos recueillis par Wojtek Kalinowski et Thierry
Pech, La vie des idées, n°6, octobre 2005.
Document 3 : Coût salarial unitaire

Sources : Datastream, FMI et Natixis, Patrick Artus, Jacques Mistral et Valérie Plagnol, « L'émergence de la Chine : impact
économique et implications de politique économique », rapport du CAF, juin 2011.
Document 4 : Dans la formidable partie de Monopoly industriel qui se joue, les multinationales
excellent dans l'art de jongler avec les écarts de salaires pour s'approvisionner au meilleur prix. Elles
passent d'une délocalisation à une autre, à la faveur d'une main-d’œuvre en apparence inépuisable,
cette fameuse "armée industrielle de réserve" du capital chère à Karl Marx.
(…) La Chine n'est plus un pays low cost. Il y a dix ans, le coût d'un ouvrier était de 150 à 200 euros
par mois. Aujourd'hui, il faut dépenser le double", raconte Margaux Fildier, responsable des achats de
Delta Plus, qui fabrique à Suzhou (80 kilomètres de Shanghai) des vêtements de sécurité. Dix ans
qu'elle parcourt la Chine !
Partout, c'est le même scénario. Sur les bords du Yangzi Jiang, dans le delta de la rivière des Perles,
dans la province du Guangdong, le ras-le-bol des ouvriers chinois se traduit par une inflation salariale
galopante. Après une vague de suicides, Foxconn, le sous-traitant d'Apple, a dû doubler les salaires
dans son usine de Shenzhen. A Foshan, les ouvriers d'un sous-traitant de Honda ont campé devant les
grilles de l'usine jusqu'à ce qu'ils obtiennent une revalorisation de leurs rémunérations de 30 %.
Parfait, mais les voilà trop chers par rapport même à leurs compatriotes.
Adidas a renoncé cet été à avoir ses propres usines en Chine pour aller coudre ses chaussures aux trois
bandes au Vietnam. Le salaire moyen d'un ouvrier à Hô Chi Minh-Ville faisait jeu égal en 2011 avec
celui pratiqué dans le delta de la rivière des Perles (Chine) il y a dix ans. (…) Qui dit mieux ? Les
Philippines, où le salaire minimal n'a progressé que de 5 % en dix ans ; la Birmanie, après des années
d'isolement ; la Bulgarie, avec un salaire moyen de 350 euros par mois, soit deux fois moins qu'en
Hongrie et trois fois moins qu'en Croatie. Le Bangladesh a vu débouler, ces dernières années, les
grandes enseignes du type H&M, Zara ou Uniqlo. (…)
Cruelle ironie de l'histoire. A l'heure où les multinationales quittent la Chine pour aller puiser en Asie
du Sud-Est une main-d’œuvre encore moins chère, les géants asiatiques, eux, viennent produire des
réfrigérateurs, des lave-vaisselle et des téléviseurs... dans la vieille Europe.
Après Samsung, LG a ouvert une usine d'électroménager en Pologne. Le groupe sud-coréen, qui
entend ainsi profiter d'une main-d’œuvre bon marché et formée autrefois par Philips, Bosch et
Siemens, espère devenir le n° 1 de l'électroménager d'ici à 2015.
Les Chinois, qui nourrissent de grandes ambitions sur le marché des téléviseurs, ne sont pas en reste.
TCL assemble déjà des télés en Pologne... dans une ancienne usine Thomson, tandis que le chinois
Changhong a choisi la République tchèque comme tête de pont pour lancer ses téléviseurs en Europe.
Enfin, Haier étudierait une implantation en Europe de l'Est pour y produire une partie de ses produits
électroménagers.
Objectif des marques asiatiques : la conquête du marché européen. De six semaines, les délais
d'approvisionnement passent ainsi à trois jours. De quoi satisfaire aux exigences de la grande
distribution occidentale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%