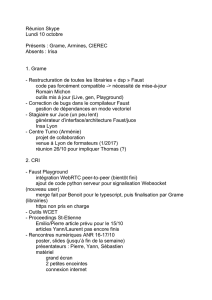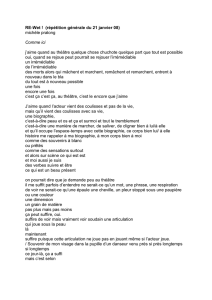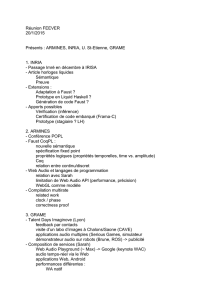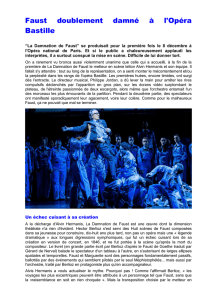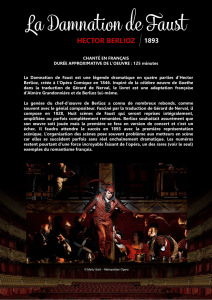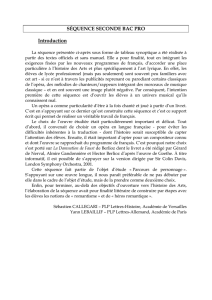Le geste latéral de Klaus Michael Grüber - Fi

Le geste latéral de Klaus Michael Grüber
Bernard Dort
Il y a des metteurs en scène qui, d'une œuvre à l'autre, semblent suivre le même chemin,
construire, pièce par pièce, leur propre cosmogonie. Ainsi de Giorgio Strehler dont chaque
spectacle répond au précédent, l'approfondit, le modifie, à la manière dont un compositeur
classique développe un thème... Il y en a d'autres qui traitent chaque œuvre séparément et
paraissent soucieux de ne pas reprendre ce qu'ils ont déjà fait et de laisser son autonomie au
texte qu'ils traitent, voire de l'accentuer, comme des musiciens modernes qui s'interdisent
toute répétition du motif... C'était le cas de Vitez; c'est aussi, mais différemment, celui de
Peter Stein. Klaus Michael Grüber ne relève ni de l'une ni de l'autre de ces catégories: il les
déjoue toutes deux. De quelque côté qu'on l'envisage, il est déconcertant, singulier.
Grüber n'est établi nulle part. Allemand, il a monté ses premiers spectacles en italien, au
Piccolo Teatro de Milan où il a été, quelques années, assistant de Strehler. Depuis, il n'a cessé
d'aller et venir entre l'Italie, l'Allemagne et la France, mettant en scène dans les trois langues,
avec, parfois, des choix inattendus: ce n'est pas en allemand mais en français qu'il a réalisé La
Mort de Danton de Büchner (aux Amandiers de Nanterre en 1989) tandis que pour Labiche
(L'affaire de la rue de Lourcine, 1988), c'est l'allemand qu'il a choisi, et il a fait précéder son
Faust berlinois de 1982 d'un Faust parisien: le mémorable Faust Salpêtrière de 1975... Sans
doute a-t-il surtout travaillé à la Schaubühne de Berlin, mais il n'y a jamais eu de
responsabilité directoriale: il en reste, depuis ses Légendes de la forêt viennoise (1972), le
compagnon de route privilégié. Grüber s'est aussi partagé entre le théâtre et l'opéra. Dès 1971,
à Brême, il monte le Wozzeck d'Alban Berg. Ensuite, il revient une dizaine de fois à l'opéra.
Mais il le fait irrégulièrement et de manière inattendue. Sa seconde mise en scène lyrique est
celle de Jules César en Egypte (Brême, 1972): Haendel après Berg... Puis il réunit Bartok (Le
Château de Barbe-Bleue) et Schoenberg (Erwartung) en 1974 à Francfort. S'il s'attarde sur
Wagner dont il réalise trois oeuvres, mais dans des lieux, des théâtres et des conditions fort
dissemblables (La Walkyrie à l'opéra de Paris en 1976, Tannhauser au Comunale pour le Mai
musical florentin de 1983 et Parsifal à l'opéra d'Amsterdam en 199O), il n'en néglige pas pour
autant, à la surprise générale, Rossini (La Cenerentola au Châtelet, 1986)... Et, en 1992, il a
fait entrer au Festival de Salzbourg, sur l'immense plateau du Grosses Festspielhaus, Janacek
qui n'y avait jamais été joué, avec son oeuvre la plus âpre, La Maison des morts d'après
Dostoïevski.
Tous ses spectacles sont dissemblables. Impossible de parler d'un "style Grüber". Pendant une
période, Grüber a fui les théâtres traditionnels: pour Les Bacchantes, (1974), il choisit un
hangar de la foire des expositions de Berlin-Ouest et son Faust Salpêtrière épousait
l'architecture de la Chapelle Saint Louis et en constituait l'exploration; dans le Voyage d'hiver
(d'après Hypérion, 1977), le Stade olympique de Berlin prêtait sa démesure et son histoire
(d'une Grèce rêvée par l'Allemagne, jusqu'aux ruines de la guerre, en passant par les
olympiades nazies de 1936) aux déambulations du héros de Hölderlin, et c'est dans le luxueux
hôtel Esplanade, en surplomb du Mur, qu'il logea Rudi, une nouvelle de Bernhard von
Brentano (1979)... on crut à un refus de principe et les épigones, les thuriféraires du "théâtre-
parcours" ou les partisans d'un "théâtre des matières", se multiplièrent. Mais, avec Six
personnages en quête d'auteur à la Freie Volksbühne de Berlin (1981), Grüber fit volte face: il
rentra dans le bâtiment théâtral, il s'accommoda à nouveau de la scène et de la division entre
scène et salle. Mieux: il se mit à jouer sur cette division. Un des éléments fondamentaux de sa
seconde version de Faust (un Faust minimal par opposition à la prodigalité du Faust
Salpêtrière) était le rideau de scène en velours rouge dont Faust se drapait parfois et qui

figurait aussi bien une frontière entre deux mondes... Et dans l'Amphitryon de Kleist (1991),
le lieu exigu dévolu à Sosie est précisément la limite matérielle du plateau . le petit escalier
qui mène de la salle aux planches, le bord du proscenium, côté cour, tout contre le cadre de
scène... bref, les restes, les laissés pour compte de la scénographie classique. Tout le spectacle
se trouve ainsi en équilibre instable entre la splendeur du théâtre (celle de ce plateau tournant,
gravitant comme une planète, où brille l'amour de Jupiter et d'Alcmène) et sa misère (la nuit
où Sosie tâtonne et s'embrouille). Partage de la scène qui est l'une des figures récurrentes du
lieu théâtral chez Grüber: souvenons-nous de Lire Empédocle où coexistaient, côté jardin, le
hall d'une petite gare, et, côté cour, un Etna figuré selon Caspar David Friedrich par Le
Naufrage de l' "Espoir" dans les glaces... Peu après avoir, pour Hamlet (1982), utilisé dans
toute leur ampleur les nouvelles installations de la Schaubühne am Lehniner Platz dont c'était
l'ouverture et où les acteurs paraissaient écrasés par cet espace de géants, Grüber choisit de
monter Sur la grand'route (1984), toujours pour la Schaubühne, mais cette fois dans sa salle
de répétitions, un ancien cinéma de Kreuzberg: ici, comédiens et spectateurs sont très proches,
ils partagent le même dénuement. Cette brève, poignante "étude dramatique en un acte" de
Tchekhov en devient comme une halte, le repos d'une nuit que tous partagent, avant que les
uns et les autres ne repartent, chacun de son côté. Parfois même, les choix de Grüber touchent
au paradoxe. Dans sa Walkyrie de Paris, il reprend des costumes et des éléments scéniques
des premières représentations de l'oeuvre, mais le résultat est évidemment aux antipodes d'une
reconstitution muséologique et les wagnériens crient à la parodie. En revanche, il traite La
Cenerentola avec tendresse: au lieu de l'habituel "grotesque, dérisoire", il mise sur
"l'émerveillement, la mélancolie, l'amabilité, cette discrétion aussi, cette transparence"
(Arroyo) et sa Cenerentola redevient, proprement, un conte de fées.
Faut-il, alors, parler de versatilité ou d'un désir de surprendre, voire de provoquer ? Rien ne
serait plus faux. Sous son apparent éclectisme, il y a une profonde permanence. Mais celle-ci
n'est pas de l'ordre de l'expression - Grüber ne cherche pas à faire dire ceci ou cela à une
oeuvre -, ni de l'efficacité spectaculaire - elle relève du regard, de l'écoute. Et d'un travail
continu avec un petit groupe de collaborateurs, les mêmes depuis longtemps, qui alternent
entre eux et se situent, eux aussi, sur les marges du théâtre. Citons notamment les peintres
Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo (dont Grüber a monté une pièce, Bantam, en 1986 à Munich),
Lucio Fanti ou Antonio Recalcati, le philosophe Bernard Pautrat, et enfin son assistante,
permanente elle, Ellen Hammer. En fait, un spectacle de Grüber est d'abord approche d'une
oeuvre. Parlant (c'est chose rare, car il se refuse en général à toute déclaration) du travail de
Gilles Aillaud, Grüber disait . "Il va, il vient. Je le regarde de toutes mes forces. C'est
bouleversant et ce n'est rien. Il s'approche d'un mur, il gratte avec l'ongle (...) Ce geste latéral,
accompli, sur le mur gratté avec l'ongle, est le plus concret du monde. Je m'en nourris" (1). on
pourrait appliquer cette description à son propre travail. La mise en scène de Grüber est "un
geste latéral" par rapport à l'oeuvre. Il attend qu'elle parle: il lui donne la parole. Il est séparé
d'elle par une certaine distance: il en tient compte, il la respecte. Il s'étonne de ses paroles, de
sa musique. Il organise la scène, la représentation, afin qu'elles appellent aussi l'étonnement.
Jamais, ou presque jamais, le personnage ou le motif principal n'est au centre: le centre, c'est
le vide, la réalité matérielle des planches. Le jeu, aussi, est le plus souvent "latéral".
Et ce jeu a partie liée avec la discrétion: il s'agit non de s'approprier les mots et les gestes,
mais de les découvrir. C'est la tâche des acteurs. Grüber ne leur prescrit rien, il les assiste dans
leur cheminement. Chez lui, tout doit être simple, concret: c'est une certaine qualité de présent
(celle, par exemple, qui se fait jour dans les textes pré-socratiques d'Héraclite ou d'Empédocle
réunis dans sa Medesima Strada, à Milan en 1988) qu'il recherche.

Le théâtre, ici, n'est pas acquis, exalté ou déconstruit comme tel: pour Grüber, il est
perpétuellement à découvrir "ici et maintenant", chaque soir ou chaque matinée. Relisons le
beau texte de Bernard Pautrat publié en tête du Faust Salpêtrière (2), "Le démon du voyage"
(je reviendrai sur ce titre, sur le "voyage"): "(...) Il suffit de voir et d'entendre, sans naïveté
mais aussi sans précipitation. Que voit-on ? des formes grises, d'abord, contre la pierre grise;
des gestes indubitables, qui se suffisent à eux-mêmes; des petits travaux exécutés selon leur
ordre et finalité propres; des objets familiers, d'une insondable familiarité. Depuis quand tout
cela et jusqu'à quand ? c'est trop demander, bien sûr, puisque peut-être, cela n'ayant jamais
commencé, n'aura pas non plus à finir. Il y a là des visiteurs . ce sont des choses qui arrivent.
Eux seuls peuvent savoir, à la rigueur, pourquoi et comment et pour combien de temps (...)
Mais, ces êtres de passage, est-ce qu'ils jouent ? Ni plus ni moins que d'autres. S'ils marchent,
c'est avec leurs pieds, s'ils sifflent, avec leurs lèvres. Et s'ils trébuchent, c'est qu'ils ont une
faiblesse à la cheville. Alors ce n'est pas du théâtre ? La question n'est pas là: ça n'en est pas
encore, ça n'en est déjà plus; ou bien . ce n'est déjà plus la vie, laquelle, on le sait bien,
déplace avec soi son petit théâtre, mais ça n'est pas encore le théâtre tel qu'on l'attend, tel
qu'on le souhaite. Plutôt comme le passage d'une forme à une autre (...) Nous avons trop de
mauvaises habitudes, nous qui faisons ou consommons du théâtre (...) C'est pour tenter de se
dégager de ce mouvement-là qu'on a voulu renoncer à l'effet à tout prix, et montrer des
mouvements à ras de terre, à ras de pierre, montrer ce qui n'est pas fait pour être vu, montrer,
dans le passage équivoque, une minuscule naissance du théâtre qui sera toujours prise pour
autre chose (...) Regardons donc plutôt ce que chacun d'eux fait sans jouer: il fait ce qu'il sait
faire. L'un connaît bien les possibilités de sa main, l'autre s'applique parfaitement à prendre de
vraies mesures avec un vrai mètre, etc. Ce n'est rien, mais c'est déjà beaucoup (...) Cela n'est
pas fait pour durer (...) Les manteaux et chapeaux retournent comme ils sont venus à leur hall
de gare, à leur chantier, à leurs conversations d'émigrants, à leur indicateur des chemins de
fer. Maintenant tout peut recommencer. Car le jeu, ici, n'est pas vraiment un jeu au sens du
théâtre, parce que l'église n'est plus vraiment une église, le drame goethéen peut se produire
dans ce suspens continuel, entre son apparition ponctuelle et sa disparition, entre parenthèses.
on propose donc un Faust suspendu, interrompu, discontinu. Un Faust montré en retrait."
Ce qui fait déjà trois notions: le théâtre comme "geste latéral", un jeu "en retrait" et une
oeuvre "à l'état naissant" (Pautrat parle même d'une "minuscule naissance du théâtre", puis il y
revient: "En somme: un Faust à l'état naissant"). Mais ces trois notions convergentes ne
composent pas une thématique: elles désignent une pratique. Nous pouvons leur en ajouter
une quatrième, d'une espèce plus mêlée en ce qu'elle est à la fois thème et processus, nouant
par là thématique et pratique: celle du voyage, qui figure dans le titre de Pautrat. Le théâtre de
Grüber parle du voyage, souvent il le raconte: le voyage est son objet privilégié, mais il est
aussi, lui-même, le voyage, il s'éprouve comme tel. Rappelons que Hypérion de Hölderlin
donné, plus encore que joué, dans le stade olympique de Berlin, est devenu le Voyage
d'hiver...
Evoquons donc successivement les personnages voyageurs et le théâtre comme voyage. Ces
voyageurs le sont d'abord au sens littéral: les pèlerins de Sur la grand'route viennent "de loin"
et vont encore plus loin, à Jérusalem ou, plus sûrement, dans un autre monde; Faust parcourt
l'espace et le temps; à côté d'Empédocle qui gravit l'Etna, dans l'autre moitié de la scène, il y a
aussi des voyageurs, mais arrêtés, en attente dans le hall d'une petite gare où les trains doivent
être fort rares... jusqu'à Wozzeck qui n'arrête pas de courir ici et là, de passer de l'un à l'autre.
Tous portent les attributs du voyage: manteaux longs, chapeaux, valises ou baluchons. ou
encore ces personnages reviennent d'un voyage - ce qui est une façon de parler car,
précisément, ils n'en reviennent pas, ils s'y sont perdus et plus rien maintenant n'est comme
avant. Mistingue et Lenglumé, dans L'Affaire de la Rue de Lourcine, ont une nuit de

déambulations aveugles derrière eux: ils pourraient bien ne plus être tels qu'ils croyaient être
et le monde leur est devenu étranger. Amphitryon de Molière- Kleist se construit aussi sur un
entrelacs d'itinéraires: le voyage galant de Jupiter et de Mercure croise la randonnée guerrière
d'Amphitryon et de Sosie, chacun y perd son identité, le ciel et la terre se mélangent, et
Alcmène, la seule à être demeurée sur place, se voit retirer l'usage de la parole et ne peut plus
conclure que sur un douloureux "Hélas" ("Ach").
Ce n'est pas seulement l'affaire des personnages: le voyage est au coeur même du théâtre
grübérien. Un voyage dans le temps plus encore que dans l'espace. Dans la matérialité des
choses plus que dans leur étendue et leurs formes. Son Danton de Büchner ne veut pas faire
un pas, ni un discours de plus: il s'enfonce dans le présent. Tout devrait s'arrêter, même le
temps. Dans La Medesima Strada, après les amples perspectives historiques de la tragédie
(Antigone), tout se réduit au présent nocturne (ou, plutôt, crépusculaire) d'une petite place de
village sicilien où s'inscrit toutefois le présent immémorial et absolu des pré-socratiques...
Enfin, Sur la grand 'route substitue, en quelque sorte, un voyage à un autre: celui d'une nuit
dans le cabaret de Tikhone à l'errance des pèlerins. Peut-être le voyage grübérien par
excellence est-il là: dans l'exploration du concret, du présent, d'un temps en apparence arrêté
mais vertigineux. Un voyage immobile. C'est aussi celui de sa Bérénice: elle est venue
d'ailleurs, de l'orient, elle y repartira, mais son destin se joue sur une "journée" et il tient peut-
être au mouvement presque imperceptible que fait le rideau qui voile la porte de ses
appartements comme mu par une légère respiration...
Ce mouvement et cette immobilité se condensent en quelques objets emblématiques
récurrents dans les mises en scène de Grüber. Citons, entre autres, le caillou, la tortue et le
brandon. Le caillou, ou plutôt une grosse pierre comme polie par le mer ou par les siècles
répond mystérieusement, dans Bérénice, au rideau de la porte, et, dans Hypérion de Bruno
Maderna, il polarise toute une partie du plateau, par opposition à la boîte de verre où s'agitent
des abeilles. Quant à la tortue, comment ne pas souscrire à ce qu'en dit Michel Deutsch: "Le
mutisme minéral de la tortue (on se souvient des tortues du Faust Salpêtrière !), l'immobilité
de la tortue, la tortue matérialisant l'énigme est emblématique du monde grübérien: le temps
stratifié, coagulé - moment plus pesant que l'histoire." (3) Peut-être la latte de Lois
qu'enflamme à plusieurs reprises le cabaretier Tikhone, dans Sur la grand'route, et qu'il fixe
au mur, est-il encore davantage emblématique de cette alliance paradoxale de l'immobilité et
du mouvement, de la durée et du moment: elle en est la manifestation proprement matérielle.
Le brandon brûle sans éclairer et se consume calmement. Il est la mesure du théâtre grübérien:
un temps devenu "visible" (Michel Deutsch: "Ce qui est frappant chez Grüber, c'est sa façon
de rendre, dans ses spectacles, le temps visible." (4)).
La démarche de Grüber qui n'est ni celle d'un auteur ni même à proprement parler celle d'un
réalisateur s'apparente ainsi à celle d'un voyageur parti, à travers les mots et les gestes, à la
recherche du théâtre. Mais ce théâtre exclut tout spectaculaire, tout pathos, voire toute
interprétation (au sens d'incarnation et de dépossession de soi): il est en deçà ou au-delà de
l'hystérie, il n'appelle pas l'identification, il la remplace par l'étonnement - l'étonnement de la
découverte. La représentation, disait Grüber, à propos du Voyage d'hiver-Hypérion, "ne doit
pas être ressentie comme une gifle, mais comme une chose calme." (5) N'en rêve-t-il pas
comme d'un moment d'éternité avec ce que cette expression comporte de contradictoire,
d'impossible: ce moment s'arrache au temps pour toucher à l'éternité (qui est peut-être aussi
celle de la mort) mais il n'est précisément qu'un moment, c'est à dire que sa simple affirmation
suppose le temps et détruit l'éternité. Il n'est qu'un morceau (rappelons que le mot allemand
pour "pièce" est "Stück", soit morceau) en suspens entre la vie et la mort, entre la scène et le
monde, qui ne se suffit jamais tout à fait à lui même. Son théâtre est conscient de sa propre
précarité. Il est hanté, comme les personnages de Hamlet dont parlait Grüber, par "l'envie de

mourir, d'en terminer avec la théâtralité et l'intelligence. Le spectacle doit finir (...) La mort
n'est plus une chose féroce. Il faut bien quitter le plateau" (6). Alors reste "le bonheur de se
taire". Le mouvement du voyageur Grüber est celui d'une découverte et d'un abandon sans fin
du théâtre.
(1) Cf. "Le bonheur de se taire" de Klaus Michael Grüber, propos recueillis par Jean-Pierre
Léonardini, dans Théâtre en Europe, no2, avril 1984. P. 99. (2) Faust Salpêtrière, Christian
Bourgois éditeur, Paris, 1975.
(2) Cf. PP. 16-20.
(3) Cf. "Matthias Langhoff, Klaus Michael Grüber. Propos en désordre sur deux rapports
remarquables à l'espace du théâtre", dans Inventaire après liquidation par Michel Deutsch,
l'Arche, Paris, 1990. P. 108.
(4) Ibid., P. 107.
(5) Cf. un entretien avec Grüber dans Il Teatro degli anni settanta: tradizione e ricerca (Stein,
Chéreau, Ronconi, Mnouchkine, Grüber, Bene) par Franco Quadri, Coll. "La ricerca critica:
cinema, musica, teatro", no 13, Giulio Einaudi editore, Torino, 1982. P. 292.
(6) Cf. les propos de Klaus Michael Grüber rapportés par Colette Godard, dans Le Monde du
jeudi 13 janvier 1983.
Source : "Klaus Michael Grüber... Il faut que le théâtre passe à travers les larmes"
Portrait proposé par Georges Banu et Mark Blezinger
Ed. du Regard - Académie Expérimentale des Théâtre
Festival d'automne à Paris, 1993, pp. 21-27
© Ed. du Regard - Académie Expérimentale des Théâtre - Festival d'automne à Paris
1
/
5
100%