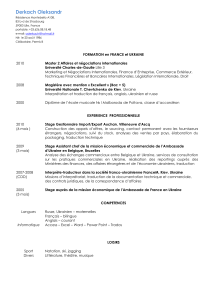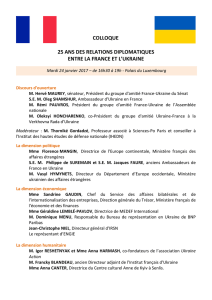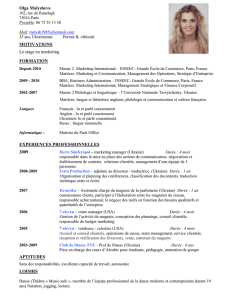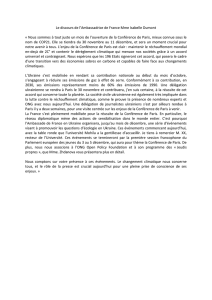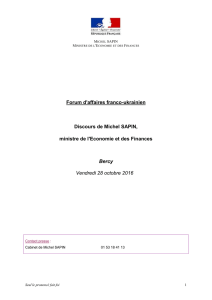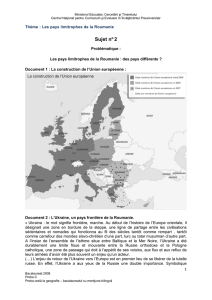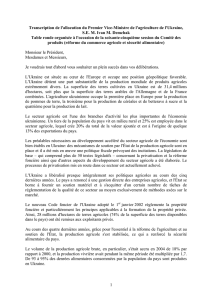[PAREUR]

AD\431405FR.doc PE 297.120
FR FR
PARLEMENT EUROPÉEN
1999
2004
Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie
9 février 2001
AVIS
de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de
l'énergie
à l'intention de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de
la sécurité commune et de la politique de défense
sur la stratégie commune de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine
(C5–0208/2000 – 2000/2116(COS))
Rapporteur pour avis: Gordon J. Adam

PE 297.120 2/9 AD\431405FR.doc
FR

AD\431405FR.doc 3/9 PE 297.120
FR
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 25 mai 2000, la commission de l'industrie, du commerce extérieur,
de la recherche et de l'énergie a nommé Gordon J. Adam rapporteur pour avis.
Au cours de ses réunions des 23 novembre 2000, 25 janvier et 6 février 2001, elle a examiné
le projet d'avis.
Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les conclusions suivantes par 47 voix
contre 6.
Étaient présents au moment du vote Carlos Westendorp y Cabeza (président), Renato
Brunetta, Nuala Ahern et Peter Michael Mombaur (vice-présidents), Konstantinos
Alyssandrakis, Maria del Pilar Ayuso González (suppléant Godelieve Quisthoudt-Rowohl),
Ward Beysen (suppléant Colette Flesch), Yves Butel, Massimo Carraro, Gérard Caudron,
Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (suppléant Claude J.-M.J. Desama),
Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Raina A. Mercedes Echerer (suppléant Yves
Piétrasanta), Concepció Ferrer, Per Gahrton (suppléant Caroline Lucas), Pat the Cope
Gallagher, Fiorella Ghilardotti (suppléant Elena Valenciano Martínez-Orozco), Neena Gill
(suppléant Glyn Ford), Norbert Glante, Lisbeth Grönfeldt Bergman (suppléant Christos
Folias), Michel Hansenne, Roger Helmer, Philippe A.R. Herzog, Hans Karlsson, Hans
Kronberger (suppléant Daniela Raschhofer, conformément à l'article 138, paragraphe 2, du
règlement), Helmut Kuhne (suppléant François Zimeray), Bernd Lange (suppléant Mechtild
Rothe), Werner Langen, Rolf Linkohr, Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Marjo
Matikainen-Kallström, Angelika Niebler, Giuseppe Nisticò (suppléant Umberto Scapagnini),
Reino Paasilinna, Elly Plooij-van Gorsel, John Purvis, Alexander Radwan (suppléant Guido
Bodrato), Imelda Mary Read, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Ilka Schröder, Konrad
K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Astrid Thors, Claude Turmes (suppléant Nelly Maes),
Jaime Valdivielso de Cué, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto,
Anders Wijkman et Myrsini Zorba.

PE 297.120 4/9 AD\431405FR.doc
FR
BREF EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
La stratégie commune, adoptée au Sommet d'Helsinki le 11 décembre 1999, prolonge l'accord
de partenariat et de coopération (APC) entré en vigueur le 1er mars 1998. Elle a un caractère
exhaustif, en ce sens qu'elle couvre les principaux domaines d'intérêt commun pour l'Union
européenne et l'Ukraine. Elle servira de document directeur pendant au moins quatre ans.
Cependant, elle doit être replacée dans le contexte des responsabilités incombant à la
commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et, plus
spécialement, des engagements pris par l'Union vis-à-vis de l'Ukraine et de l'évolution de la
situation depuis l'adoption de ladite stratégie.
Les trois principaux objectifs de celle-ci sont: 1) l'appui au processus de transition
démocratique et économique, 2) la garantie de la stabilité et de la sécurité, et 3) le soutien à
une coopération renforcée entre l'Union et l'Ukraine. Ils doivent essentiellement être atteints
par l'intermédiaire de mesures et d'actions relevant du domaine de compétence de la présente
commission. Ainsi, pour ce qui est de l'objectif n° 1, l'Union s'est engagée à épauler l'Ukraine
dans les efforts qu'elle consacre à l'instauration d'un climat favorable à une intensification de
l'activité économique et à une réforme de ses structures économiques et sociales. À cet égard,
la stratégie commune se réfère à diverses politiques: a) mesures macroéconomiques visant à la
stabilité des prix, b) mise en place d'une banque centrale indépendante, c) renforcement de la
surveillance prudentielle, d) réforme de la fiscalité, etc.
Passage à l'économie de marché
La stratégie commune cherche avant tout à aider l'Ukraine à construire une économie de
marché en bon état de fonctionnement. Il a fallu pour cela élaborer une réforme qui soit agréée
par le FMI et la Banque mondiale. Cette réforme touche l'agriculture, l'énergie et les
transports; elle prévoit également la privatisation des grandes entreprises et la libération des
prix, ainsi que des mesures d'incitation à l'intention des PME. L'Union a pris l'engagement
d'apporter une généreuse assistance macroéconomique à cette réforme et dans d'autres secteurs
(allégement de la dette, problèmes urgents liés à la balance des paiements, ou encore, projets
spécifiques dans le domaine de l'énergie).
Le passage à une économie de marché n'a pas été aisé. Depuis quelques années, l'Ukraine
connaît la stagflation. Libellé en prix constants, le PIB a perdu 10 % en 1996, 3 % en 1997,
1,7 % en 1998 et 3 % en 1999. Par contre, les prix à la consommation ont augmenté de 39,7 %
en 1996, 10 % en 1997, 22 % en 1998 et 21 % en 1999.
Malgré une grave récession, l'Ukraine a pu restreindre ses dépenses publiques et contenir ainsi
le déficit du secteur public dans des proportions relativement limitées (le rapport entre ce
déficit et le PIB s'établissait à - 3,2 % en 1996, - 5,6 % en 1997, - 3,5 % en 1998 et - 1,3 % en
1999). De la même façon, le déficit de la balance des opérations courantes a été géré
prudemment (son rapport avec le PIB était de - 2,7 % en 1996, - 3,4 % en 1997, - 1,2 % en
1998 et - 2,1 % en 1999). Cependant, pour préserver l'équilibre de la balance des paiements et

AD\431405FR.doc 5/9 PE 297.120
FR
se prémunir contre un risque de défaillance accru, le pays a affecté ses réserves de devises au
remboursement des créanciers étrangers. En 1996, ces réserves représentaient 5,2 mois
d'importations, mais leur niveau n'a cessé de baisser pour atteindre, en 1999, l'équivalent de
moins d'un mois d'importations (en 1999, les réserves n'atteignaient qu'environ 1,1 milliard de
dollars). Pourtant, l'Ukraine a pu préserver ses banques de la crise russe d'août 1998 mais le
taux de change de sa monnaie est passé de B3 à Caa1 (notation Moody).
Restructuration industrielle
Des progrès ont été enregistrés dans la privatisation des industries traditionnelles, privatisation
qui a pris la forme de vente de parts aux travailleurs avec émission de coupons. Plus du quart
des 2 000 grandes entreprises du pays a été vendu, et la privatisation des entreprises de taille
plus réduite est terminée. Pourtant cette méthode (distribution massive de coupons) n'a guère
donné accès à de nouveaux capitaux, de sorte qu'aucun investissement majeur n'a eu lieu au
cours des cinq années écoulées. Les autorités ukrainiennes comptent vendre le monopole
d'État du téléphone (Ukrtelekom) en 2001.
Le soutien de la transition économique en Ukraine exige au moins quatre processus distincts
pour les échanges, l'investissement, les technologies et les finances. À en juger par les
manifestations de mécontentement des autorités de Kiev, la communauté internationale n'a
avancé, pour aucun de ces quatre secteurs, des propositions et des moyens concrets. Les
investissements exogènes directs sont réduits à la portion congrue (leur volume par habitant
est le plus bas de la région). L'Union rétorque qu'il n'existe aucune législation propre à
protéger et à encourager les investissements exogènes directs, pas plus qu'une réglementation
propre à promouvoir les activités du secteur privé. En réalité, les entreprises sont fortement
taxées et la réglementation fiscale change fréquemment; par ailleurs, le gouvernement connaît
des arriérés de dépenses importants et, entre entreprises, les impayés ont atteint des
proportions alarmantes.
Énergie
La restructuration du domaine énergétique a connu des hauts et des bas. Le secteur de
l'électricité est confronté à de graves arriérés de paiement de la part des abonnés, notamment
dans les secteurs public et commercial, et le niveau de recouvrement est peu élevé. On a
également constaté des retards dans la privatisation des compagnies de distribution. Toutefois,
sur le plan de la sûreté énergétique et nucléaire, l'Union et l'Ukraine sont convenues d'un plan
de redressement qui englobe la libération des prix, la privatisation des compagnies de
distribution, la sûreté nucléaire et les investissements d'infrastructure.
Le plan de redressement se fonde en partie sur la teneur d'un protocole d'accord conclu en
1995 entre les pays membres du G7 et le gouvernement ukrainien, à la suite de la catastrophe
de Tchernobyl. Ce protocole portait sur la fermeture de cette centrale nucléaire en l'an 2000 au
plus tard. Effectivement, le 15 décembre dernier, le dernier réacteur opérationnel a été arrêté
et la centrale est désormais fermée. Pour faciliter cette fermeture, la communauté
internationale s'est engagée à fournir à l'Ukraine l'aide nécessaire pour une restructuration
complète de son secteur énergétique. La pièce jointe 1 au protocole d'accord énumère les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%