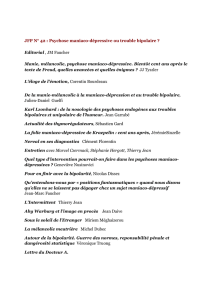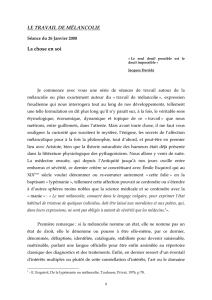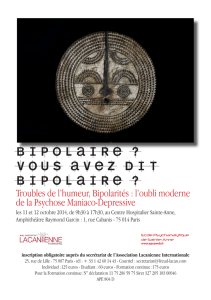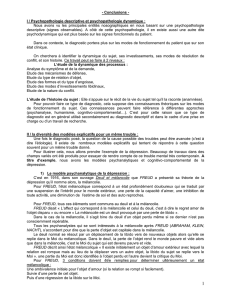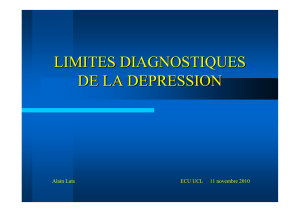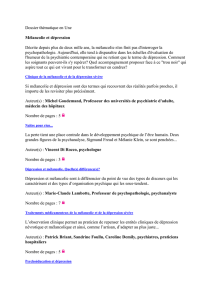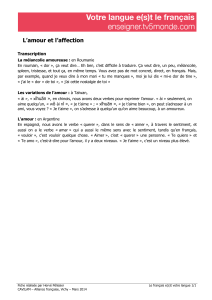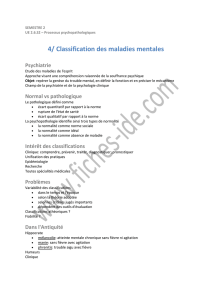B. La crise maniaque

VITTOZ IRDC
FORMATION 2014/2015
Odile RAGUIN Psychologue clinicienne Praticienne de la Psychothérapie Vittoz
PSYCHOPATHOLOGIE
- LES PSYCHOSES -

2
SOMMAIRE
Page
CHAPITRE I . LA MELANCOLIE ……....……………………..…..... 03
CHAPITRE II . LA PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE ………. 10
CHAPITRE III . LA SCHIZOPHRENIE …………………...……...…. 15
CHAPITRE IV . LA PARANOÏA …………………………..……….... 24
BIBLIOGRAPHIE ………………….…...…..…………………..………. 28

3
CHAPITRE I
LA MELANCOLIE
1. QUELQUES GENERALITES SUR LA STRUCTURE PSYCHOTIQUE
Le comportement du psychotique concerne l’agir et la pensée concrète ; c’est-à-dire
l’inaptitude primaire à exister de manière différentielle (en voie de conséquence à dialoguer)
qui nous amène à parler du langage du psychotique comme un non-langage ; celui-ci ne fera,
en effet, qu’exprimer, en dehors de la différenciation significative verbale, son ouverture
insuffisante à toute altérité par l’immaturité de la relation d’objet fusionnelle qu’elle
comporte…
Nous parlerons d’un langage qui a une valeur plus expressive que communicative…
Plus proche d’un fonctionnement par l’agir que d’un fonctionnement verbal.
Rappelons que la structure psychotique est essentiellement caractérisée par une
fixation et un non dépassement du registre pré-objectal.
On admet qu’à l’origine, le nourrisson participe pour ainsi dire sur le mode de la
fusion et de l’identification à une totalité fusionnelle où il n’existe pas encore de séparation
entre le sujet et son entourage ; où les échanges ne sont pas perçus comme une acquisition
mais comme une simple expansion de son être.
On comprend ainsi la prédominance de mécanismes d’absorption et de diffusion propres à
cette période qui ont amené à la définir comme appartenant à une phase orale du
développement. Il s’agit alors d’avoir la possibilité de distinguer un dedans et un dehors (avec
les limites que cela implique et naturellement l’espace qu’elles entourent, base du futur Moi).
Les modes de fonctionnement de ce système apparaissent comme essentiellement liés à
l’entrée ou à la sortie ; ils seront présidés par le phénomène de l’introjection (mise en dedans)
et la projection (mise en dehors) sans qu’il n’y ait pourtant, jamais à ce stade unipolaire par
excellence, la constitution possible d’une distanciation objectale véritable et sans qu’il n’y ait
non plus de différenciation entre la réalité intérieure et le milieu environnant.
La répétition successive des périodes d’absence puis de retour de la mère ou de la personne
chargée de donner des soins à l’enfant, entraîne la mise en jeu successive de périodes
hallucinatoires, de périodes de désirs (avec insuffisance des satisfactions qu’elles entraînent)
et la différenciation de la satisfaction véritable par la présence réelle de l’objet extérieur dont
l’enfant a besoin.
Les alternances de période de satisfaction ou de besoin correspondent elles-mêmes aux
manifestations alternées des pulsions, particulièrement de la pulsion alimentaire, sans qu’il
n’y ait, à ce stade, absence d’éprouvé d’un autre ordre.
Les sensations alternantes de plénitude et de vacuité, de bien-être et de manque, ne tarderont
pas normalement à organiser le sujet en entité fonctionnelle comme lieu d’éprouvé et pour
tout dire comme sujet…
Ce lieu est primitivement unique au début, seul existe le sujet d’impressions dans son
vécu unipolaire ; la répétition de la présence et de l’absence jointe à la satisfaction et au
manque permettra peu à peu d’isoler le sujet éprouvant de son pôle extérieur et, de fait, de ses

4
expériences. Il va se trouver dissocier selon une ligne fonctionnelle de démarcation par
l’absence possible et le manque.
La permanence de l’éprouvé et l’immédiateté de la perception délimitent le secteur propre du
sujet et de son milieu intérieur.
Chez le sujet « normal », le passage de cette situation fusionnel et narcissique unipolaire à la
reconnaissance progressive d’une distanciation bipolaire sujet-objet inaugure les premières
manifestations de l’autonomisation du Moi séparé peu à peu du milieu environnant…
L’existence d’un Moi séparé de l’objet qui le fonde, signe le passage d’un mode d’existence
unipolaire à la bipolarité objectale. Ce passage tranche ce que les analystes appellent « la
situation pré-objectale » caractérisant le mode de relation d’objet du même nom, différencié
de la relation dite « objectale » caractérisée par la séparation du sujet et de l’objet.
L’heureux aboutissement de ce processus maturant, dit « personnation » selon
RACAMIER, délimite également le dépassement de la zone de fonctionnement psychotique
et l’entrée dans la problématique névrotique…
Sur le plan d’un fonctionnement mental, l’organisation d’un Moi séparé du non-Moi va
permettre la différenciation entre la réalité extérieure et la réalité intérieure (fantasmatique).
Elle s’avère contemporaine de la manière d’être comportementale et psychique, particulière,
articulée de façon fondamentale sur la reconnaissance implicite du sujet séparé des objets.
La séparation est susceptible d’être exprimée dans ses contenus psychiques par les
représentations et enfin transmissibles verbalement.
C’est précisément l’acquisition de cette existence séparée, de ce Moi-personne, qui
s’avère défaillant chez un patient psychotique.
2. HISTORIQUE
D’après le dictionnaire de la psychanalyse de Elisabeth ROUDINESCO et de Michel
PLON : bien que la mélancolie occupe une place importante dans le dispositif freudien, les
plus belles études sur cette question furent produites par les poètes, les philosophes, les
peintres et les historiens qui lui avèrent un statut théorique social, médical et subjectif.
Depuis la description de BELLEROPHON - héros poursuivi par la haine des dieux
pour avoir voulu escalader le ciel - jusqu’à la théorisation par ARISTOTE « du génie
mélancolique » en passant par le récit mythique d’HYPOCRATE sur les animaux pour y
trouver la cause de la mélancolie du monde, cette forme de déploration perpétuelle fut
toujours à la fois l’expression d’une rébellion de la pensée et de la manifestation la plus
extrême d’un désir d’anéantissement de soi lié à la perte d’un idéal…
Pendant des siècles, c’est la théorie d’HYPOCRATE - « les quatre humeurs » - qui
ont permis de décrire, de façon à peu près identique, les symptômes cliniques de ce mal :
- humeur triste
- sentiment d’un gouffre infini
- extinction du désir et de la parole
- impression d’hébétude suivi d’exaltation
- attrait irrésistible pour la mort, pour les ruines
- vécu de nostalgie et de deuil.

5
Ainsi la mélancolie était elle associée à la « bile noire » à côté des trois autres humeurs :
le sang, la bile jaune et le flegme.
« Le sang imite l’air, augmente au printemps, règne dans l’enfance.
La bile jaune imite le feu, augmente en été, règne dans l’adolescence.
La mélancolie ou bile noire imite la terre, augmente en automne, règne dans la maturité.
Le flegme imite l’eau, augmente en hiver, règne dans la vieillesse »
La bile noire, donc la mélancolie, serait une maladie de la maturité, de l’automne, de
la terre. Elle peut se diluer dans les autres humeurs et aller de pair avec la joie et le rire (le
sang), avec l’inertie (le flegme) et avec la fureur (la bile jaune). Par des mélanges, elle
affirmerait ainsi sa présence dans toutes les formes d’expression humaine.
De là, naîtra l’alternance cyclique entre un état et un autre : manie et dépression,
caractéristique de la nosographie psychiatrique moderne.
Cependant en tant qu’humeur noire, la mélancolie relevait du mal de SATURNE - Dieu
terrien des romains - morbide et désespéré, identique à CHRONOS de la mythologie grecque
qui avait châtré son père OUROS avant de dévoré ses enfants.
On appellera donc les mélancoliques, « les saturniens » ; mais, chaque époque a
construit sa propre représentation de la maladie…
On pensait aussi que certains climats favorisaient le mal car la maladie est plus
fréquente dans les pays nordiques que dans les contrées méridionales.
Le médecin anglais THOMASWILLIS (1621 – 1675) fut le premier à rapprocher la
manie de la mélancolie pour définir un cycle maniaco-dépressif.
Le philosophe Robert BURTON (1577 – 1640) avec « Anotomy of Melancoly »
donne la version d’une nouvelle conception de la mélancolie déjà entrée dans les mœurs.
Dès la fin de Moyen Age, le terme était en effet synonyme de tristesse sans cause, et à
l’ancienne doctrine des humeurs s’était progressivement substituée une causalité existentielle.
On parlait de tempérament, en songeant à HAMLET devenu la figure par excellence du drame
de la conscience européenne : « un sujet livré à lui-même avec l’avènement de la révolution
copernicienne » ; tout en conservant l’ancien vocabulaire humoral de BURTON qui assimile
donc la mélancolie à un désespoir du sujet abandonné par Dieu.
A la fin du 18ème siècle et notamment à la veille de la révolution française, la
mélancolie apparaît comme le symptôme majeur d’un ennui distillé par la vieille société.
Elle semblait toucher aussi bien les jeunes bourgeois exclus des privilèges de la naissance que
les éclatés ayant perdus tout repère et sévissait aussi chez les aristocrates désœuvrés, privés du
droit de faire fortune, « ennui du bonheur » ou « bonheur de l’ennui ».
Sentiment de dérision ou aspiration au bonheur pour dépasser l’ennui, la mélancolie
fonctionnait comme un miroir où se reflétait la défaillance générale de l’ordre monarchique et
l’aspiration à l’intimité de soi.
Au 19ème siècle, avec l’instauration de la psychiatrie, la mélancolie fut sujette à de
nombreuses variations terminologiques, destinées d’abord à transformer « cet étrange bonheur
d’être triste » - comme le dira Victor HUGO - en une véritable maladie mentale sans fioritures
littéraires ou philosophiques puis à l’inscrire dans une nouvelle nosographie dominée par la
division entre psychose et névrose.
Elle fut appelée « lypémanie » par Jean Etienne ESQUIROL en 1722 puis « folie circulaire »
par Jean-Pierre FALRET en 1772. A la fin de ce siècle, elle sera intégrée par Emile
KRAPELIN à « la folie maniaco-dépressive » pour se fondre ensuite dans la psychose
maniaco-dépressive.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%