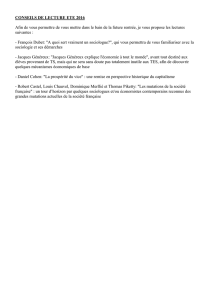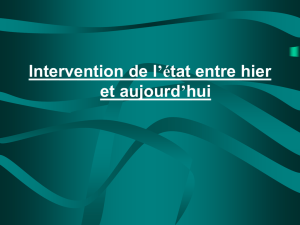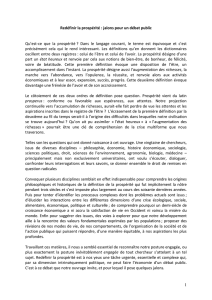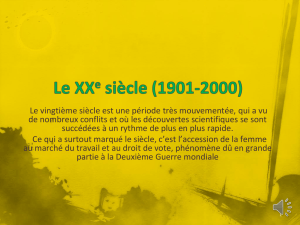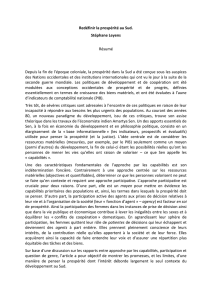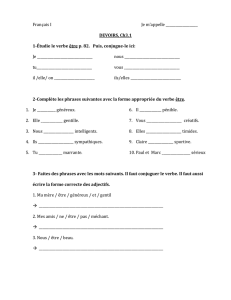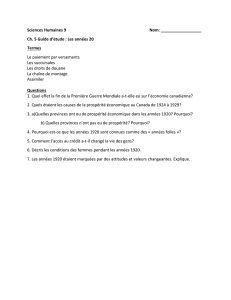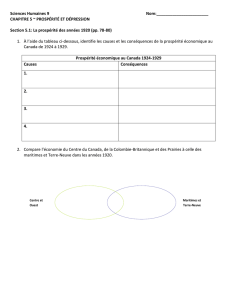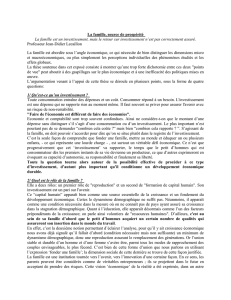«Il n`y a pas de retour de l`Etat»

«Il n’y a pas de retour de l’Etat»
http://www.liberation.fr//actualite/economie_terre/352671.FR.php?xtor=EPR-450206
Selon Jacques Généreux, le marché a toujours été défendu par la puissance
publique.
Jacques Généreux est professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, et auteur de La Dissociété (ed. Seuil,
2008).
L’interventionnisme du gouvernement américain pour tenter d’endiguer le krach financier marque-t-il le
retour de l’Etat ?
Il n’y a pas de retour de l’Etat parce qu’il n’a jamais reculé. Son poids n’a pas cessé d’augmenter aux Etats-
Unis. Simplement, il a changé de nature. Ce n’est plus un Etat-providence qui redistribue, c’est un Etat
privatisé, au service des marchés, des profits. Il n’a cessé de donner plus de liberté à la finance, aux
entreprises. Quand celle-ci débouche sur la crise, il doit intervenir en urgence.
Mais jamais le gouvernement n’avait lâché autant d’argent pour sauver son économie…
Il n’a pas le choix. Il paie aujourd’hui le prix de son engagement au service de la dérégulation, de la
déréglementation, du laisser-faire au service du capital. Ce n’est pas la finance qui est devenue folle, c’est
l’Etat américain qui l’est. Il l’a laissé prospérer et elle risque de tout emporter ! Il joue l’Etat pompier, alors
que c’est lui l’incendiaire.
Et c’est nouveau, ça ?
Non, les Etats-Unis sont depuis longtemps schizophrènes : très libéraux en microéconomie (entreprises,
marchés) et très keynésiens en macroéconomie (politique économique). Depuis la rupture du contrat social
hérité des Trente Glorieuses et l’avènement des idéologues du néolibéralisme, cette schizophrénie s’est
aggravée.
C’est-à-dire ?
D’un côté, l’Etat fédéral se désengage de ses prérogatives sur le social, l’éducation, les retraites,
engendrant une société plus dure et plus inégalitaire que jamais. Alors, de l’autre côté, pour éviter le
désordre social, il est obligé de garantir la croissance et l’emploi par une forte intervention sur la politique
budgétaire et monétaire. Mais la violence sociale persiste. Et cet Etat de classe devient de plus en plus un
Etat pénitence et un Etat policier. Objectif, donc : assurer l’ordre social chez les plus pauvres, maintenir la
prospérité économique chez les plus riches. D’où cette rhétorique néolibérale du «on a rien sans rien», qui
vient substituer le workfare (allocations conditionnelles) au welfare (aide publique généralisée). Et ce
n’est pas vrai que pour les Etats-Unis.
Une page de l’histoire du capitalisme dérégulé est-elle quand même en train de se tourner ?
Il faudrait pour cela qu’on sorte de la logique de l’Etat qui met des rustines, écope, alors que le bateau
prend l’eau de toute part, faute d’avoir cloisonné les secteurs financiers (banques, assurances,
crédits, etc). Il faudrait sortir, comme après chaque crise, des débats sur la morale, la transparence, la chasse
aux bandits Et s’attaquer au débat de fond : changer de cap.
Changer de système, ou mieux le réguler ?
Arrêter d’avoir une confiance aveugle en le marché comme seul règle de prospérité. Encadrer la libre
circulation des capitaux. Créer des agences de notation publiques… Or, pour l’instant, personne ne remet
en cause cette erreur fondamentale du marché roi. Bref, avoir un contrôle plus aigu, en amont des crises,
pour éviter qu’elles ne se reproduisent aux Etats-Unis, comme c’est le cas depuis vingt ans. Même l’Europe - et
la France sous Sarkozy - reste fascinée par les sirènes du moins d’Etat.

Donc, vous ne croyez pas à un changement de paradigme, malgré l’ampleur du séisme ?
Non, parce que la question, ce n’est pas : «plus ou moins d’Etat ?» C’est : «quel Etat veut-on ?» Entre 1970
et 2000, décennies du libéralisme, les dépenses publiques sont passées de 31,6 % à 35,8 %. Mais c’était plus
d’aide aux entreprises, aux dépenses militaires et moins de social. Depuis, les taxes sur le capital baissent,
celles sur le travail augmentent. La crise des subprimes n’infléchira pas la tendance.
1
/
2
100%