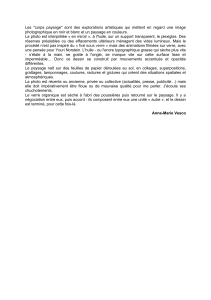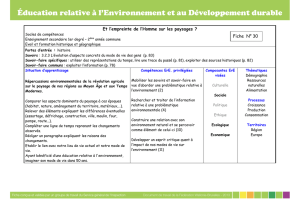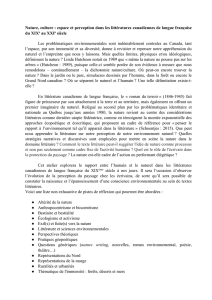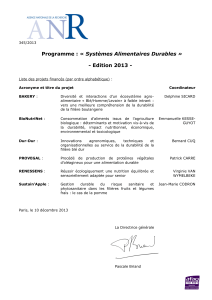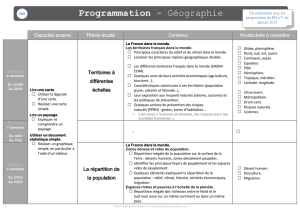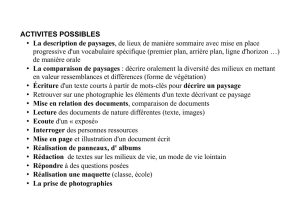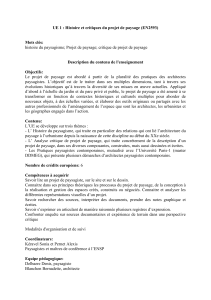Groupe de travail Paysage et environnement, qualité et ressource L

1
Groupe de travail Paysage et environnement, qualité et ressource
L’enjeu environnemental et celui de la ressource sont au cœur des préoccupations sociales et
politiques du début du vingt-et-unième siècle. L’état de tension entre le niveau d’exploitation
des ressources de la planète et la capacité du système à les reconstituer se traduit par un
transcodage visant à construire des "problèmes d'environnement" en mobilisant l'idée forte de
crise, par une accélération des réactions et par des propositions visant à réorienter la marche
du monde dans un contexte marqué par l'incertitude : incertitude de la production des
diagnostics (qui réinterroge à la fois l'état de la connaissance, les méthodologies et les
modèles conceptuels), incertitude du contrat entre les acteurs présents sur la scène mondiale
(Milani, 2000), incertitude sur l'avenir (le devenir des personnes).. L’idée de ressources
« naturelles » « extérieures aux sociétés, et quantifiables en dehors d’elles » qui
« détermineraient pour un milieu donné le rapport du nombre à l’espace, à travers certaines
normes » (G. Dupré, 1996) persiste. Dans ce cadre, manipulations symboliques et conflits de
représentation interviennent sur fond de nouvelles territorialisations des pouvoirs et de
redéfinitions participatives des biens communs. Notion de bien commun qui est réhabilitée
(en ré-émergence ?) à travers l'idée de crise (globale, multi-échelle ?), qui cristallise l'idée
d'un besoin urgent d'action par une réponse collective.
L’analyse de la construction symbolique des territoires apparaît dans ce contexte comme un
moyen pertinent d’aborder la question des rapports « local/global » et
« particularisme/universalité ». Elle inclut celle de la fabrique des représentations, des
identités territoriales et des formes de la patrimonialisation. A ce grand questionnement se
rapportent les travaux ayant trait à l’espace vécu et à la représentation paysagère du territoire,
à la promotion du sensible dans les processus de distinction sociale et spatiale, à l’articulation
des relations nature/culture.
Qu’ils interviennent sur la gestion des ressources, l'analyse des modes de spécification et
d'activation de ressources, la qualité, les paysages et/ou la protection/conservation de la
nature, les membres de ce groupe (géographes, historiens, économistes et écologues), entrent
dans le projet de recherche en réponse à l’injonction politique et sociale au développement
durable et à la gouvernance territoriale. Ils ont en commun de relier leurs recherches à des
formations de type professionnalisant (masters en aménagement, développement et
environnement, formation des ingénieurs, formation des paysagistes). La confrontation des
temporalités, celle de l’action et de la recherche, voire de la formation, est au cœur la
problématique.
Le problème de la confrontation des scènes de la recherche et de l’action est posé sur le plan
de la légitimité et de l’éthique dès lors que l’action devient sujet de recherche, que le
chercheur côtoie les procédures territoriales, voire intervient dans le jeu des procédures. La
science est envisagée dans son rapport à la société : on conçoit donc une certaine position des
représentations savantes par rapport aux représentations profanes et on envisage leur inter-
alimentation.

2
La recherche pose ainsi le problème des catégories héritées de l’action (la nature, le paysage,
la ressource, le territoire), des normes (normalisation de la qualité et de la valeur, délimitation
de zonages) qui ordonnent les savoirs sur l’espace ou les formes d’action sur les
environnements. Elle interroge le statut et la représentation de la limite et de la frontière dans
le contexte du développement d’une nouvelle spatialité.
Traiter la question des catégories et des limites renvoie ainsi à une interrogation de type
épistémologique et méthodologique dont découlent la critique et la refondation des codes de
l’expertise.
Positionnement du groupe de travail dans le projet quadriennal
Cette déclinaison du projet de laboratoire s’inscrit dans la double dialectique de l’urgence et
de la durabilité d’une part, de l’ancrage et du mouvement de l’autre.
La première privilégie la durée et le point de vue temporel (passé, présent, futur). Il s’agit
notamment d’identifier les différentes modalités historiques de gestion des ressources ainsi
Quantification
Contrat
Biens communs
Savoirs partagés
Urgence
Durabilité
Ancrage
Mouvement
Paysage
Environnement
Ressource
Qualité
Evaluation
de l’action
Ethique
Qualification
ANR Nature
Projet ISVV …
Intitulé n
Groupe de travail
Projet de laboratoire
Injonctions politiques
Méthodes et outils
Matériel
Immatériel
Artefactuel
Naturel
Symbolique
Signe
Programmes

3
que les pratiques sociales associées. La question de la crise environnementale, de la
construction des représentations, de la montée des tensions sociétales et des réponses qui y
sont apportées tant technologiques que comportementales (adaptation, conflits…) est ainsi
productrice d’innovations.
La seconde peut, quant à elle, mobiliser préférentiellement la dimension comparative en
s’appuyant sur l’analyse de diverses situations (tant en Europe que dans les Pays du sud). Elle
renvoie également à la prise en compte des transferts de biens et de services dans le cadre de
réseaux plus ou moins organisés et plus ou moins pérennes.
Les travaux sur le paysage, la qualité, la ressource et l’environnement viennent alimenter la
réflexion globale sur les notions de bien commun, de savoirs partagés et de contrat. Ces
travaux sont très largement nourris des résultats du programme quadriennal 2007-2010 du
laboratoire sur la territorialisation du développement durable et la gouvernance.
L’idée générale est de réinvestir des constructions a priori robustes à l’aide de notions plus
floues : la question environnementale au regard des définitions multiples du paysage ; celle de
la ressource à celui de la qualité.
L’injonction politique à la production de méthodes de représentation et d’indicateurs des états
de l’environnement pose la question de l’universalité des phénomènes à observer et du prisme
à travers lequel ils sont observés : idéologies et doctrines fondatrices, déroulé instrumental de
la production des connaissances, modèles d'analyse. La reproductibilité des procédures ou le
caractère plus ou moins objectif des protocoles est au cœur du projet. La confrontation des
méthodes et des outils, quantitatifs et qualitatifs, l’étude de l’impact des choix
méthodologiques sur les résultats de la recherche renvoient à la question de l’interobjectivité
de la science (Hoyaux 2008) imposée par la pluridisciplinarité de l’équipe.
Cette dimension épistémologique et méthodologique alimente les ateliers transversaux du
projet quadriennal relatifs aux méthodes (quantitatif / qualitatif - séminaire GRANIT) ; à
l’évaluation de l’action ou à l’expertise de l’expertise ; aux questions éthiques, dès lors que le
chercheur s’engage sur le terrain territorial et y impose implicitement sa légitimité et son
autorité scientifique.
Nous ne retenons sur le schéma que la dimension problématique du projet, les programmes
qui l’alimentent sont présentés pour mémoire et de façon non exhaustive.
Les entrées dans le projet de laboratoire
Le paysage et l'action publique constituent deux entrées efficaces dans les problématiques
centrales du projet de laboratoire :
— celle du contrat, au sens où le paysage et l'environnement apparaissent aujourd’hui
comme des objets autour desquels se renégocient les conditions d’un « vivre
ensemble » fondé sur un double contrat territorial et environnemental. Le paysage, y
compris dans son caractère flou et ses redéfinitions permanentes, comme les
ressources environnementales ou plus globalement territoriales portent ainsi la
question de l’identification et de la reconnaissance collective d’un bien commun,
relevant d’une construction indissociablement matérielle et symbolique, autour duquel
se dessine la perspective (illusoire ?) de nouveaux pactes sociaux (voire/y compris la
question de l'identité). Derrière la question du paysage ou de la protection/gestion de
la nature réside également celle d’une redéfinition de la ressource et de la qualité, à la
frontière entre immatérialité et matérialité. Les constructions territoriales et les jeux de

4
spécification et d’activation des ressources qui les fondent exigent en même temps
qu’elles s’insèrent dans des dispositifs collectifs où le contrat, formel ou informel est
fondamental. Les coordinations, le respect de règles du jeu, la définition même de ces
règles fondent ces constructions nécessairement collectives. La ressource activée et
spécifiée constitue un bien collectif, un bien commun voire un bien public, la
territorialité qu’elle construit également (SIQO par exemple).
— celle des savoirs partagés, la question paysagère ou de la gestion environnementale
portant fondamentalement celle de la prise en compte des savoirs et de l’expérience de
l’ « habitant » ce qui amène à interroger les rapports entre ces savoirs locaux et ceux
de l’expert et du scientifique, et pose la question des savoirs partagés. Autant derrière
les savoirs scientifiques que vernaculaires, la construction des discours et des identités
qui s’y trouvent associées tentent d’authentifier « l’originalité » (au sens qualitatif et
quantitatif, situé et temporalisé à travers l’ancienneté ou l’exclusivité de la présence
par exemple) à travers un ensemble de signes et d’artefacts qui interfèrent dans la
rencontre entre naturel et symbolique, matériel et immatériel en fondant un ensemble
de procédures de conformation des habitants par les scientifiques et des scientifiques
par les habitants dans l’interprétation de la réalité géographique. Tel espace sans
signification devient paysage-ressource du fait d’un nouvel éclairage sociétal à travers
les chaînes de la recherche qui vont de l’interrogation de l’habitant (temps 1) sur son
savoir vernaculaire aux chercheurs qui en tirent des conclusions plus ou moins
objectivantes (temps 2) et reconstruit in fine de part sa légitimité l’objectité ré-évoqué
par l’habitant (temps 3). Tel espace anomique devient environnement de qualité du fait
d’un dispositif sociétal de mise en valeur spécifique et dès lors spécifié (textes,
normes)
Ces deux entrées sont également pertinentes dans la théorisation de l’action.
— Elles amènent à interroger les sciences de l’espace dans leurs fondements : les
configurations spatiales, les topologies, la question des échelles, de l’exhaustif et de
l’échantillonné ;
— Elles posent la question des délimitations, d'une géographie “maniaque du découpage
et de la limite” (Retaillé 2008) : forme de discrimination qui rassure les ingénieurs et
décideurs territoriaux là où le rapport des sociétés à leur environnement fait plus appel
au "fondu enchaîné", aux réarrangements permanents.
— Elles situent les enjeux au carrefour de la science territoriale (social,
environnemental), sollicitée pour produire des indicateurs, et interrogent sur
l’utilisation des méthodes, des représentations et des données, quantitatives ou
qualitatives, en lien avec la question de l’objectivation des productions de la science.
La ressource offre une ouverture distincte sur l’interaction entre matériel et immatériel. Un
élément naturel ou un certain potentiel, ne devient ressource que par l’usage qu’en font les
sociétés humaines et la valeur qu’elles lui donnent. Sans nier la part de naturalité de certaines
ressources qui permet de donner une place aux matérialités paysagères et aux processus
biophysiques de l'environnement, ni l’actualité des enjeux liés à leur utilisation optimale,
notamment dans la perspective de leur exploitation durable, la notion de ressource,
mobilisable sur un territoire donné, peut être étendue à d’autres domaines : ressources
humaines, ressources touristiques, ressources financières… Dans une telle perspective, la
ressource fait signe et est une construction éminemment sociale, fondée sur des usages, des
pratiques et des représentations sociales à un moment donné et il ne peut exister de modèle de
gestion générique applicable partout.

5
Finalement la notion de ressource biophysique, économique ou humaine, y compris dans sa
dimension symbolique (c’est-à-dire de mise en sens par l’habitant et/ou le scientifique) ou
immatérielle (informations) peut être considérée comme l'ensemble des potentialités et des
capacités susceptibles d’être mobilisées, mises en œuvre et gérées par une société. De ce point
de vue, les ressources en tant que système constitué de différentes composantes différenciées
selon leur finalité (alimentation, énergie, etc.) sont des éléments structurant les territoires
entendus comme des espaces appropriés, avec le sentiment ou la conscience de leur
appropriation. Néanmoins, les principes d’organisation spatiale qui résultent de cette
structuration sont sans doute différents selon la nature de la ressource (homogénéité,
emboîtement, polarisation).
Problème de transition.
Quoi qu'il en soit, l’utilisation de l’une ou de l’autre de ses composantes se traduit in fine par
des répercussions sur les autres. A ce titre, l’environnement, considéré comme un système
évolutif complexe incluant ces différentes composantes, s’inscrit dans l’espace (des
dimensions de proximité jusqu’aux plus globales) et dans la durée (propriétés d’homéostasie,
capacités de résilience, adaptations des systèmes…). Il est le résultat de l’imbrication de
socio-systèmes et d’écosystèmes.
1. Temps du projet/durabilité/action sur l’espace
Cet axe de recherche alimente la réflexion sur la dialectique urgence/durabilité. Il s’agit d’un
axe potentiellement transversal à de nombreuses thématiques abordées par ADES.
Nous partons de l'hypothèse que le temps ordinaire de l’élaboration des projets est le temps de
l’urgence, presque une urgence programmée. Le projet est une des formes de réponse
opératoire à une situation, à un problème qualifié d'urgent. Il est fondamentalement
producteur de décision et d'action. Les pratiques des professionnels de l’environnement et du
paysage, de l’aménagement et du développement s’ordonnent de fait, en ce domaine, autour
d’une gestion et d’une culture du faire-vite, du stress créatif et du résultat immédiat ou plutôt
de la proposition/action immédiate mais paradoxalement (?) à visée durable. Elles cultivent
l’immédiateté, qui est le temps de l’individu (du porteur de projet ?) plutôt que celui du
groupe social. Le projet-urgence porte une valorisation du sujet-décideur et une dévalorisation
(voire une négation) symétrique des sujets pour qui l’on décide. S’intéresser au projet sous
l’angle de sa temporalité amène ainsi à poser le problème du rapport sujet/collectivité, des
conditions et des limites du concerté et du participatif dès l'amont du projet. Cela amène aussi
à s'interroger sur le cercle d'auto-reproduction, d’auto-légitimation du projet : règne des
bailleurs qui identifient les priorités, donc les urgences, définissent les projets et les évaluent à
l’aune de leur propre culture (financière et communicationnelle : résultats visibles et
immédiats ; évaluation quantitative et sectorielle par exemple) ; règne des experts qui
reproduisent les modèles et les procédures de manière indifférente selon les situations
rencontrées. Reprenant Crozier et Tillette (La crise de l’intelligence. Essai sur l’impuissance
des élites à se réformer), l’urgence est sans doute aussi celle qui privilégie la proposition de
solutions à la définition des problèmes. Enfin cela pose également sous un angle original le
problème des savoirs-experts.
Le projet
Le projet-urgence cultive l’hypothèse (vite transformée en « concept » ordonnateur de
l’action) plutôt que la démonstration, l’itération, le chemin faisant plutôt que la procédure
maîtrisée et prédéfinie à l’avance. Sa temporalité n’est donc pas épistémologiquement neutre.
Que signifie, sur cette base, produire des connaissances « implicables » (au sein d'une
géographie impliquée) dans les processus de projet ? Si le projet (cf. Boutinet :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%