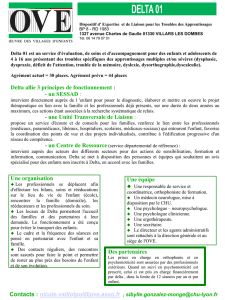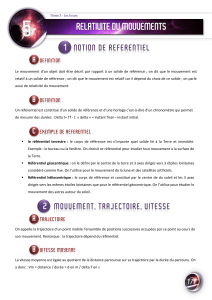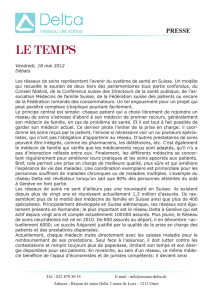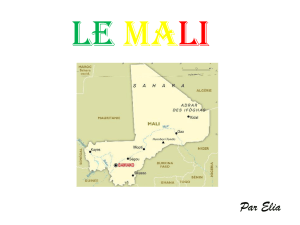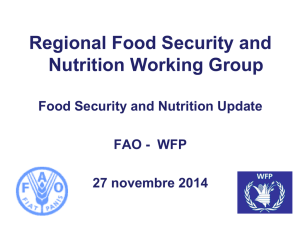MINISTERE DE L`AGRICULTURE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI
-=-=-=-=- Un Peuple-Un But-Une Foi
INSTITUT D’ECONOMIE RURALE _________
-=-=-=-=-
DIRECTION SCIENTIFIQUE
-=-=-=-=-
Etude des pratiques de gestion de Echinochloa stagnina (burgu) dans le nord du Mali :
Une ressource pastorale vitale du delta intérieur du Niger au Mali
Amadou KODIO,
Lassine DIARRA
Aly KOURIBA
2008

1
1
Sigles et abréviations
DIN : Delta intérieur du Niger au Mali
UNSO: United Nations Sudano-Sahelian Office
MS : Matière sèche
CIPEA : Centre International Pour l’Elevage en Afrique
ODEM : Opération pour le Développement de l’Elevage dans la région de Mopti
HUICOMA : Huilerie Cotonnière du Mali
IER : Institut d’Economie Rurale
DNE : Direction Nationale de l’Elevage

2
2
INTRODUCTION
Comprise entre 13°30 et 16°30 de latitude nord, le delta intérieur du Niger au Mali (DIN)
est un écosystème original situé au cœur du Sahel malien. Il forme une vaste pénéplaine
alluviale de près de 30.000 km2 inondable par les eaux de crue du fleuve Niger et de son
principal affluent le Bani, ainsi que leurs nombreuses ramifications de chenaux qui
alimentent par ailleurs de multiples mares et lacs. Dans les zones d’inondations s’étendent
de vastes savanes ou prairies aquatiques constituées de graminées à tiges flottantes
souvent dénommées bourgou ou bourgoutières, du nom peul pour désigner des
pâturages inondés. Elles se rencontrent ailleurs au Zaïre, au Sénégal, au Niger, en Asie
tropicale, à Madagascar, au Soudan, dans la cuvette du lac Tchad et dans celle de
l’Okavango au Botwana,
L’essentiel de cette zone se situe dans la 5e région administrative du Mali, la région de
Mopti. Grâce à ses vastes prairies naturelles ou « bourgoutières » elle renferme à elle
seule plus de 70 % du potentiel des terres irrigables du Mali (Sada Sy, 1995 cité par
Michèle Adesir, 1999), et abrite environ 50 % du cheptel malien surtout pendant la longue
période sèche qui s’étale sur plus de 8 mois au Sahel, et fait vivre plus de 300.000
personnes du secteur de la pêche.
La diversité de ses ressources explique la diversité des populations, chacune avec sa
spécialisation pour un mode d’exploitation ou l’un des trois systèmes de production (la
pêche, l’agriculture et l’élevage). Traditionnellement chacun de ces systèmes est pris en
charge par un groupe ethnique dominant (la pêche par le bozo, l’élevage par le peul et
l’agriculture par le groupe rimaïbé-marka). Avant les sécheresses des dernières
décennies, l’abondance des ressources avait favorisé la cohabitation harmonieuse de
toutes les communautés socioprofessionnelles en présence. Depuis les épisodes de
sécheresses persistantes, devant ressources de plus en plus limitées sous la péjoration
climatique, chaque ethnie cherche à diversifier sa production au risque d’empiéter sur le
voisin contrairement l’ordre ancien. Les règles de partage et d’exploitation des ressources
clairement établies, suivant la trilogie hiérarchique élevage, pêche, agriculture, pendant la
période de la Dina (1818-1842) ne sont plus respectées. Aujourd’hui, on assiste plutôt à la
prédominance de l’agriculture. Les conflits fonciers entre les différents utilisateurs sont
ainsi devenus fréquents, surtout entre les éleveurs transhumants à la recherche des
fourrages et de l’eau et les agriculteurs occupant pâturages et quelque fois les pistes
d’accès à ces ressources.
1. Potentialités fourragères des bourgoutières
En considérant l’ensemble des associations végétales dans lesquelles le bourgou a le
statut d’herbacée dominante ou codominante, il apparaît que les bourgoutières couvrent
240 000 hectares, soit 8,9 % de la superficie des communes qui les englobent
(Jérôme. M, 2000).Ce sont les parcours les plus productifs du delta intérieur du Niger.
Ils peuvent fournir une biomasse de 35 000 kg de matière sèche à l’hectare. La
production médiane se situe autour de 20 000 kg, ce qui fait d’elles les pâturages les
plus recherchés de l’Afrique de l’Ouest. Une bourgoutière totalise environ 6000 kg de
repousses à l’hectare entre la fin de la pâture d’entrée (que l’on compte sur un mois) et
le mois de juin, avec un taux de consommation de 70 %.(Hiernaux et al 1983)
Si 40 communes sur 51 possèdent une bourgoutière, la superficie occupée par les
bourgoutières varie fortement d’une commune à l’autre. Quatre communes, à savoir

3
3
Deboye, Toguére Coumbe, Kewa et Youwarou cumulent 100 000 hectares. Par contre, les
communes les moins pourvues, au nombre de quatorze, ne disposent que de 8 000
hectares. Les bourgoutières sont abondantes dans le nord, au niveau du lac Débo, mais
aussi autour de Toguére Coumbe, Tenenkou, Mopti et dans la cuvette du Yongari. Elles
dessinent une forme de fer à cheval autour du lac Débo (Jerome . M, 2000).
Les données du projet UNSO à Tonka en 1989 indiquent des productions de l’ordre de
15 à 32 tonnes de MS à l’hectare obtenues dans des bourgoutières régénérées de 4 à 5
ans d’âge.
Les relevés effectués en 1990 par Kodio et al ont indiqué des productivités primaires de
l’ordre de 3 à 8 tonnes et ceux les plus récents effectués en 2005 (tableau 1) donnent des
biomasses très variables selon les sites de 0.2 tonne à 20 tonnes de MS/hectare .
Tableau I : Biomasse fourragère de 4 bourgoutières dans le DIN (2005)
Nom site
cercle
Biomasse
moyenne
t.m.s. /ha
Variabilité biomasse
t.m.s. /ha
mini médian maxi.
Koubaye
Sévéri
Walado
Yongari
Mopti
Tenenkou
Youwarou
Djenné
5.88
4.86
15.03
5.01
02 06 17
0.2 05 07
13 15 20
02 05 07
Les coordonnées géographiques de ces sites sont connues
Cet inventaire mené à l‘échelle du DIN en 5e région montre une très grande variabilité
quantitative du bourgou suivant les années et les sites.
2. Modélisation de la production du bourgou
Sur la base d’une étude effectuée entre 1980 et 1983 par les chercheurs du CIPEA et de
l’ODEM, intitulé « Recherche d’une solution aux problèmes de l'élevage dans le Delta
intérieur du Niger au Mali (5 volumes, 54 cartes au 1/50 000) » et des simulations
réalisées dans un système d’information géographique intitulé « DELMASIG : Homme,
milieux, enjeux spatiaux et fonciers dans le delta intérieur du Niger (Mali) publié en 2000
par J. MARIE, les formations végétales du delta et leurs relations avec la crue ont pu être
modélisées..
Pour la composition floristique, chaque formation végétale est caractérisée par deux
valeurs de référence :
- la valeur indicatrice des espèces, codée de 0 à +++, qui définit l’intensité de
liaison entre l’espèce et la formation végétale ;
- l’abondance dominance des espèces.
La première est indiquée par des seuils de probabilité de présence ou d’absence de
l’espèce dans la formation végétale. La seconde est indiquée par la distinction de trois
catégories d’espèces : les dominantes, les accompagnatrices et les occasionnelles,
chacune représentant respectivement, 80, 15 et 5 % de la biomasse végétale. (Tableaux
II, III et IV.).
Le suivi de l’évolution de ces valeurs de référence peut servir d’indicateur de la dynamique
de la flore de la formation végétale considérée.

4
4
Tableau II : Code représentant l’intensité des liaisons espèces/profil floristique ou
profil/état des variables.
Code
Signification statistique
+++
L’espèce est significativement sensible à l’état de la variable au seuil de 1 0/00
++
L’espèce est significativement sensible à l’état de la variable au seuil de 1%
+
L’espèce est significativement sensible à l’état de la variable au seuil de 5 %
.
L’espèce n’est pas significativement sensible à l’état de la variable au seuil de 5%
0
Echantillon trop faible pour conclure ou absence de données
Source : Jerome Marie. (2000)
Tableau III : Le statut des espèces végétales en termes d’abondance – dominance dans
les formations végétales.
Code
Statut en terme d’abondance – dominance
HD
Herbacées dominantes
HO
Herbacées occasionnelles
HA
Herbacées accompagnatrices
LD
Ligneux dominants
LO
Ligneux occasionnels
LA
Ligneux accompagnateurs
Source : Jérôme Marie (2000)
Tableau IV: Exemple d’une bourgoutière à Echinochloa stagnina
Espèces dominantes ou
codominantes
Espèces
accompagnatrices
Espèces occasionnelles
Echinochloa stagnina
+++
Ipomea aquatica
+
Melochia corchorifolia
+
Voscia cuspidate
++
Nymphea lotus
++
Utricularia inflexa
+
Nymphea maculata
+
Vetiveria nigritiana
+
Polygonum spp
+
La production fourragère herbacée est modélisée en formulant des hypothèses tenant
compte de la hauteur de crue. Elle est représentée par trois valeurs :
le maximum qui correspond à des valeurs de pointe mesurées sur le terrain.
la valeur médiane qui correspond en moyenne à la production escomptée lors
d’une bonne crue ;
la valeur minima qui est celle obtenue lors d’une mauvaise année.
La production de repousse de saison sèche est décrite aussi par trois valeurs standard :
minima, médiane et maximale.
La connaissance des caractères de l’inondation permet donc à partir du modèle
DelmaSIG, de caractériser la production fourragère de l’ensemble du delta à partir des
valeurs des formations végétales individuelles. Quelques valeurs de production sont
données au tableau V
Tableau V : Production standard de quelques formations végétales du delta
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%