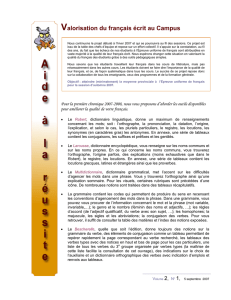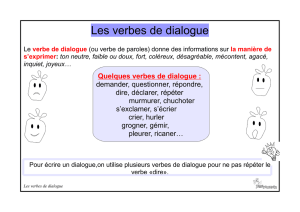Névéna Stoyanova

Névéna Stoyanova
L’idée locative
dans le français contemporain
Expressions verbale et circonstancielle
cours adapté pour LEA
partie I
………
[Extraits de l’ouvrage]
………
Avis au lecteur
L’ouvrage présent suit de près la classification lexicale exposée
dans le Cours systématique de langue française, partie constructive I,
celle qui étudie l’expression de l’idée de lieu (verbale et circonstacielle).
Il vise à adapter ce cours, destiné principalement à la formation des
étudiants en philologie française (et donc centré sur des textes et des
phrases en titre d’exemples surtout littéraires) aux besoins des étudiants
en LEA (Langues étrangères appliquées) à l’Université de Véliko
Tarnovo.
La traduction de textes relevant de la vie sociale et politique, liés
également au tourisme, l’économie et les communications, le droit, le
style des médias ou celui des guides touristiques, même des textes plus ou
moins techniques (instructions diverses, modes d’emploi, etc.) comprend
tout un éventail d’énoncés qu’on pourrait définir en général comme non-
littéraires. Par le biais des exemples pris de la langue vivante on pourrait
bien illustrer un grand nombre d’unités lexicales, reflétant les idées de
lieu, de mouvement, de qualité, etc., qui entrent dans la constitution non
seulement des textes littéraires, mais de même dans celle des textes non-
littéraires et enrichissent la culture langagière de tous ceux qui veulent
approfondir leurs connaissances pratiques sur la langue française
contemporaine.
Ce cours abrégé (partie I) ne s’occupe que de l’idée locative,
exprimée à l’aide d’un verbe ou d’une locution prépositive. Un nombre
de verbes/locutions mentionnés dans le Cours systématique de langue
française sont omis ou bien marqués avec des astérix (donc censés

facultatifs), puisque leur emploi dans les extraits de textes étudiés s’est
avéré assez rare.
Le principal, lors de l’élaboration de l’ouvrage présent, était de
mettre à l’épreuve la persistance des unités constructives étudiées dans les
heures de cours des étudiants en philologie française, dans les énoncés
socio-politiques, économiques, publicitaires, etc. Les unités lexicales
examinées sont suivies d’exemples illustrant leur emploi dans des
énoncés non-littéraires pris de préférence dans des articles d’éditions
périodiques françaises, tels Libération, l’Humanité, l’Express, le Figaro,
le Nouvel Observateur, le Monde, le Point; certains quotidiens français
régionaux (Lyon Capitale, le Courrier de Mantes, Ouest France, le
Parisien, le Journal du Jura, etc.), des médias éléctroniques (Radio
France, Radio-Canada, France 5, RFI), des agences de presse (AP, AFP,
Reuters), des textes juridiques pris de sites gouvernementaux (Legifrance,
Monde diplomatique), etc.
Chaque groupe de verbes ou de locutions prépositives renfermant
non seulement l’idée de lieu, mais aussi une idée secondaire (d’intériorité,
d’environnement, de superposition, etc.), est suivi par la rubrique Pour
approfondir qui comprend des exercices différents ayant pour but de
familiariser l’étudiant avec les spécificités constructives de l’unité
étudiée. La rubrique Définitions éclaircit certaines particularités
définitoires des verbes ou des locutions respectives. Dans le cours sont
inclus aussi des textes, français ainsi que bulgares, qui vont aider
l’analyse de l’idée de lieu.

«La différence des langues n’est pas une différence entre les sons et les
signes, mais une différence qui implique une conception différente du
monde.»
Wilhelm von Humboldt

L’IDEE LOCATIVE
А. VERBES LOCATIFS
(Expression verbale de l’idée de lieu)
L’idée locative vient se placer immédiatement après celles
d’existence et de qualité dans le processus de séparation du sujet de
l’objet, suivant “la hiérarchie notionnelle des verbes” (G. Guillaume,
1964; Chr. Todorov, 2003) et marque par conséquent le point
d’accomplissement d’une image achevée et plus ou moins statique des
substances qu’elle situe dans l’espace (et dans le temps). Elle indique le
moment d’extériorisation de l’objet, de séparation substance localisée -
substance localisatrice, sujet-objet.
C’est l’idée existentielle (exprimée généralement par le verbe être
existentiel) qui affirme le fait d’être d’une substance, sans quoi elle ne
peut pas prendre des attributs ou bien être localisée où que ce soit.
Ensuite, la substance existante continue à se préciser et à prendre forme
dans le processus d’attribution (on a recours à des verbes du type être
attributif), mais il ne s’agit encore pas de deux substances distinctes,
l’objet étant encore seulement une partie du sujet, donc la séparation est
intérieure et implicite.
Le premier mouvement d’extériorisation sujet-objet surgit lors du
processus de localisation, traduit par la troisième acception du verbe
fondamental être, ce être locatif auquel peuvent se réduire tous les autres
verbes à sens locatif. Le être locatif exprime l’idée pure de lieu sans
impliquer des idées supplémentaires. Il a pourtant un “défaut” dû au sens
assez abstrait, assez général, à cause duquel il nécessite une
concrétisation par des prépositions, formes participiales, etc.
Or, eu égard la polysémie des prépositions, dans bien des cas il est
préférable d’exprimer l’idée pure de lieu à l’aide de verbes locatifs à sens
moins général, tel le verbe se trouver, ou bien par le biais de tournures
participiales du type être + p.passé (être mis, placé, etc.).
Certes, on rencontre l’idée de lieu pure assez rarement. Dans la
plupart des cas c’est une idée locative complexe qui a lieu. A part l’idée
de situation générale, un grand nombre de verbes français impliquent de
même des idées secondaires qui déterminent plus précisément la
localisation des substances - objets de la parole. La classification des
verbes locatifs présentée dans l’ouvrage présent se base sur les divisions
principales suggérées par les prépositions locatives respectives (sur -
superposition, dans - intériorité, près de - proximité, etc.), comme
l’indique Kr. Mantchev (1998, p. 237-247). Nous avons donc respecté la

classification mise en place dans le Cours systématique de langue
française (1977). Il se peut qu’il y ait une systématisation plus actuelle et
élaborée, pourtant celle-là est assez adéquate pour rendre plus
compréhensibles, au point de vue sémantique, les spécificités des verbes
locatifs.
…..
► DEFINITIONS:
Les verbes au sein d’un même groupe de synonymes, exprimant ou non
une idée additionnelle, se distinguent un peu l’un de l’autre. Dans cette
rubrique certaines particularités constructives ou purement sémantiques
seront signalées et éclaircies.
1. Le verbe se situer (être situé) est préféré lorsque l’on veut localiser une
substance quelconque (au concret ainsi qu’au figuré) par rapport à un
système de repères (représenté par d’autres substances qu’on localise
indirectement) ou de coordonnées:
(ex.) a) Située entre 35° et 71° de latitude Nord, elle (l’Europe) jouit d’un climat dans
l’ensemble tempéré… (Dictionnaire de notre temps, Hachette)
b) Le fait nouveau de ces derniers mois, consécutif à la chute du mur de Berlin le 9
novembre 1989, c’est l’affirmation d’un autre courant nationaliste, situé, celui-là, à
l’extrême-gauche, dans la tradition socialo-jacobine. (Le Nouvel Observateur, J.
Julliard, 25 juil 1990)
c) Le véritable "choc des civilisations" se situe aujourd'hui entre "les sociétés
démocratiques" et les "théocrates, les extrémistes", a conclu M. Burg. (Courrier
International, 19 fév 2004)
2. Les tournures participiales qui suivent le modèle passif être+p.passé
perdent leur locativité (à l’exception de être situé – se situer; mais situer)
lorsqu’on leur redonne la forme active; ils se transforment en verbes de
mouvement. Comme s’est le cas de être posté – poster - se poster:
(ex.) Lundi, des salariés, dûment cagoulés, se postent sur le toit avec quelques
bonbonnes de gaz, des jerricans d’essence et des bouteilles d’acétylène. (Le Point, E.
Gernelle, 16 fév 2001)
3. La construction être campé se rencontre surtout au figuré et par
conséquent perd un peu l’idée purement locative. Elle exprime plutôt un
état (attitude de décision, audace, fierté).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%