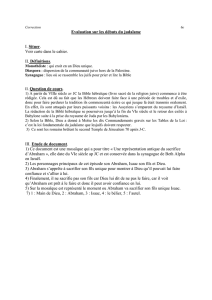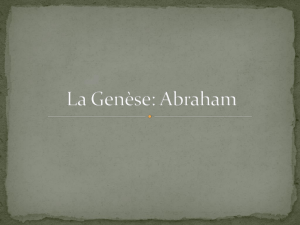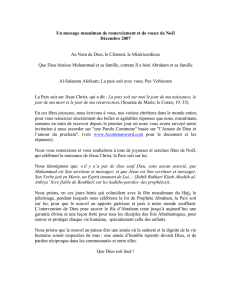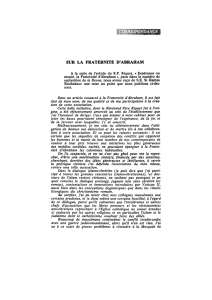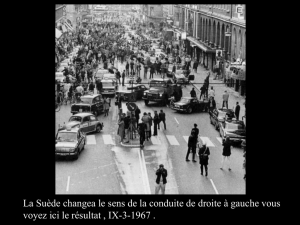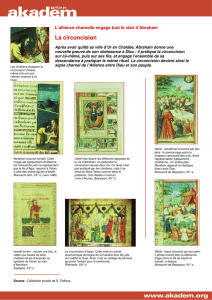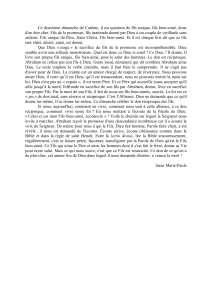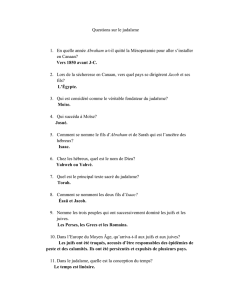fichier Word sans images - Retraites en ligne avec les Fraternités de

Sur les traces de la foi |
16
Atelier biblique en ligne | Sur les traces de la foi (© FMJ 2013)
http://retraites-avec-jerusalem.cef.fr
Vivre l’Année de la foi avec les Fraternités de Jérusalem
en lisant et méditant le livre de la Genèse
(Traduction © Bible de Jérusalem - Tous droits réservés)
Genèse 20-23
L’épreuve de la foi
Au fil de la Parole
L’annonce a été faite à Abraham : «L’an prochain, ta femme Sarah aura un fils» (Genèse 18,10). La
promesse tant de fois réitérée va s’accomplir ; la si longue attente va être comblée. C’est comme si, alors –
même si l’histoire de la rédaction en est la cause première –, comme s’il fallait revisiter les lieux et les
intermittences de cette attente, mais pour y voir émerger, toujours plus décisive, la figure de Sarah.
Tout semble se rejouer comme avec Pharaon en Égypte (12,10-20 ; cf. Atelier n°1), lorsque Abimélek, roi
de Guérar, fait enlever Sarah et que Dieu l’avertit en songe : «Tu vas mourir à cause de la femme que tu as
prise, car elle est une femme mariée» (20,3). Le mensonge, cette fois, a été partagé par Abraham et Sarah :
«N’est-ce pas lui qui m’a dit : ‘C’est ma sœur’, et elle, oui elle-même, a dit : ‘C’est mon frère’» (20,5). Et il
se révèle n’être qu’un demi-mensonge : «Elle est vraiment ma sœur, explique Abraham, la fille de mon père,
mais non la fille de ma mère et elle est devenue ma femme» (20,12). La méprise et le châtiment de Pharaon
s’étaient résolus par l’expulsion d’Abraham hors d’Égypte ; ici l’accent est mis sur sa qualité de «prophète»
(20,7), prise en son sens littéral de «celui qui parle devant Dieu» ; qualité qui lui permet d’intercéder pour la
guérison d’Abimélek et de sa maison (20,17). Ici, le roi répare son offense en donnant à Abraham «petit et
gros bétail, serviteurs et servantes», et en ouvrant le pays devant lui (20,14) ; il couvre Sarah de cadeaux,
«comme un voile porté sur les yeux de tous» (20,6).
À travers ce faux pas, ce bégaiement apparent de l’histoire, le temps approche de la réalisation des
promesses : une alliance est nouée avec Abimélek, qui ne sera troublée que par quelques disputes de bergers
autour des puits (21,25-3). Même s’il ne possède pas encore la terre que le Seigneur lui a promise, Abraham
déjà peut, en paix, y séjourner longuement ; et ce Dieu qui lui a promis le pays «en possession à perpétuité»
(17,8), il peut l’invoquer sous le vocable de «Dieu d’éternité» (21,33). Quant à Sarah, «la princesse», elle
n’est plus l’objet d’un marchandage ; elle est définie comme une femme «justifiée» (20,16),
symboliquement revêtue du voile qui distinguait la femme mariée, pleinement reconnue comme épouse
d’Abraham, capable de lui donner une postérité.
Car la Parole de Dieu est fidèle et efficace : «Le Seigneur visita Sarah comme il avait dit et il fit pour elle
comme il avait promis» (21,1). Le fils qui lui naît est moins l’enfant de la vieillesse que l’enfant de la joie.
Le rire d’Abraham (17,17), le rire de Sarah (18,12) qui avaient marqué sa conception, résonnent encore à sa
naissance et lui confèrent son nom : Isaac, «Dieu a souri» (21,6). Circoncis à huit jours, selon l’ordre de
Dieu (17,12), il est le premier à être né dans l’alliance, à vivre d’emblée sous la loi de Dieu.
Mais le rire peut s’avérer aussi ambivalent. Au rire heureux de ses parents, succède le rire plus cruel
d’Ismaël, le fils de la servante, jouant (plus littéralement : «riant») avec Isaac. «L’enfant de la chair,
commente Paul en forçant quelque peu le texte, persécutait l’enfant de l’esprit» (Galates 4,29). Et c’est par
Sarah à nouveau que va s’accomplir l’alliance ; c’est elle qui porte la parole séparatrice, semblable à celle
qui, au commencement, avait créé en séparant lumière et ténèbres, ciel et terre : «Chasse cette servante et
son fils, il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac» (21,10). C’est Isaac qui est le

Sur les traces de la foi |
17
fils de la promesse, et non Ismaël, qui n’est pas pour autant rejeté (cf. «La Parole en questions»). Mais la
querelle entre les deux femmes, qui avait déjà poussé Agar à s’enfuir (16,6) et avait semblé s’apaiser par sa
soumission à sa maîtresse (16,9), va cette fois-ci à la rupture. Quoi qu’il en coûte à Abraham, attaché à son
fils aîné, il doit, selon la parole que Dieu lui adresse, admettre que chacun soit béni selon sa vocation propre,
mais que sur le fils de Sarah seul repose le poids de l’alliance (21,12-13). En renvoyant Agar au désert, il
confirme la séparation instaurée par Sarah et son statut de femme libre (cf. Galates 4,22-31).
Mais si le cœur paternel d’Abraham en est écorché, à plus forte raison le cœur du Dieu Père de tous est
bouleversé. «Dieu entendit les cris du petit…» (21,17). Ce ne sont pas les lamentations bruyantes d’Agar qui
crie et pleure, qui le touchent (21,16), mais le faible gémissement de l’enfant sous le buisson. «Un pauvre a
crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve», dit le psaume (34,6). Et l’enfant, sauvé par
l’eau d’un puits miraculeux, grandira et deviendra un homme du désert. Sauvé, béni aussi à sa façon.
Le cœur paternel d’Abraham n’a pas fini d’être déchiré puisque son second fils aussi, croit-il comprendre, va
lui être enlevé. Non plus chassé au désert, mais offert en holocauste par lui-même, son père. Telle est
«l’épreuve» (cf. «La loupe du scribe») qu’Abraham traverse avec le silence confiant, l’obéissance
immédiate et appliquée qu’il a toujours manifestés. Avec cette espérance «contre toute espérance»
(Romains 4,18) qui lui fait croire que Dieu n’a pu le tromper, qu’il ne lui a pas donné un fils pour le
reprendre, qu’il ne lui a pas dévoilé son visage de miséricorde pour se montrer soudain tyrannique et violent.
Ce n’est pas ce Dieu-là qu’a appris à connaître Abraham, dans sa marche au désert, et, malgré le naufrage de
son intelligence, malgré l’ébranlement de son esprit, qui le taraudent tout autant que la blessure de son cœur,
il persiste à affirmer en deux paroles brèves sa foi intacte : «Moi et l’enfant, nous reviendrons vers vous…
C’est Dieu qui pourvoira à l’agneau pour l’holocauste» (22,5.8). Et Dieu pourvoit, Dieu sauve l’enfant déjà
lié comme la victime innocente et, à travers lui, tous les innocents rattrapés par la mort violente. Dieu sauve
Abraham de lui-même en purifiant sa foi, détachée des dons et des lois pour n’adorer que le Donateur. Dieu,
à travers la figure du bélier, offert en holocauste, sauve tous les hommes, en allant, lui, jusqu’au sacrifice de
son Fils, son unique (cf. 22,2 ; Jean 3,16), en laissant le Fils, «agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde» (Jean 1,29), être lié sur le bois, offert pour le salut de tous.
Mais, pour l’heure, l’obéissance d’Abraham est source de bénédictions renouvelées pour sa descendance et
toutes les nations de la terre (22,18). Ce que confirme immédiatement l’annonce d’une postérité nombreuse
accordée à son frère Nahor (22,20-24), d’où sortira Rébecca, la future épouse d’Isaac.
Mais que devient Sarah ? Elle qui avait si activement contribué à l’installation sur la terre donnée par
Abimélek, et à la séparation de l’héritage du fils de la promesse, où est-elle alors que son fils a manqué de
mourir ? La tradition juive tente de combler ce manque, en affirmant qu’apprenant qu’Isaac allait être
immolé, elle mourut car, disait-elle, «mon âme est liée à son âme» (Yachar). Et, de fait, au récit du sacrifice
succède sans transition l’annonce de la mort de Sarah, à Hébron (23,1-2). Mais, jusque dans la mort, elle
travaille à la réalisation des promesses, car Abraham entre en transaction avec les fils de Hèt pour acquérir la
grotte de Makpéla où il désire l’enterrer. Lui, «étranger et résident» dans le pays (23,3), insiste pour acheter
le champ, et non le recevoir en don, comme les Hittites y sont disposés, car ce sont là les premiers arpents
qui passent en sa propriété (23,17) de cette terre qu’il sait, de source divine, être sienne. La seule terre
qu’Abraham le nomade ait jamais possédée prend amèrement la forme d’une tombe. Mais c’est bien par la
médiation de Sarah, mère d’Isaac, couchée en ce tombeau, que la réalisation de la double promesse
commence à advenir. «C’est dans la foi qu’ils moururent tous sans avoir reçu l’objet des promesses, mais
ils l’ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui
parlent ainsi font voir clairement qu’ils sont à la recherche d’une patrie. (…) Or, en fait, ils aspirent à une
patrie meilleure, c’est-à-dire céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas honte de s'appeler leur Dieu ; il leur a
préparé, en effet, une ville...» (Hébreux 11,13-16).
La loupe du scribe
Genèse 22,1-14 : le sacrifice

Sur les traces de la foi |
18
Le récit du sacrifice d’Abraham – que la tradition juive préfère plus justement nommer «la ligature» d’Isaac – est l’un
des plus connus de la geste des patriarches. Il frappe par son intensité dramatique et sa sobriété ; il interroge par la
radicalité de l’obéissance qu’il montre en actes, et le visage de Dieu qu’il semble dévoiler. Mais, à l’autre bout de
l’Écriture, le Père laissera son Fils accomplir jusqu’à la fin le sacrifice. Non par désir de mort, mais par amour de tous
les hommes. Non pour les accompagner dans la mort, mais pour les en tirer. «Dieu qui n’a pas épargné son propre
Fils mais l’a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ?» (Romains 8,32).
[1] Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit : «Abraham ! Abraham !» Il
répondit : «Me voici !» [2] Dieu dit : «Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t’en au pays de
Moriyya, et là tu l’offriras en holocauste sur une montagne que je t’indiquerai.» [3] Abraham se leva tôt,
sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l’holocauste et se mit
en route pour l’endroit que Dieu lui avait dit. [4] Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de
loin. [5] Abraham dit à ses serviteurs : «Demeurez ici avec l’âne. Moi et l’enfant nous irons jusque là-bas,
nous adorerons et nous reviendrons vers vous.» [6] Abraham prit le bois de l’holocauste et le chargea sur son
fils Isaac, lui-même prit en mains le feu et le couteau et ils s’en allèrent tous deux ensemble. [7] Isaac
s’adressa à son père Abraham et dit : «Mon père !» Il répondit : «Oui, mon fils ! - Eh bien, reprit-il, voilà le
feu et le bois, mais où est l’agneau pour l’holocauste ?» [8] Abraham répondit : «C’est Dieu qui pourvoira à
l’agneau pour l’holocauste, mon fils», et ils s’en allèrent tous deux ensemble. [9] Quand ils furent arrivés à
l’endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l’autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le
mit sur l’autel, par-dessus le bois. [10] Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils.
[11] Mais l’Ange du Seigneur l’appela du ciel et dit : «Abraham ! Abraham !» Il répondit : «Me voici !» [12]
L’Ange dit : «N’étends pas la main contre l’enfant ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains
Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique.» [13] Abraham leva les yeux et vit un bélier, qui s’était pris
par les cornes dans un buisson, et Abraham alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son
fils. [14] À ce lieu, Abraham donna le nom de «Le Seigneur pourvoit», en sorte qu’on dit aujourd’hui : «Sur
la montagne, le Seigneur pourvoit.»
Il arriva que Dieu éprouva Abraham…
La clé de ce récit est donnée par le narrateur dès ce premier verset – de façon sans doute à ce que le lecteur soit bien
persuadé que Dieu ne veut pas du sacrifice d’un enfant. Tout au contraire ce texte peut être lu comme une
condamnation de ces sacrifices auxquels se livraient les peuples alentour et ont parfois cédé les Hébreux. Ainsi est-il
dit d’Achaz roi de Juda : «Il fit passer son fils par le feu selon les coutumes abominables des nations que le Seigneur
avait chassées devant les Israélites» (2 Rois 16,3). Cette pratique est fermement condamnée par la Loi (cf. Lévitique
18,21 ; 20,2-5 ; Deutéronome 12,31) et stigmatisée par les prophètes (cf. par exemple Jérémie 7,31 : «Ils ont construit
des hauts lieux pour brûler leurs fils et leurs filles, ce que je n’avais jamais ordonné, à quoi je n’avais jamais songé» ;
et aussi Jérémie 19,5 ; Ézéchiel 16,20-21 ; 20,30-31 ; Michée 6,7).
Il s’agit donc, nous est-il indiqué, d’une épreuve – dans la Bible grecque le même mot peirasmos est utilisé pour les
tentations de Jésus au désert. C’est donc une sorte de rite initiatique, de difficultés ou tentations infligées à quelqu’un
pour que soit vérifié ce qu’il est réellement. Le peuple de la même façon est «éprouvé» dans le désert : «Souviens-toi
de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t’a fait faire pendant quarante ans dans le désert afin de te mettre dans la
pauvreté, de t’éprouver et de connaître le fond de ton cœur : allais-tu ou non garder ses commandements ?»
(Deutéronome 8,2). L’épreuve fait passer de la peur pour la vie à la foi en Celui qui fait vivre.
… et lui dit : «Abraham ! Abraham !» Il répondit : «Me voici !»
Ce second appel de Dieu fait écho au premier (Genèse 12,1). Il s’agit toujours de rompre des attachements, de mourir
à quelque chose pour suivre Dieu, même si ici l’épreuve est infiniment plus douloureuse puisqu’il s’agit de son fils, du
fils de la promesse. «Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi» (Matthieu 10,37).
Comme lors du premier appel, la réponse d’Abraham est de confiance et d’obéissance. C’est là le second sens du
passage : donner l’exemple d’un croyant qui reconnaît l’autorité mystérieuse et exigeante de Dieu, mais ne discute pas
avec elle et exécute ses ordres, quoi qu’il lui en coûte, Non par héroïsme pur, mais parce qu’il croit que la relation
vivante qui l’unit à son Dieu ne peut être brisée, ni sa confiance trompée. Cela ne diminue en rien l’obéissance
d’Abraham, mais lui ôte tout caractère absurde, voire odieux. C’est le sens de la relecture que la lettre aux Hébreux
fait de ce passage : «Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts…» (11,17-19).
«Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac…

Sur les traces de la foi |
19
De nombreux commentateurs ont relevé l’insistance de la formule, qui semble alourdir encore la dureté de l’ordre.
«Vois, écrit Jean Chrysostome, au IVe siècle, le nombre de mots allume un plus grand feu et excite plus
véhémentement la fournaise de l’amour que ce juste avait pour son fils. Un seul de ces mots suffisait pour blesser son
âme !» (Homélie 7 sur la Genèse). Et, Rachi, commentateur juif du XIe siècle, développe la même idée sous forme
d’un dialogue : «Prends ton fils. – J’ai deux fils. – Ton unique. – Chacun est l’enfant unique de sa mère. – Celui que
tu chéris. – Je les chéris tous les deux. – Isaac.» (Le Pentateuque 1).
La triple dénomination laisse aussi entrevoir qu’Abraham est non seulement blessé en sa chair, mais aussi ébranlé en
son intelligence et troublé en son esprit : pourquoi Dieu demande-t-il de sacrifier celui qu’il a promis et donné après
une si longue attente, celui sur qui repose l’alliance et qui doit être père de nombreux descendants ? Et quel est ce
Dieu qui tout à coup perd sa bonté singulière pour se comporter comme les autres dieux ?
Enfin, dans une lecture chrétienne, ces trois termes évoquent surtout la figure du Fils unique, Jésus, que le Père, lors
du baptême et de la Transfiguration, nomme «bien-aimé» (Matthieu 3,17 ; 17,5), et esquissent le sens plénier du
passage : «Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique» (Jean 3,16).
… et va-t’en au pays de Moriyya… »
La même formule que lors du premier appel (traduite ici par «va t’en»), qui commande le même détachement mais
implique aussi la même espérance : c’est «pour / vers lui», selon la traduction littérale, qu’Abraham doit partir. Car
peut-on atteindre sa vérité profonde sans passe par l’expérience de la mort et de la nuit ?
Le lieu indiqué paraît géographiquement mal déterminé, mais une tradition postérieure l’a identifié à la colline de
Jérusalem où va être construit le Temple (cf. 2 Chroniques 3,1 : «Salomon commença alors la construction de la
maison du Seigneur. C’était à Jérusalem, sur le mont Moriyya, là où son père David avait eu une vision.») Ainsi Isaac
est «offert en holocauste» à l’endroit même où, deux fois par jour, rituellement, les agneaux sont sacrifiés (cf. Exode
29,38-42).
Abraham se leva tôt, sella son âne…
L’empressement à obéir d’Abraham est manifesté pour la troisième fois par cette notation d’un lever matinal (19,27 ;
21,14 ; 22,3). Comme au chapitre 12, son obéissance ne s’exprime pas par des paroles, mais en actes.
La ressemblance entre les mots signifiant en hébreu «âne» et «matière» fait dire aux commentateurs juifs que c’est sa
nature qu’Abraham a sanglée, la partie matérielle de son être, afin de dominer ses sentiments pour être tout à l’ordre
de Dieu.
Le troisième jour…
C’est souvent, dans l’Écriture l’indication d’un temps d’épreuve ou de souffrance, mais qui débouche sur une guérison
ou une libération. Ainsi Jonas, avalé par le poisson, demeure en ses entrailles «trois jours et trois nuits» (Jonas 2,11).
«Venez, invite le prophète Osée, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré, il nous guérira ; il a frappé, il pansera nos
plaies ; après deux jours il nous fera revivre, le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons en sa présence» (Osée
6,1-2). L’évangile, indiquant le «signe de Jonas», applique cette même durée d’épreuve au Fils de l’homme qui «sera
dans le sein de la terre trois jours et trois nuits» (Matthieu 12,40). Quitte à presser un peu la chronologie, ce sera aussi
la donnée retenue par les premières affirmations apostoliques de la résurrection du Christ : «Je vous ai donc transmis
en premier lieu ce que j’avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures,
qu’il a été mis au tombeau, qu’il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures…» (1 Corinthiens 15,3-4).
«Moi et l’enfant nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous.»
La sobriété des gestes d’Abraham qui donne à ce récit sa beauté tragique, le silence que garde le patriarche, ne sont
rompus que par deux courtes phrases, la première ici adressée à ses serviteurs, la seconde en réponse à la question de
son fils (v. 8). Deux phrases qui affirment, l’une et l’autre, son espérance. Il se laisse conduire par Dieu jusqu’à
l’endroit du sacrifice, jusqu’au sacrifice même, tout en continuant à croire que, d’une façon qu’il ne peut imaginer
mais que Dieu sait, l’enfant reviendra vivant. La formule de Paul, commentant Genèse 15,6, en acquiert une
profondeur nouvelle : «Espérant contre toute espérance, il crut» (Romains 4,18).
Abraham prit le bois de l’holocauste et le chargea sur son fils Isaac, lui -même prit en mains
le feu et le couteau et ils s’en allèrent tous deux ensemble.

Sur les traces de la foi |
20
En ce verset se situe le point de contact le plus évident entre le sacrifice d’Isaac et celui de Jésus qui «sort, portant lui-
même sa croix» (Jean 19,17). Le silence et l’obéissance d’Isaac, qui suit son père et se laisse lier sur le bois (v. 9), sont
à l’unisson de ceux d’Abraham. La tradition juive en déduit que, par son consentement, il a vraiment été consacré à
Dieu comme offrande : «Les anges de Dieu bondirent et s’écrièrent les uns les autres : Avez-vous vu les deux justes
sur la terre, l’un sacrifie et l’autre se laisse sacrifier ? Celui qui sacrifie n’hésite pas et l’autre tend sa gorge pour
être immolé !» (Targum de Jérusalem).
Le silence d’Isaac l’apparente au serviteur annoncé par Isaïe : «Maltraité, il s’humiliait, il n’ouvrait pas la bouche,
comme l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n’ouvrait pas la
bouche» (Isaïe 53,7). Il préfigure le silence de Jésus devant Pilate : «Mais Jésus se taisait» (Jean 19,9). Tout comme,
en marchant aux côtés de son père – l’expression : «ils s’en allèrent tous deux ensemble» est répétée aux versets 6 et 8
–, en parcourant avec lui le même chemin de consentement, il préfigure l’union de Jésus à son Père en une même
volonté de salut : «C’est pour cela que le Père m’aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre» (Jean 10,17).
«C’est Dieu qui pourvoira à l’agneau pour l’holocauste, mon fils.»
La seconde parole d’Abraham, adressée non plus aux serviteurs, mais à son fils, fait preuve de la même retenue et de
la même confiance. Persistant dans sa fidélité à la Parole de Dieu, même lorsqu’elle paraît se contredire, il prend en
quelque sorte Dieu à témoin contre lui-même. Dieu sait, Dieu «pourvoit», et ce que l’on appellera plus tard sa
«providence» donne au moment où il convient. Ce sera l’un des enseignements des évangiles synoptiques : «Ne vous
inquiétez donc pas en disant : Qu’allons-nous manger ? qu’allons-nous boire ? de quoi allons-nous nous vêtir ? Ce
sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela.
Cherchez d’abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain : demain s’inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine» (Matthieu 6,31-34).
Mais l’Ange du Seigneur l’appela du ciel…
Il faut un nouvel appel de Dieu pour interrompre la succession des gestes méthodiques, appliqués d’Abraham dont la
réponse – la même qu’au verset 1 : «Me voici» – indique toujours la même disponibilité, la même remise de lui-même
à Dieu.
«Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique.»
La crainte dont il s’agit ici, est bien l’attitude juste devant Dieu, le sentiment de sa grandeur qui conduit à l’adoration
et à l’amour de sa volonté, Mais, pour faire naître ce sentiment, la pédagogie de Dieu peut susciter d’abord la frayeur :
c’est le cas, par exemple, dans la théophanie du Sinaï, au milieu des éclairs et du tonnerre, dont Moïse dit : «Ne
craignez pas. C’est pour vous mettre à l’épreuve que Dieu est venu, pour que sa crainte vous demeure présente et que
vous ne péchiez pas» (Exode 20,20).
Pour Abraham, l’épreuve a été surmontée : Isaac a été lié, mais c’est son père qui, en allant au bout de l’obéissance, se
trouve en quelque sorte délié, Abraham en effet est allé jusqu’à ce basculement où Dieu qui a donné est préféré au don
qu’il a fait ; et il devient capable de se détacher de «celui qu’il chérit». Et Dieu lui redonne le fils qu’il a immolé dans
son cœur, comme une prophétie de notre propre résurrection.
Toute l’Écriture va insister sur le fait que Dieu n’a pas besoin de nos sacrifices matériels, mais de l’attitude intérieure
qu’ils supposent. Samuel l’affirme au premier roi d’Israël, Saül : «Le Seigneur se plaît-il aux holocaustes et aux
sacrifices comme dans l’obéissance à la parole du Seigneur ? Oui, l’obéissance vaut mieux que le sacrifice, la
docilité, plus que la graisse des béliers» (1 Samuel 15,22). La formule semblable du prophète Osée paraît si
fondamentale qu’elle est mise plusieurs fois par les évangélistes sur les lèvres de Jésus (cf. Matthieu 9,13 ; 12,7) :
«C’est l’amour qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes» (Osée 6,6). La
bénédiction dont est porteur l’Ange du Seigneur indique donc qu’il faut être prêt à offrir à Dieu sa propre vie, son
Isaac, l’enfant de la joie dont il est le symbole, pour recevoir la plénitude de la vie et de la joie que Dieu veut donner.
Abraham alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place d e son fils.
L’acte d’offrir l’animal «à la place de» son fils est comme la mise en image de la Loi. Celle-ci ordonnait en effet que
tout premier-né soit consacré au Seigneur : «Tu cèderas au Seigneur tout être sorti le premier du sein maternel», qui
doit donc être sacrifié ; mais, est-il précisé, «tous les premiers-nés de l’homme, parmi tes fils, tu les rachèteras»
(Exode 13,2.13). La typologie chrétienne a voulu voir en cet animal sacrifié la préfiguration de Jésus, «l’agneau de
Dieu» (Jean 1,29) dont le Père a accepté le sacrifice pour le salut du monde et qui devient ainsi «le premier-né d’entre
les morts» (Colossiens 1,19).
 6
6
 7
7
1
/
7
100%