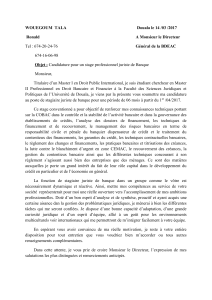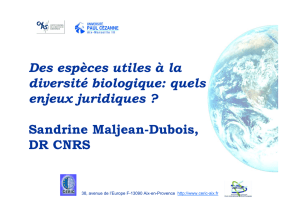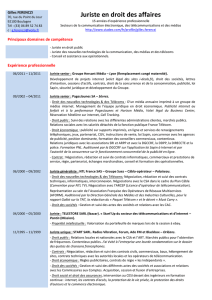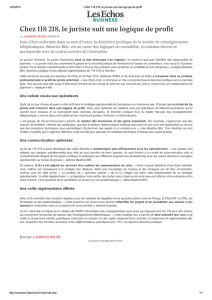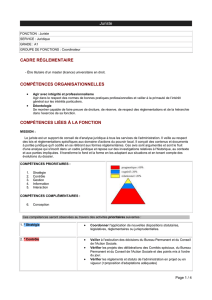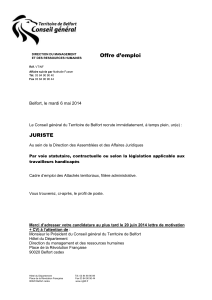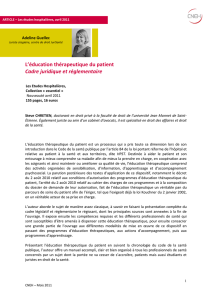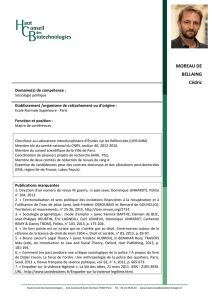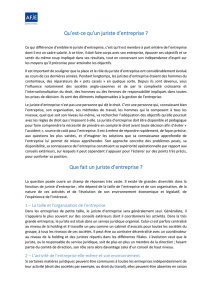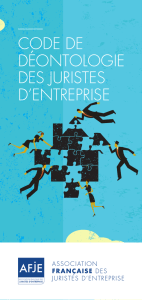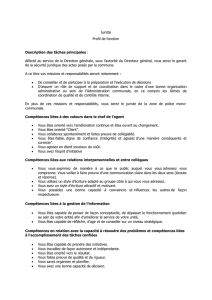Droit et sciences sociales

Droit et sciences sociales
1 La place du droit dans les sociétés industrielles avancées
Le besoin de la science juridique d’établir des contacts nouveaux et plus étroits avec les sciences
sociales n’a jamais été aussi fort qu’aujourd’hui. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il est à
chaque fois l’indice de la période de profonde transformation que traverse la société comme en
témoignent le mouvement du droit libre et la découverte de la sociologie juridique en Allemagne à
la fin du siècle dernier. Ce qui actuellement caractérise l’étude du droit est le fait que les juristes
sont en train de sortir de leur splendide isolement : il suffit, pour s’en rendre compte, de lire les
écrits les plus significatifs des chercheurs de la jeune génération, en particulier lorsqu’ils traitent de
disciplines moins traditionnelles, comme le droit du travail, le droit commercial ou industriel.
Cette nécessité d’élargir ses horizons s'accompagne d'un constat obscur : le droit n’occupe plus la
place privilégiée qui, de longue tradition, lui a été assignée dans le système global de la société. Les
premiers à saper la primauté du droit - cette primauté dont le droit jouissait encore auprès des
grands réformateurs des Lumières et qui avait inspiré à Kant l’idée d’un Etat selon le droit et d’une
société juridique universelle comme fin idéale de l’histoire humaine - furent, comme chacun sait,
ceux à qui est attribuée la naissance de la sociologie moderne. Il ne s’agit pas de revenir encore sur
la cinglante polémique de Saint-Simon contre les légistes et sur sa prédiction de l’avènement d’une
société gouvernée par des scientifiques et des industriels à la place d’une société archaïque et
mourante, gouvernée par des légistes et des métaphysiciens. Inutile également de répéter que c'est à
Comte qu’il faut faire référence pour trouver une condamnation du « fétichisme de la loi » - devenu
le cri de guerre des juristes sociologisants - ainsi que l’affirmation selon laquelle « dans l’Etat
positif, l’idée du droit disparait irrévocablement »
1
. Dans l’autre grand filon de la “science de la
société”, la pensée marxiste, il n’en a pas été différemment (puisqu’) Hegel, maître de Marx, avait
déjà écrit dans un des premiers paragraphes de la Philosophie du droit que « le droit est de façon
générale quelque chose de sacré » (§30)
2
et que Marx, à son tour, le réduit à un moment purement
superstructurel de la société. Pour reprendre une célèbre phrase du Manifeste, « … votre droit n’est
1
Je tire ces deux citations de G. Solari, Positivismo giuridico e politico di A. Comte, in Studi di filosofia del diritto,
Giapicchelli, Turin, 1949, p. 385-391
2
Traduction tirée de G. W. F. Hegel, Principes de philosophie du droit, puf, 1998, p. 119. N. Bobbio ne cite aucune
édition en particulier. (NdT)

que la volonté de votre classe érigée en loi »
3
. Pour résumer en une formule synthétique bien qu’un
peu simpliste, il est possible d’affirmer que si les auteurs des Lumières mettaient le droit au centre
de l’étude des différentes civilisations, recherchaient la nature et les lignes de développement d’un
peuple dans l’ « esprit des lois » et croyaient que pour changer la société il suffisait de changer le
droit, en revanche, au 19ème, au fur et à mesure de la prise de conscience du grand changement
historique produit par l’avènement de la société industrielle dans la « société civile » avant même
que dans la société politique, le droit fut de plus en plus considéré comme un épiphénomène, un
moment secondaire du développement historique, et regardé avec toujours plus de défiance comme
instrument de changement social.
Aujourd’hui, à bien y regarder, la crise de la primauté du droit est encore plus importante: il ne
s’agit pas seulement de mettre en doute sa capacité à influencer le changement social, mais
également de souligner les limites de sa fonction spécifique d’instrument de contrôle social (au sens
le plus strict du terme).
Dans les sociétés industrielles avancées il est possible d’entrevoir deux tendances qui vont dans le
sens d’une réduction de la fonction spécifique du droit comme instrument de contrôle social:
a) ce qui caractérise le droit comme instrument de contrôle social est d’une part l’utilisation des
moyens coercitifs (c’est-à-dire la « coercition » comme élément distinctif de l’ordre juridique par
rapport à d’autres ordres normatifs) et d’autre part l’utilisation des moyens coercitifs dans un but
répressif (par « répression » j’entends le contraire de « prévention »). Ainsi dans la société
contemporaine, lorsqu’augmentent la dimension et l’utilisation des moyens de communication de
masse (dont je n’ai d’ailleurs pas l’intention d’exagérer l’importance de manière catastrophiste),
c’est le recours à un mode de contrôle social, différent de la forme traditionnellement représentée
par le droit, qui augmente. Ce mode de contrôle n’est pas de type coercitif mais persuasif, et son
efficacité n’est pas confiée en dernière instance à la force physique, comme dans tout ordre
juridique, mais au conditionnement psychologique. Éventuellement, il est possible de faire
l’hypothèse d’un type de société où le conditionnement psychologique des individus serait si étendu
et efficace que la forme généralement considérée comme la plus intense de contrôle, le contrôle par
l’utilisation des moyens coercitifs, c’est-à-dire le droit, serait superflue. Une société sans droit n’est
pas nécessairement une société libre, comme l’imaginait Marx, mais peut aussi être conformiste
comme l’imaginait Orwell: le droit est nécessaire là où, comme dans les sociétés historiques, les
hommes ne sont ni totalement libres ni totalement conformistes, c’est-à-dire dans une société où les
hommes ont besoin de normes (et donc ne sont pas libres) et ne réussissent pas toujours à les
3
Traduction tirée de K. Marx, F. Engels, Le manifeste du parti communiste, éditions sociales, 1986, p. 80. N. Bobbio
cite l’édition dirigée par E. C. Mezzomonti, Einaudi, Turin, 1948, p. 139. (NdT)

observer (et donc ne sont pas conformistes) ;
b) Outre la formation et l’affirmation d’un contrôle social de type différent, c’est, dans une société
technologiquement avancée, un autre phénomène d’importance (bien qu’encore non dominant) qui
se développe: il est destiné à réduire, à mon sens, l’espace de contrôle juridique, du moins tel qu’il a
généralement été exercé jusqu’à aujourd’hui. En l’absence d’autres expressions, j’appelle ce
phénomène le contrôle anticipé, c’est-à-dire le déplacement de la réaction sociale du moment qui
succède au moment qui précède le comportement ou l’évènement non désiré, le passage de
l’intervention comme remède à l’intervention comme prémonition, en un mot le passage de la
répression à la prévention. Il ne s’agit pas de nier que le droit a déjà, dans sa principale fonction
répressive, également une fonction préventive, comme le savent bien les juristes, du fait de la valeur
non seulement punitive mais également intimidatrice de la sanction. Cependant, quand je parle, à
propos de la politique sociale des sociétés technologiquement avancées, d’un probable déplacement
de la répression à la prévention, je renvoie à un phénomène bien plus complexe et important. Il
s’agit de la tendance à utiliser les connaissances toujours plus précises des sciences sociales
concernant les motivations du comportement déviant et les conditions qui le rendent possible, non
dans le but de courir aux abris quand il s’accomplit mais afin d’empêcher qu’il ne se réalise. Jamais
comme aujourd'hui la science ne s'est autant rapprochée de la sagesse populaire qui enseigne qu’il
faut fermer l’étable avant que les bœufs ne s’en échappent. Considérons le débat en cours sur les
possibilités et les avantages immenses, d'ordre également économique, qu'offre la médecine
préventive. Pourquoi soigner une maladie quand, dans la plupart des cas, il est possible d’empêcher
son apparition ? Il en va de même pour la maladie sociale qu’est le comportement déviant:
pourquoi préparer un gigantesque appareil pour identifier, juger et enfin punir un comportement
déviant alors qu’il est possible de modifier les conditions sociales de façon à influer sur les causes
qui le déterminent? Dans ce cas également, bien que dans un sens différent du cas précédent de la
société conformiste, une société dans laquelle toute forme de déviation a été vaincue avant même de
pouvoir s’incarner, est une société sans droit, ou du moins sans cet appareil chargé de juger et de
réprimer qui coïncide traditionnellement avec l’essence même du droit.
2 Deux conceptions opposées de la fonction du juriste en fonction du
différent type de système juridique (fermé ou ouvert), de la
différente condition de la société (stable ou en mouvement), et de la
différente conception du droit (comme système autonome ou
dépendant).

Ces considérations générales et, je n’hésite pas à le reconnaitre, encore approximatives concernant
les transformations non tant d’un droit positif déterminé (ce qui constituerait un argument isolé)
mais plutôt de la place et de la fonction du droit dans la société, constituent déjà en soi une
introduction au thème de la discussion. Elles autorisent quelques premiers éléments de jugement sur
ce qui rend prégnant un plus grand contact entre juristes et scientifiques sociaux. Il est clair que le
problème de la place et de la fonction du droit dans la société ne peut être affronté que par un juriste
qui sortirait de sa propre coquille.
Mais d’autres raisons, plus pertinentes encore pour expliquer cette rencontre entres les deux
sciences, peuvent être identifiées à l’intérieur même de l’œuvre du juriste. Mon point de départ est
une considération souvent ignorée : il n’existe pas une unique science juridique (par souci de
concision et bien que l’expression soit équivoque, j'appelle « science juridique » l’activité du
juriste), mais il existe autant de « sciences juridiques » qu’il y a d’images que le juriste a de lui-
même et de sa fonction dans la société. En cela le juriste ne diffère pas des autres scientifiques
sociaux: de la sociologie également il est possible d'affirmer qu'elle évolue selon l’image que le
sociologue a de sa fonction dans la société, comme le savent tous les sociologues. Je n’ai pas besoin
de rappeler que la soi-disant crise de la sociologie tant discutée aujourd’hui dépend du différent rôle
que le sociologue a ou prétend avoir au sein de la société dont il est à la fois spectateur et acteur.
En ce qui concerne la science juridique, il me semble possible de distinguer deux images typico-
idéales de la fonction du juriste qui influencent la façon de concevoir la science juridique elle-
même: d'une part le juriste comme conservateur et transmetteur d’un corps de règles déjà données,
dont il est le dépositaire et le gardien; d'autre part le juriste comme créateur de règles capables de
transformer le système donné, en l'intégrant et en l'innovant. Il n’est plus alors simplement le
receveur mais aussi un collaborateur actif et, quand cela s’avère nécessaire, critique. L’activité
principale grâce à laquelle est réalisée la première fonction est l’interprétation du droit; l’activité
principale grâce à laquelle s’accomplit la seconde est la recherche du droit.
Ces deux images de la fonction du juriste dans la société peuvent dépendre: a) du différent type de
système juridique au sein duquel le juriste opère (variable institutionnelle); b) de la différente
situation sociale dans laquelle le juriste agit (variable sociale); c) de la différente conception du
droit et du rapport droit-société qui participe à la formation de l’idéologie du juriste à un moment
historique donné (variable culturelle)
Sub a : Il est nécessaire de distinguer entre système fermé et système ouvert. Dans un système
fermé le droit est solidifié en un corps systématique de règles qui prétendent, du moins
potentiellement, à la complétude. Les sources formelles du droit y sont rigidement prédéterminées
et le travail du juriste n‘en fait pas partie (la jurisprudentia au sens classique du terme se résout en

un commentaire des règles du système). Dans un système ouvert, l’essentiel des règles sont ou sont
considérées à l’état fluide et en perpétuelle transformation. Il n’existe pas de ligne de démarcation
nette entre sources matérielles et sources formelles: le juriste se voit attribuer le devoir de collaborer
avec le législateur et le juge pour la création du nouveau droit.
Sub b : L’expression « diverse situation sociale » renvoie ici à la distinction entre une société stable
et une société en transformation, entre une société qui tend à perpétuer ses propres modèles
culturels et une société où apparaissent des facteurs de changement qui rendent brusquement
inadéquats les modèles culturels traditionnels, parmi lesquels l’ensemble des règles juridiques
transmises.
Sub c: Il est nécessaire de distinguer deux conceptions du droit : d’une part comme système
autonome ou auto-suffisant par rapport au système social, d’autre part comme sous-système d’un
système global, ou bien (selon la vision marxiste du rapport droit-société) comme superstructure
d’une structure sociale. Dans le premier cas, le travail du juriste s’exerce entièrement à l’intérieur
de celui-ci; dans le second cas, le juriste se voit chargé d’adapter le droit en vigueur à la réalité
sociale environnante ou sous-jacente.
A ces trois couples de variables, qui peuvent être considérées indépendantes ou différemment
dépendantes les unes par rapport aux autres selon les points de vue, correspondent trois modèles
antithétiques de science du droit: contrainte-libre, conservatrice-innovatrice, formaliste-réaliste.
Dans le cas extrême - purement hypothétique - d'un droit considéré dans un système fermé, au sein
d’une société stable, en présence d’une idéologie prônant l’autonomie du droit par rapport à la
société, la jurisprudentia devrait être contrainte, conservatrice et formaliste. Dans le cas extrême
inverse, c’est-à-dire d’un droit considéré dans un système ouvert, au sein d’une société en
transformation, en présence d‘une idéologie concevant le droit comme reflet de la société, c’est le
modèle inverse qui devrait se développer : une science du droit libre, innovatrice et réaliste.
L’opposition entre ces deux conceptions de la fonction du juriste a des conséquences sur les
différentes méthodes utilisées pour identifier et délimiter l’objet de la science juridique.
Suivant la première approche, l’objet de la science juridique est l’ensemble des règles posées et
transmises, applicables par le juge à un moment historique donné. Ces règles sont entendues comme
des propositions dont il convient d'établir la signification avec le plus de précision possible. Ainsi,
le rôle du juriste n’est pas, dans ce cas, de créer des règles nouvelles mais d’indiquer les règles
existantes et de les interpréter. Il est dès lors possible de comprendre combien la détermination des
sources du droit par le juriste est un préliminaire particulièrement important: son rôle est d'établir
des critères permettant de distinguer les règles applicables par le juge car appartenant au système
(c’est-à-dire valides) des règles qui n'y appartiennent pas. A travers la détermination des sources du
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%