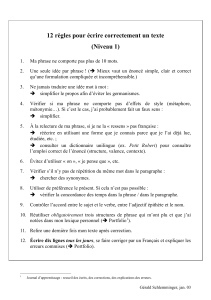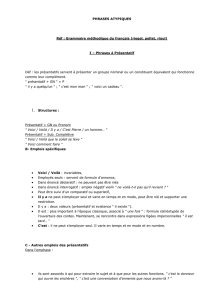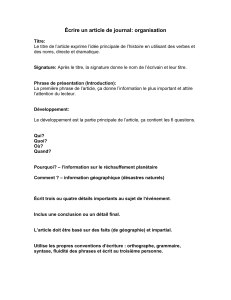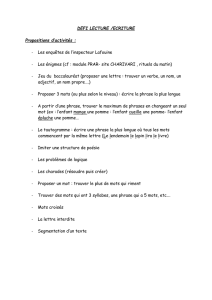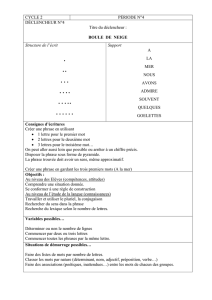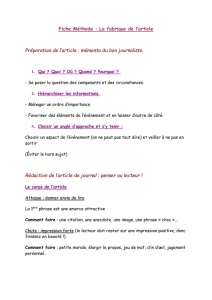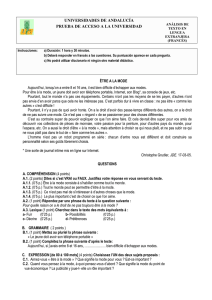ETUDE DES EMPLOIS DE C`EST

Envoyé par Stéphanie.
ETUDE DES EMPLOIS DE C’EST.
Nous rappellerons pour commencer les trois valeurs potentielles de C’EST, distinguées par
l’interprétation de c’/ce et les facteurs contextuels suivants :
1°) C’EST comporte un pronom démonstratif sujet substitut d’un constituant ou d’une
séquence (éventuellement d’une phrase) du contexte linguistique : son référent peut être placé
avant (c’ est anaphorique) ou après (c’ est cataphorique). Est est, dans ce cas, analysable comme un
verbe attributif, suivi d’un attribut :
exemples : c’est l’endroit (anaphorique représentant votre pardessus)
ce sera pour la prochaine fois (ce est anaphorique du contenu référentiel de la phrase précédente)
des pièces j’en avais, c’est vrai, moi aussi, attrapé
Dans cette occurrence, c’est vrai est une incise modale, dont le c’ est à la fois anaphorique et
cataphorique puisque, situé au milieu de la phrase modalise (des puces j’en avais moi aussi attrapé), il
réfère à une séquence qu’il suit et à une autre qu’il précède.
C’EST peut prendre dans ce cas la marque du pluriel et devenir ce sont si le constituant qu’il
représente est au pluriel.
Il peut également varier en temps.
On peut, par hypothèse classer dans cette catégorie de C’EST anaphorique, l’occurrence de la
l.4 :
C’est que, des puces j’en avais …attrapé.
Certes, c’est que est souvent interprété comme une expression figée, du registre familier, qui
introduit une explication (présentée comme plus satisfaisante qu’une autre), de ce qui est énoncé
dans la phrase précédente.
Mais on donne souvent c’est que comme l’équivalent de c’est parce que. On pourrait aussi
envisager que c’ renvoie à ce qui a été dit auparavant (anaphore), la proposition ouverte par parce
que constituant la cause avancée.
2°) C’EST présentatif :
c’est un démonstratif proprement déictique (indice selon Benveniste, embrayeur selon
Jakobson) : il introduit une identification ou une caractérisation directement reliée à la situation
(espace et temps) d’énonciation. Il n’a pas de référent contextuel.
Exemple : c’est Pierre, c’est beau.
Cet emploi, qui dans certains ouvrages est nommé actualisateur, est à rapprocher de celui de Il y a
et de Voici/voilà. Il est compatible avec la négation et peut présenter des variations temporelles.
C’EST présentatif peut être employé avec négation et peut varier en temps. En principe
C’EST, dans ce rôle, est invariable en nombre puisqu’il est suivi de pronoms personnels (c’est
nous, c’est lui/ ce sont eux), et de manière générale dans l’usage courant (c’est des amis) alors que
l’accord s’observe dans l’usage soutenu (ce sont des amis).
3°) C’EST présentatif discontinu en relation avec qui ou que, avec lequel il constitue la
formule présentative c’est …qui/que, qui a pour rôle de focaliser un constituant de la phrase. La
focalisation est une opération d’extraction qui sélectionne dans la répartition de l’information

dans la phrase, un foyer, c’est-à-dire un élément portant l’essentiel de la charge prédicative
(élément nouveau posé dans l’énoncé) ; par la même, le reste de l’énoncé acquiert un statut de
présupposé (il est donné comme connu ou admis : on ne peut le nier)
ex. : c’était-y vous qu’étiez de service ?
Cette phrase interrrogative, de registre familier, a pour corrélatif sous la forme assertive : c’était
vous qui étiez de service ?
L’énoncé sans extraction de vous serait : Vous étiez de service.
Dans ces structures appelées phrases clivées, le constituant extrait est :
- un syntagme nominal sujet.
Le deuxième élément de la formule est alors qui
Ou - un CC nominal avec ou sans préposition adverbial, gérondif
Ou - un adjectif attribut, subordonnée circonstancielle
Le deuxième élément de la formule est alors que.
Lorsqu’un pronom personnel est focalisé, il prend une forme tonique, correspondant à sa valeur
prédicative forte.
Le statut de qui et que est controversé. Il est souvent assimilé à celui de pronom relatif.
Cependant, on peut considérer qu’il s’agit d’un outil de type conjonction qui introduit la partie de
l’énoncé qui résulte de l’extraction du terme focalisé. Qui et que seraient des variantes
combinatoires du même morphème conjonctif : qui, devant le verbe, lorsque le sujet a été
focalisé, que dans les autres cas.
Il est certain en tout cas qu’il ne faut pas confondre la formule présentative
C’est…qui/que…
où
c’
n’est ni anaphorique (comme en 1) ni déictique (comme en 2), où
est
est généralement invariable en nombre (dans tous les cas où le terme extrait n’est ni sujet ni objet
direct), avec un tour
c’est…qui/que
qui correspond à un emploi de type 1 (anaphore) ou de
type 2 (actualisateur avec C’ déictique) associé à une relative déterminative.
Phrase à problèmes :
Ce fut un grand typhon qui s’élança…
On analysera cette phrase plutôt en :
- ce fut (actualisateur = il y eut) + un grand typhon (S .N attribut) + qui s’élança (relative
déterminative)
que comme une structure à présentatif discontinu.
Un indice du caractère actualisateur de ce fut est la présence de à ce moment là, qui ancre de manière
déictique (dans le temps du récit) la survenue de l événement.
L’autre interprétation avec formule de présentatif discontinu : ce fut + SN focalisé + qui… semble
peu plausible en contexte : on ne voit pas de justification à l’extraction de ce SN ici, l’opération
en question ayant pour fonction habituelle de focaliser un élément pour l’opposer à un autre.
1
/
2
100%