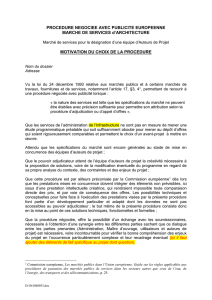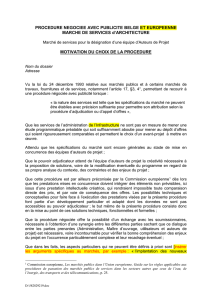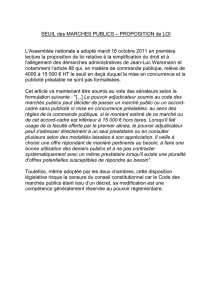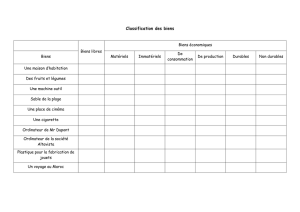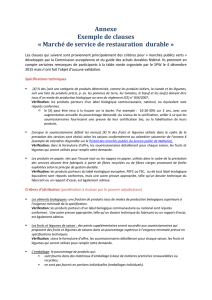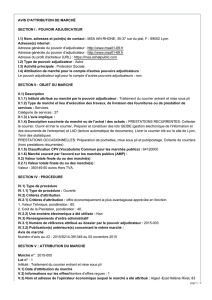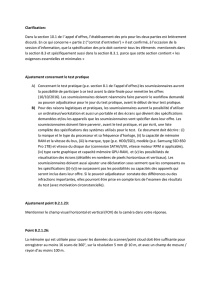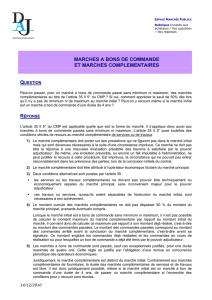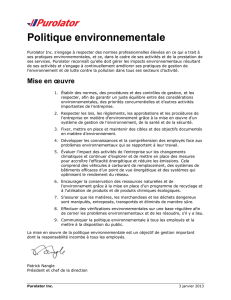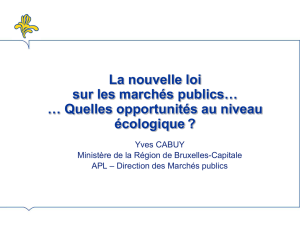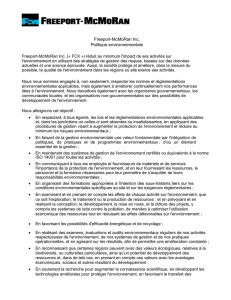LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES MARCHES PUBLICS :

LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES MARCHES
PUBLICS
L’INSERTION DE CRITERES ECOLOGIQUES
Astride MIANKENDA
Cellule Conseil et Politique d’Achats
1er décembre 2013

2
TABLE DES MATIERES
1. INTRODUCTION .......................................................................................... 4
2. DEFINITION DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES MARCHES PUBLICS
ET LEGISLATION RELEVANTE ...................................................................... 6
3. LA PRISE EN COMPTE DE CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES DANS
LES CAHIERS SPECIAUX DES CHARGES: CE QUI EST JURIDIQUEMENT
PERMIS ....................................................................................................... 9
3.1. Quelques définitions ............................................................................. 9
3.2. Les différentes possibilités ...................................................................10
3.2.1. La sélection des candidats et des soumissionnaires .................................10
3.2.2. Les spécifications techniques ................................................................13
3.3.3. Les critères d’attribution ......................................................................19
3.3.4. Les conditions d’exécution du marché ....................................................22
3.4. Approche des marchés publics durables .................................................24
3.4.1. Comment aborder le problème? ............................................................24
3.4.2. Le coût total du cycle de vie .................................................................27
3.4.3. La définition de l’objet du marché et des exigences du pouvoir
adjudicateur .......................................................................................29
3.4.4. Quelques pratiques à l’étranger ............................................................30
3.4.5. Aperçu de la situation belge au niveau des régions (CIDD mars 2011) .......35
3.5. Approche des marchés publics durables .................................................35
3.5.1. Les réglementations et circulaires fédérales ...........................................35
3.5.2. Le Service Public de Programmation Développement Durable et le Guide des
achats durables ..................................................................................40
3.5.3. L’assistance juridique ..........................................................................41
3.5.4. Les cellules de développement durable ..................................................41
3.5.5. EMAS ................................................................................................42
4. CONCLUSION ............................................................................................ 45
5. SOURCES .................................................................................................. 46

3
Mes remerciements à Jo Versteven et Hamida Idrissi du Service public fédéral
Développement durable qui m’ont aidée à mener à bien la présente version 2011.
Avertissement
- Texte basé sur ce qui est autorisé par le droit européen (Directive 2004/18/CE) et
guide "Acheter vert!" de la Commission européenne et ce qui en résulte en droit
belge.
- Le présent texte traite exclusivement des marchés de fournitures et de services
dans les secteurs classiques.
- Le texte comporte, outre l’introduction et la conclusion, une partie 1 relative aux
critères environnementaux. Les parties 2 (critères sociaux) et 3 (critères
éthiques) viendront compléter le texte par la suite.
- Le présent texte constitue la version 2011 du texte original, cette version a fait
l’objet de corrections, d’informations complémentaires et d’adaptations.

4
1. INTRODUCTION
Le développement durable est, au sein de notre société une préoccupation qu’il
est désormais impossible d’éviter en ce qu’elle concerne directement notre avenir
et celui des générations futures. Les pouvoirs adjudicateurs de l’Etat fédéral se
trouvent en première position de responsabilité à cet égard. Leur rôle est double:
intégrer le développement durable dans les marchés qu’ils passent afin
d’améliorer le score général à ce niveau, d’une part et susciter auprès des
soumissionnaires une offre croissante de produits et de services durables, d’autre
part.
Au niveau international extra-européen, cette préoccupation est apparue il y a
déjà un certain temps et est inscrite dans le chapitre 4, paragraphe 4.23 de
l’Agenda 21 (Sommet de Rio, 1992): "les gouvernements eux-mêmes jouent
également un rôle dans la consommation, notamment dans les pays où le secteur
public représente une part importante de l’économie, et peuvent avoir une
influence considérable tant sur les décisions des entreprises que sur les
perceptions du public. Ils devraient donc réexaminer les politiques d’achat de
fournitures de leurs organismes et départements afin d’améliorer si possible
l’élément environnemental de leurs procédures d’acquisition, sans préjudice des
principes du commerce international".
Ce n’est toutefois qu’au Sommet mondial pour le développement durable de
Johannesburg de 2002 que l’on a pu constater une prise de conscience au niveau
international relative aux dangers engendrés par l’activité économique, on parle à
ce moment-là, de "marchés publics écologiques".
Toujours en 2002, l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement
Economique) prévoit dans une recommandation une "politique d’écologisation des
marchés publics" et ce, via des mesures prises par les gouvernements pour
"améliorer les performances environnementales des marchés publics".
Les contraintes imposées par la réglementation des marchés publics limitent bien
évidemment la marge de manœuvre des pouvoirs adjudicateurs. Une firme privée
aura toute latitude pour intégrer le développement durable dans ses marchés,
jusqu’au niveau, même élevé, qu’elle s’est fixé alors que l’Etat fédéral doit
respecter sa propre réglementation qui ne peut aller plus loin que ce que le droit
communautaire impose au travers du Traité instituant les Communautés
européennes et au travers des directives qui régissent les marchés publics des
Etats membres de l’Union européenne.
L’article 6 du Traité de Maastricht (1992) prévoyait déjà des exigences relatives à
la protection de l’environnement et à sa prise en compte dans les politiques et les
actions de la Communauté européenne.
A ce niveau, la dernière décennie a apporté une très nette évolution: sous le
régime des directives européennes précédentes, la prise en compte des différents
aspects du développement durable dans les marchés publics était extrêmement
difficile pour ne pas dire impossible.

5
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne a fait évoluer cette
situation et cette évolution a été traduite dans les directives de 2004 (Directive
2004/18/CE en ce qui concerne les marchés publics des secteurs classiques).
"Conformément à l'article 6 du traité, les exigences de la protection de
l'environnement sont intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des
politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3 du traité, en particulier
afin de promouvoir le développement durable. La présente directive clarifie donc
comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent contribuer à la protection de
l'environnement et à la promotion du développement durable tout en leur
garantissant la possibilité d'obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport
qualité/prix".
"Aucune disposition de la présente directive ne devrait interdire d'imposer ou
d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de l'ordre, de la moralité et de
la sécurité publics, de la santé, de la vie humaine et animale ou à la préservation
des végétaux, en particulier dans l'optique du développement durable, à condition
que ces mesures soient conformes au traité" (Considérants (5) et (6) de la
Directive 2004/18/CE).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
1
/
46
100%