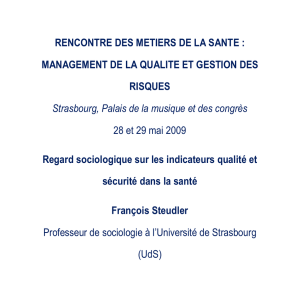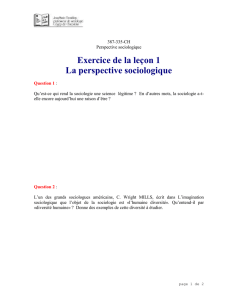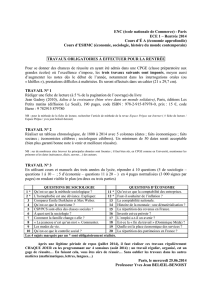Politiques publiques, séance 1

INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE TOULOUSE
Cours : « Sociologie de l’action publique » (M. Weisbein)
Section 1
Politiques publiques, action publique
Introduction :
Qu’est-ce qu’une politique publique ?
Il convient de faire retour sur le changement ayant affecté l’énoncé du cours en 2004 et qui
sera désormais maintenu : celui-ci n’est plus un enseignement de « politiques publiques »
mais propose à la place une « sociologie de l’action publique », l’« action publique »
englobant les « politiques publiques » mais ne s’y résumant pas.
Ce changement apparemment formel (mais qui est en fait une ouverture de l’objet)
s’explique :
- par les transformations affectant l’objet d’analyse lui même (qui seront
ventilées dans toutes les sections du cours) ;
- par un tournant disciplinaire majeur dans la science politique (qui sera l’objet
du I de cette section) ;
- mais surtout par l’imprécision du terme de « politique publique ». En
introduction, on va donc préciser en quoi celui-ci est flou.
Qu’est-ce qu’une politique publique ?
Le fait de poser cette question renvoie à un rite académique mais surtout à une réelle
difficulté initiale de définition de l’objet. On pourrait définir sommairement une
« politique publique » comme un produit normatif (un ensemble fini de normes, de
règles, de procédures…) pensé, impulsé, mis en œuvre par une autorité investie de
puissance publique et de légitimité gouvernementale afin d’intervenir sur un domaine
spécifique de la société ou du territoire. Or, le terme de politiques publiques renvoie à deux
termes imprécis :
La dimension « politique » : inutile de rappeler ici la polysémie bien connue du mot (que
l’anglais permet de contourner : politics, policy, politic).
D’autant plus que, pour une large part de la science politique, du moins la plus
sociologisée, la localisation de ce « politique » n’est ni l’Etat (et ses instances
périphériques : les partis, l’administration) ni le seul pouvoir : le politique est en fait une
qualification de relations sociales et de comportements sociaux divers, relevant de la
construction (inégale) de sens entre acteurs placés en situation de concurrence pour

2
l’obtention de biens divers et qui prennent le label de « politique » au sens où ils
concernent le champ politique.
D’où il découle qu’analyser les politiques publiques serait explorer une dimension de ce
champ politique, la plus institutionnalisée mais aussi la plus opératoire : les politiques
publiques délimitent et structurent les systèmes politiques, ses espaces, ses enjeux, ses
processus de règlement des conflits ou d’allocation des ressources, etc. On verra que tout
ceci est partiellement vrai.
Le « public » : ce terme renvoie d’abord littéralement à l’idée de destinataires, d’assujettis,
de bénéficiaires, d’usagers qui sont le public visé par l’action gouvernementale et
administrative. Mais plus généralement, le « public » dont il est question ici renvoie bien
sûr à l’Etat ; d’où étudier des politiques publiques serait traiter l’action
gouvernementale et il s’agirait ici de qualifier le travail gouvernemental pour en dégager
les caractéristiques principales. Or il y a au moins deux difficultés à ce stade :
- Il est parfois difficile de traiter scientifiquement de l’Etat (et du champ
bureaucratique) au sens où, comme Bourdieu le remarque, il institue lui-même et
impose au chercheur les catégories par lequel il est pensé : « entreprendre de penser
l’Etat, c’est s’exposer à reprendre à son compte une pensée d’Etat, à appliquer à l’Etat
des catégories de pensée produites et garanties par l’Etat, donc à méconnaître la vérité
la plus fondamentale de l’Etat »
1
. L’Etat impose non seulement ses catégories
d’analyse (« l’intérêt général », la « puissance publique », la « régulation », etc.) mais
aussi ses propres objets : « c’est dans le domaine de la production symbolique que
l’emprise de l’Etat se fait particulièrement sentir : les administrations publiques et
leurs représentants sont grands producteurs de « problèmes sociaux » que la science
sociale ne fait bien souvent que ratifier en les reprenant à son compte comme
problèmes sociologiques »
2
.
- La seconde difficulté est d’ordre moral, plus qu’intellectuel : l’idée de « politique
publique » sous-tend des éléments qui ne se trouvent pas vraiment dans la réalité et qui
sont connotés très positivement : l’idée de primauté de l’Etat, de volontarisme
politique, d’arbitrages justifiés et rationnels, de souci de l’intérêt général, de
souveraineté de la décision, de cohérence entre les moyens et les fins, d’inscription
nationale de la décision, etc. Or, face à des phénomènes comme la décentralisation, la
mondialisation, l’intégration européenne, on verra que ce qui est formellement produit
par l’Etat est en fait co-produit (dans l’Etat et entre l’Etat et d’autres groupes sociaux),
irrationnel, précipité, mu par des intérêts particuliers, instable, multi-niveaux,
polycentrique, etc.
L’ambiguïté des « politiques publiques » résulte en grande partie de cette juxtaposition entre
ces deux dimensions. On verra d’ailleurs tout au long des six sections qu’il est vraiment
difficile de donner une définition claire d’une politique publique et que cet objet, une fois
déconstruit, est avant tout caractérisé par sa complexité, sa fluidité, sa ductilité et son
instabilité. Au total, on verra la difficulté à gouverner qui caractérise les Etats modernes.
1
Pierre Bourdieu, « Esprits d’Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique », in Raisons pratiques. Sur la
théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994, p. 101.
2
Ibid., p. 104-105.

3
Malgré ce rappel à la prudence, il reste toutefois possible de penser l’action publique de façon
sérieuse ; il s’agit d’ailleurs de la principale originalité de l’étude des politiques publiques :
sociologiser notre regard sur l’Etat, c’est-à-dire saisir l’Etat à partir de son action (et non à
partir de ses catégories d’action ou de sa supposée « essence ») et voir quels sont les
déterminants de cette action (les résultats électoraux ? les intérêts propres au champ
bureaucratique ? la nature des problèmes sociaux ?) tout comme ses effets propres sur la
société.
On parlera donc plutôt d’une sociologie de l’action publique : analyse des actions entreprises
par l’Etat mais aussi des actions menées par d’autres groupes sociaux à des niveaux
multiples ; dans « l’action publique », on ne regarde pas que l’Etat (gouvernement,
administration, partis, etc.) mais aussi la société ; les « politiques publiques » ne sont pas
seulement issues de décisions publiques mais doivent être plutôt entendues comme des
assemblages composites d’éléments hétérogènes et recyclés (cf. conclusion de l’Ecopouvoir
de P. Lascoumes, référence 75
3
).
Il en découle une double déconstruction de l’Etat, en interne et en externe :
En interne : l’Etat n’est donc plus perçu par en haut et comme un bloc homogène ; mais
par le bas et par le détail, comme un agrégat d’institutions différentes (ministères,
administrations, grands corps etc.), éventuellement placées en situation de compétition car
porteuses de stratégies et d’intérêts divergents.
En externe : de même l’Etat est relativisé dans son environnement social, à travers des
interactions diverses et complexes qu’il entretient avec la « société civile » ; d’où une
frontière entre ces deux entités très poreuse.
On verra plus spécifiquement dans cette 1ère séance que l’action publique est un construit de
recherche (opéré par une discipline, la branche qui se spécialise à son effet) ainsi qu’un
construit social et politique (opéré par des groupes en situation de concurrence).
I. – L’approche disciplinaire :
les politiques publiques comme construits de recherche
Selon Jones, les politiques publiques sont des « catégories analytiques », c’est-à-dire autant le
produit de l’action des acteurs politiques que le travail de construction de son objet par le
chercheur. Il s’agit donc de prendre en considération les outils intellectuels, conceptuels et
méthodologiques, qui permettent à ce dernier de construire une politique publique, selon le
principe épistémologique de base selon lequel « le point de vue crée l’objet » (le savant
participe par ses outils conceptuels et disciplinaires à construire la réalité qu’il étudie ; il ne la
constate pas passivement).
3
Le numéro accompagnant les références bibliographiques renvoie au plan du cours tel qu’il a été donné en
amphithéâtre, lors de la séance inaugurale. En raison des ajouts qui accompagnent l’actualisation régulière du
cours, il se peut que cette numérotation soit décalée.

4
Cette nécessité de s’interroger sur la discipline dite de « sociologie de l’action publique » (ou
de branche de la science politique spécialisée sur les politiques publiques) est redoublée par le
fait qu’elle a ou peut avoir des effets directs ou indirects sur l’action publique (il s’agit de la
notion de double herméneutique chez Anthony Giddens). Le contexte général de l’action
publique est marqué par quatre grandes mutations qui favorisent d’autant plus ces effets de
double herméneutique :
- la managerialisation de l’Etat
- la transnationalisation de l’action publique
- la mise en concurrence des territoires de l’action publique (le niveau national n’est
plus le seul ni le plus important)
- et surtout l’importance des activismes savants, des militantismes de chaire.
D’où l’idée avancée par Olivier Ihl de « sciences du gouvernement » qu’il s’agirait d’analyser
(référence 66) : gouverner, c’est s’appuyer sur des modèles d’action qui s’imposent et en
imposent par leur capacité à se draper d’une forme d’objectivité ; il faut donc étudier les
interactions multiples entre des savoirs académiques et des pratiques bureaucratiques, souvent
à travers des formes d’ingénierie de gouvernement et des catégories d’intervention publique
(l’exemple type étant la fameuse « gouvernance »). D’où également la nécessité d’une analyse
sociologique de ces « entrepreneurs de scientificité » qui visent des effets de légitimation
scientifique de l’action bureaucratique.
L’institutionnalisation de l’analyse des politiques publiques, c’est-à-dire son émergence en
tant que champ d’études spécialisé (et ce, dans une approche de sociologie des sciences) est
ici saisie à travers une double déconstruction (à la fois dans le temps et dans l’espace). Cela
permettra notamment de souligner l’hétérogénéité des approches scientifiques des politiques
publiques.
A. Les racines praxéologiques : Government Studies et management public
Le 1er moment est celui de l’approche pragmatique dans l’analyse des politiques publiques ;
celle-ci vise à apporter un ensemble de méthodes rationnelles et opératoires au service des
décideurs politiques et à mettre en œuvre les méthodes modernes de gestion des entreprises
dans le secteur public (d’où la dimension praxéologique : le savoir tourné vers l’action).
L’analyse des politiques publiques naît d’abord aux EU après la seconde guerre mondiale,
dans le contexte historique du New Deal et de l’Etat interventionniste puis de la crise
économique des années 1970, et s’oriente de façon pragmatique et fonctionnaliste vers la
résolution des problèmes d’allocation des ressources publiques. Il s’agit de la tradition anglo-
saxonne des government studies qui obéissent à plusieurs caractéristiques :
- le financement privé (par exemple par la fondation Ford) pour de nombreuses enquêtes ;
- la dépendance de l’agenda scientifique par rapport aux problèmes concrets rencontrés par
les administrations ;
- l’imbrication des registres descriptifs et prescriptifs ;
- et l’éclatement des cadres d’analyse en raison des singularités sectorielles des études
(l’objet prime le concept).

5
Avec l’apparition de l’analyse des politiques publiques, il s’agit donc d’une science pour
l’action des gouvernants. La question est la suivante : dans quelles conditions sont faits les
choix publics et comment les éclairer ? De même, le débouché de ce programme réside dans
la formation à la gestion publique auprès des hauts fonctionnaires (cf. création d’écoles de
management public aux EU : citons la Graduate School of Public Policy à Berkeley, la
Kennedy School of Government de Harvard ou la filière de management public à la Graduate
School of Business de Stanford).
Mais cela renvoie aussi à l’histoire du droit public et aux logiques propres au champ juridique. On
peut renvoyer ici à une périodisation classique du droit administratif en trois périodes distinctes :
1. Entre 1800 et 1900, on observe le règne du critère de la puissance publique ; le langage
administratif qui domine est le principe de soumission hiérarchique au politique et de respect de la
règle juridique : c’est le langage du droit
2. Entre 1900 et 1945-60, c’est le règne du critère du service public ; l’administration s’est
développée au delà des critères traditionnels de l’Etat libéral et embrasse de nombreux secteurs ; le
langage du droit administratif s’enrichit d’un savoir technique propre à chaque secteur et mis en
œuvre par des spécialistes.
3. Depuis 1960, la crise du critère du service public est actée ; on observe dès lors l’apparition du
langage managerial pour mieux gérer les organisations publiques. Le management public se
développe, en réponse à cette crise fonctionnelle du critère du service public.
Une autre petite digression : l’apparition de cette tradition d’analyse renvoie plus fondamentalement à
la genèse sociale de la « question technocratique » à partir des années 1930 (cf. l’ouvrage de V.
Dubois et D. Dulong, référence 29). Celle-ci traduit une nouvelle représentation du rôle de l’Etat dans
la société : l’image de rationalité et de modernité de l’administration s’impose fortement. L’usage du
terme de technocratie désigne en effet la politique neutralisée par la technique : le technocrate désigne
un acteur social censé exercer un pouvoir politique grâce à sa compétence technique et non pas en
vertu de la détention d’un poste électif. Reste à constater la variété immense des groupes sociaux ou
des configurations politiques ou historiques qui ont suscité une qualification de technocratie. Il faut en
fait parler des technocraties, des formes possibles de la technocratie. Un invariant se dessine toutefois :
la technocratie désigne une homologie de position dans les cercles dirigeants des sociétés ; les
technocrates revendiquent en effet une place, la meilleure possible, dans le cercle des élites, en arguant
d’une compétence professionnelle et technique dont l’utilité est tenue comme incontournable dans le
travail politique et le gouvernement des sociétés (citons l’économie, le droit, l’informatique, etc.). Ces
ressources qui fondent l’identité du groupe ont un point commun : elles relèvent de sciences
appliquées, c’est-à-dire orientées vers la décision politique, comme les sciences de l’ingénierie
étatique. Et ce d’autant plus que les sciences sociales (sociologie, science politique notamment) ont
tout particulièrement contribué à la reconnaissance politique de la question technocratique ; entre 1945
et 1960, en France par exemple, sociologie et science politique se pensent comme des auxiliaires des
pouvoirs publics ; les sociologues se veulent des ingénieurs du social et non plus des sociologues de
salon. La question technocratique, la technique au service de la politique, devient donc un problème à
résoudre.
B– L’analyse des politiques publiques en France
Cette genèse praxéologique se traduit en France par un mouvement de spécialisation de la
question des politiques publiques en sociologie à partir des années 1960 puis en science
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%