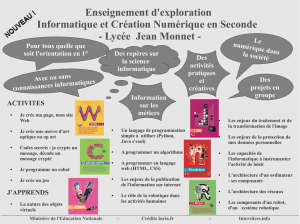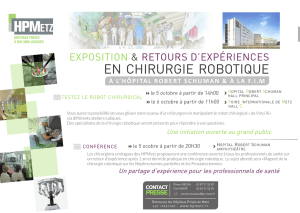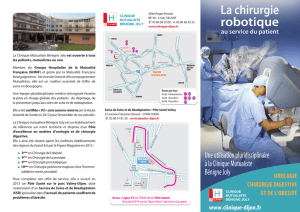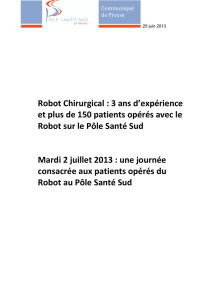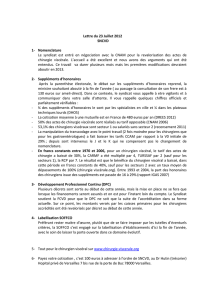réflexions à propos de la chirurgie robotique

1
RÉFLEXIONS À PROPOS DE LA CHIRURGIE ROBOTIQUE
Yves CHAPUIS *
* Membre de l’Académie Nationale de Médecine, Professeur Emérite à l’Université Paris V,
ancien Chef du Service de Chirurgie Générale et Digestive de l’Hôpital Cochin.
Résumé.
L’engouement suscité par la chirurgie robotique parmi les chirurgiens de nombreux pays incite à
s’interroger sur les avantages de cette nouvelle technique opératoire par rapport à la chirurgie mini-
invasive vidéo-endoscopique. L’insuffisance d’études prospectives contrôlées confrontant les deux
méthodes sur le plan des coûts, des résultats obtenus en terme de sécurité et de durée opératoire, les
conséquences qu’elles entrainent dans la formation des chirurgiens, enfin sur les changements qu’elles
provoquent dans la relation médecin- malade sont des éléments à prendre en compte. Tel est le but de
cet exposé.
Summary.
The attractiveness arroused by robotic surgery among surgeons of many countries incited to a
questioning on the advantages of these new technic,in comparison of mini-invasive video-endoscopic
surgery.The shortfall of controled prospective studies comparing the two methods based on cost,
results obtained concerning security and opérative length, the problem of the training of surgeons , in
the end the changes in surgeons to patient relations are éléments to considerd. This is the aim of this
presentation.
En 1988 la Chirurgie a fait un bond spectaculaire avec l’apparition de la chirurgie mini-
invasive. Fruit de l’endoscopie intra-abdominale développée en France par Raoul Palmer, elle
allait passer, grâce à l’audace d’un gynécologue Lyonnais Philippe Mouret ( 1), du statut de
technique d’exploration des organes pelviens à l’étape interventionnelle à la suite de
l’ablation d’une vésicule pathologique sans ouverture de la paroi abdominale ( 1987). Sur les
pas d’un opérateur au début critiqué, le Professeur François Dubois allait donner une
impulsion décisive à cette technique, étonner le monde médical ( 2 ) au point que la chirurgie
laparoscopique, ou coelioscopique qu’il vaut mieux appeler chirurgie vidéo-endoscopique
(CVE) allait être qualifiée par les Américains « de deuxième révolution française ».
Son principe est simple : dans la perspective d’enlever un organe, profiter de l’existence
d’une cavité naturelle ou créer cette cavité, par injection au moyen d’une aiguille fine d’un
gaz inerte afin de refouler sous pression contrôlée les différents viscères.Mettre en place une
optique qui, reliée à un écran, va donner à l’opérateur une image en deux dimensions du site
opératoire . Introduire au moyen de fins trocarts traversant la paroi les instruments utiles dans
l’espace ainsi créé, pince, ciseau, tracteur, écarteur, coagulateur, dissecteur.Ces instruments
maniés de l’extérieur par le chirurgien qui n’a plus de contact direct avec les tissus, et par
conséquent perd la sensibilité tactile et dont la vision est bi et non tridimensionnelle,
permettent de réaliser l’opération.

2
Les avantages de cette méthode opératoire sont les suivants : diminution du traumatisme des
tissus grâce à la concentration du champ d’exposition , réduction des pertes sanguines et du
besoin de transfusion , des douleurs post-opératoires et de l’inconfort qui s’ensuit , du risque
d’infection, raccourcissement de l’hospitalisation, récupération physique plus rapide, enfin
avantage cosmétique en raison de la petite taille des cicatrices,- tout ceci bien entendu dans
l’éventualité d’une intervention se déroulant dans les meilleures conditions, sans nécessité de
convertir en chirurgie ouverte devant une difficulté opératoire ou une complication. A
l’extrême tous les trocarts peuvent emprunter l’ombilic et mieux encore, si mieux est le mot
qui convient, passer par voie buccale au travers de l’estomac ou utiliser le vagin chez la
femme .
La cholécystectomie laparoscopique première en date des interventions intra-abdominales
s’est peu à peu imposée.Puis d’autres interventions ont été tentée dans l’abdomen (3),
l’espace rétro-péritonéale (4), favorisées par l’amélioration du matériel, l’entraînement et
l’expérience des chirurgiens, auxquels on peut ajouter l’esprit de compétition, l’envie de la
nouveauté, la pression des patients désireux de bénéficier d’une chirurgie « moderne ». Il faut
bien convenir cependant, d’une part que la méthode ne s’est pas généralisée, qu’à l’inverse
son utilisation inconsidérée dans des mains inexpertes a donné et donne encore lieu à des
complications graves et à des résultats qui comparativement aux techniques traditionnelles ne
s’avèrent pas supérieurs en terme de sécurité. Il n’en demeure pas moins que toutes les
spécialités chirurgicales et les différentes interventions qui s’y rattachent recourent à la
chirurgie mini-invasive
C’est dans ce contexte de chirurgie innovante que se pose aujourd’hui la question du
développement de la chirurgie robotique (CH RO). De quoi s’agit-il ?
Les principes de la chirurgie mini-invasive vidéo-endoscopique sont respectés : action des
instruments à l’intérieur d’un espace « de travail » créé ou naturel, utilisation de trocarts de
faible diamètre perforant la paroi, contrôle de leurs mouvements par une optique relié à un
dispositif donnant au chirurgien une vue instantanée du champ opératoire. On retrouve ici les
éléments qui ont pour conséquences de réduire au maximum les dégâts pariétaux et le
traumatisme des organes.
La grande différence avec la CVE est que les instruments et l’optique sont manipulés par les
bras d’un robot portés par un chariot mobile, accompagné d’un chariot d’imagerie. Ces
derniers placés de façon stérile au dessus de l’opéré, actuellement assez encombrants et
d’installation longue, sont reliés au chirurgien assis dans une console opératoire, les yeux
rivés sur deux verres de lunettes, les mains agrippées à deux poignées de télémanipulation
destinées à guider les bras du robot au nombre de trois ou quatre , les commandes manuelles
étant assistées d’un pédalier.
L’avantage est que grâce à deux sources lumineuses et deux caméras le chirurgien dispose
d’une vision tridimensionnelle avec un grossissement progressif jusqu’à 20 fois. Quant aux
mouvements des instruments leur précision est très grande, leur degré de liberté de 7 contre 3
pour la main de l’homme et bien entendu sans le moindre tremblement. C’est pourquoi,
s’agissant de micro-chirurgie, le robot rivalise ou domine la main de l’homme selon les
aptitudes individuelles ( 5 ).
Ainsi s’interpose entre le corps de l’opéré et le chirurgien un matériel lourd et complexe,
véritable révolution par rapport à la chirurgie traditionnelle. De surcroît grâce à un écran
télévisé, élèves chirurgiens, infirmières, anesthésistes peuvent suivre l’intervention dans des
conditions inégalées, au besoin diffusée sur grand écran dans un congrès.

3
La CHRO peut en outre être précédée d’une exploration radiologique préopératoire (6) :
scanner, IRM, opacification vasculaire permettent de dessiner avec une précision étonnante la
limite des lésions, leur rapport avec les organes de voisinage, leur vascularisation. A partir de
là il est possible de simuler sur écran l’opération, temps de dissection, de clivage,
d’hémostase des vaisseaux. Les différentes manœuvres peuvent être enregistrées,
informatisées, stockées sur un clé et le moment venu exploitées par le robot alimenté par le
programme sous contrôle de l’opérateur .
La chirurgie robotique étant ainsi présentée , il reste à aborder de nombreuses questions :
champ d’application, avantage par rapport à la chirurgie vidéo-endoscopique, incidence en
terme d’acquisition du matériel et d’organisation des structures de soins , effet sur les
dépenses de santé, formation des équipes chirurgicales et parmi elles des chirurgiens, enfin
modifications entrainées dans la relation médecin malade.
Champ d’application.
Actuellement la chirurgie robotique, particulièrement développée aux USA, est utilisée dans
de nombreux domaines ( 7,8, 9,10 ) Un inventaire détaillé réalisé en 2010 aux USA (9)
examine ses différentes applications à partir de 124 publications de langue anglaise où la
chirurgie robotique est envisagée dans de nombreux domaines: chirurgie générale et gastro-
intestinale (cholécystectomie, opération de Nissen, myotomie de Heller, chirurgie bariatrique,
gastrectomie, pancréatectomie, colectomie, rectopexie, splénectomie, cure de hernie),
gynécologie ( hystérectomie, curage ganglionnaire, colpopexie , traitement de fistules vésico-
vaginales, salpingoplastie, myomectomie), chirurgie pédiatrique où les indications recouvrent
de nombreuses interventions, chirurgie thoracique (thymectomie, tumeurs
oesophagiennes,lobectomie pulmonaire ), urologie ( pyéloplastie, néphrectomie partielle ou
totale, cystectomie, prostatectomie radicale, néphrectomie chez le donneur vivant,
surrénalectomie), chirurgie cardiaque ( revascularisation des coronaires, réparation ou
remplacement valvulaire, fermeture de communication interauriculaire et de canal artériel),
chirurgie orthopédique ( arthroplastie de hanche et du genou). Il n’est pas fait mention dans
cet inventaire de la chirurgie robotique dans la sphère ORL, pourtant utilisée pour l’exérèse
de tumeur buccale ou aérienne supérieure ( 12) dans le domaine de l’endocrinologie ( 13)et de
la micro-chirurgie ( transplant de lambeau, greffe de tissus) (5 ).
Le développement de la CHRO est ainsi à l’origine d’un nombre important de publications.
Pour la seule chirurgie digestive la littérature de 2001 à 2010 compte 109 articles. L’analyse
des 124 publications sélectionnées citées plus haut (9), situe la répartition des travaux:
chirurgie digestive :29, gynécologie : 16, chirurgie pédiatrique :5, chirurgie thoracique : 6,
urologie :15, chirurgie cardiaque :17, orthopédie : 3.
Il convient toutefois de faire la distinction entre les publications qui en raison d’une
expérience limitée ou un défaut d’étude comparée ne font que confirmer, pour la plupart,
l’intérêt de la CHRO et les études prospectives ou les méta-analyses . Dans ce cas les
conclusions différent selon les interventions. Dans certaines spécialités il n’est pas montré de
supériorité de la CHRO sur la CVE.

4
En France la CHRO s’est particulièrement développée en urologie (14,15 ), en chirurgie
cardiaque (16 ), a fait l’objet de tentatives en chirurgie digestive 17,18) et a été employée
pour le prélèvement de rein chez le donneur vivant (19 ).
Avantages et inconvénients.
Indépendamment de la maîtrise et de la précision des manipulations intra-corporelles, du
confort du chirurgien, la CHRO, au même titre que la CVE, offre l’avantage de voies d’abord
non délabrantes donc esthétiques, d’une limitation du saignement opératoire, de suites
opératoires plus simples et plus courtes allant de paire avec une hospitalisation écourtée.
Cependant comme pour la CVE la nécessité de conversion en voie ouverte apparaît dans
toutes les publications. Le chirurgien doit y être préparé et l’opéré informé.
Un jugement objectif ne peut tenir compte de publications ou d’expériences optimistes de
telle ou telle équipe, fréquentes en particulier en urologie à propos de la prostatectomie ou de
la cure de sténose de la jonction pyélocalicielle. En réalité seules les conclusions tirées de
méta-analyses ou d ‘études comparant CHRO et CVE sont instructives. Elles sont
malheureusement peu nombreuses puisque la technique est d’apparition récente.
Les principales méta-analyses ( 20, 22, 23, 24) intéressent soit une intervention sur les voies
urinaires( pyéloplastie urétérale, prostatectomie ) , soit différentes interventions intra-
abdominales en particulier cholécystectomie et opération de Nissen.
Les conclusions de ces méta-analyses ainsi que celles tirées du travail de synthèse de
l’United Haethle Car Robot Assisted Surgery (9 ) ne relèvent aucun avantage décisif en
faveur de la CHRO en terme de pertes sanguines, durée de séjour, résultats post-opératoires,
taux de conversion . La notion de coût est souvent passée sous silence, sauf dans quelques
travaux qui montrent un écart important lié à l’acquisition du matériel, son entretien et le
temps d’immobilisation des différents personnels. Le seul avantage pour le chirurgien, installé
dans sa console, est la suppression des aides opératoires encore que certains chirurgiens
estiment l’assistance d’un aide nécessaire ( 21).
Si en terme de précision du geste et du mouvement des instruments une standardisation est
obtenue évitant l’effet opérateur ( l’habileté n’est plus celle de l’homme mais celle de la
machine), le temps nécessaire à l’opération est tantôt comparable à la CVE, tantôt accru
jusqu’à deux fois la durée nécessaire par rapport à la durée habituelle. L’anesthésie s’en
trouve prolongée tandis que l’anesthésiste doit être particulièrement vigilant car un réveil
intempestif peut être source de complications locales.
Quant à la préparation par imagerie des différents temps opératoires, elle est pour un
chirurgien en activité un investissement temps supplémentaire qui n’ira pas vers d’autres
besoins. Son seul intérêt est pédagogique.
L’impression générale est que la supériorité de la CHRO n’est nullement démontrée, sauf
chez les partisans de la technique, qui évoquent au besoin son attractivité sur les utilisateurs
potentiels. On est surpris de l’engouement exprimé dans des articles de vulgarisation.
(Wikipédia, Sciences et Vie, juin 2009). Un des effets pervers est une modification des
indications notamment en matière de cancer de la prostate. L’attractivité exercée sur la
clientèle par le nouveau procédé, alimentée par la publicité que développent tous ceux qui en
tirent profit, a conduit au cours des années 2005 à 2008 à une augmentation des indications
d’exérèse chirurgicale au dépens de moyens moins invasifs et surtout moins coûteux ( 9).

5
Les travaux les plus consistants concluent à la nécessité de nouvelles études prospectives
contrôlées, faisant intervenir séparément ou de manière conjointe les bénéfices médicaux,
économiques et humains. D’autres se référant à leur expérience émettent des doutes qu’il
s’agisse de chirurgie digestive (25) urologique (26) ou cardiaque ( 16 ) .
Incidence en matière d’acquisition du matériel et d’organisation des structures de soins.
Selon les informations disponibles le prix d’un robot Da Vinci varie de 1.140 000 et 1.900
000 € somme à laquelle il convient d’ajouter le coût de la maintenance annuelle, de 106 400
à 133 000 € et celui des instruments , utilisables de façon limitée ( une dizaine d’intervention)
et dont chaque unité coûte en moyenne 912 €. La durée de vie de l’appareil est de l’ordre de
5 années. Dans les établissements hospitaliers publics ou privés où la préparation par
l’imagerie est utilisée, le coût de l’ opération en est accentué. Si on tient compte de la durée
d’immobilisation des locaux, du temps en personnels nécessaires à l’acte opératoire, il est
évident que par rapport à une intervention traditionnelle le coût unitaire est plus élevé. Une
évaluation par acte est donc indispensable , comparée d’une part à la nomenclature, d’autre
part au bénéfice attendu en terme de sécurité, de résultats, de durée de séjour et de reprise
d’activité.
Deux publications se sont penchées sur l’aspect économique (27, 28) Leurs conclusions sont
les suivantes :1/ Indépendamment du coût d’achat du matériel, celui de la maintenance et des
instruments est supérieur à celui de la CVE ou de la chirurgie ouverte (CHO). 2/ Le coût lié à
l’utilisation de la salle d’opération est du fait de la durée moyenne des interventions
supérieur à celui des autres procédures. 3/ En revanche par rapport à la chirurgie ouverte
traditionnelle le gain en journées d’hospitalisation compense en partie l’investissement de la
CHRO. 4/ La CVE est beaucoup moins couteuse pour des avantages identiques à la CHRO
mais la courbe d’apprentissage est plus longue et sa pratique exige des chirurgiens
expérimentés.
En l’état actuel aucune information publiée et complète n’existe en France sur ce sujet pour
les Centres disposant d’un robot da Vinci. Aux USA où le nombre d’appareil en service serait
de plus de 1000 soit 1,5 appareil par million d’habitant, chiffre comparable en Belgique,
contre 0,5 p.m.h. dans d’autres pays développés, les études économiques sont lancées. Selon
le fabriquant cette croissance serait explosive puisque le nombre d’actes réalisées dans le
monde serait passé de 80 000 en 2007 à 250 000 en 2 009 et que celui d’appareils vendus
pendant cette période atteindrait 400. Il est intéressant de noter que ce sont la Corée du Sud et
le Brésil qui s’inscriraient en tête dans ce domaine, pays dont on peut dire que les populations
n’ y ont pas un égal accès aux soins .
En France, le nombre d’appareils était de 39 en 2010 répartis entre les CHU de Nancy,
Strasbourg, Nîmes, Nantes, Tours, Brest, Rennes, Lyon, à l’APHP de Paris : Georges
Pompidou, Henri Mondor, La Pitié et des Etablissements privés, Institut Montsouris à Paris,
pôle santé du Mans, polyclinique Kenval à Nîmes, Centre d’andrologie de Paris, Clinique du
Tonkin, Clinique Océane à Vannes, Clinique de la Louvière à Lille.
Il est évident que le développement de la chirurgie robotique exige des structures de soins,
une organisation adaptée afin que , dans le cadre des indications qui sont les siennes, en
attendant de nouvelles perspectives, le matériel soit utilisé au maximum. C’est ainsi, qu’il
s’agisse d’établissements publics ou privés, que l’existence de bloc opératoires communs, la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%