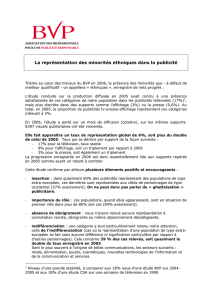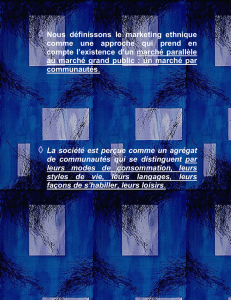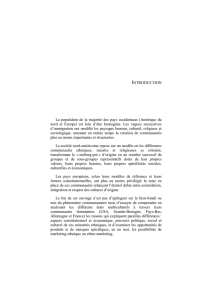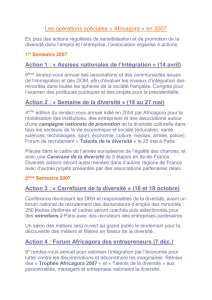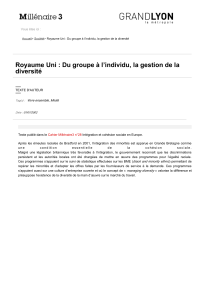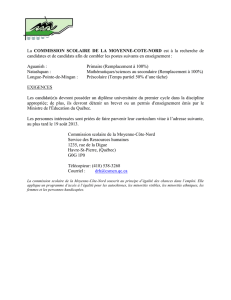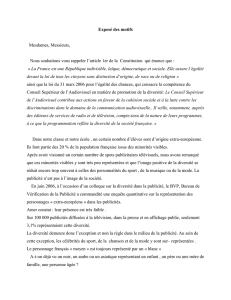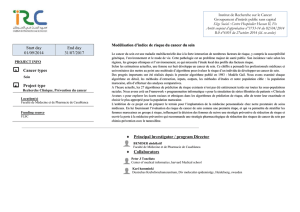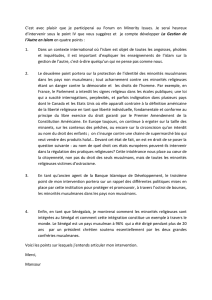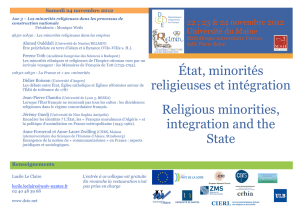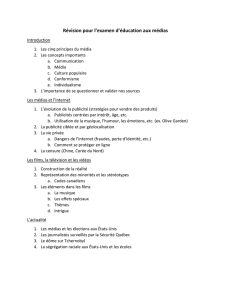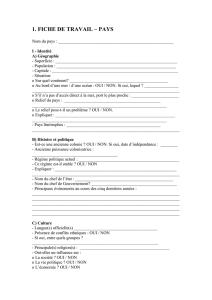8. Constitution d`une base de connaissances sur la santé des

COMITE D’EXPERTS SUR LES SERVICES DE SANTÉ
DANS UNE SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE
EXPOSÉ DES MOTIFS

2

3
ADAPTATION DES SERVICES DE SANTÉ À LA DIVERSITÉ
CULTURELLE DANS UNE EUROPE MULTICULTURELLE
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. INTRODUCTION
Grâce aux apports de la migration, l’Europe est de plus en plus diverse et poursuit son
évolution vers une société multiculturelle. Dans la plupart des pays européens, on
manque d’informations quantitatives sur l’état sanitaire des minorités ethniques. De
nombreux indices laissent cependant à penser que, par rapport à la population
autochtone, celles-ci sont davantage exposées à la maladie et souffrent d’affections
plus variées. Il existe également relativement peu d’informations sur l’accessibilité du
système de santé aux minorités ethniques, la qualité des soins qu’elles reçoivent, leur
satisfaction à l’égard de ces soins et les problèmes qu’elles rencontrent dans le cadre
du système de santé. Des études de plus en plus nombreuses semblent toutefois
indiquer que les services de santé sont souvent mal adaptés à la diversité culturelle de
la clientèle à laquelle ils sont appelés à s’adresser.
Le terme « minorité ethnique » désigne un groupe de personnes qui se sentent proches
les unes des autres, parce qu’elles estiment (subjectivement) avoir une origine
commune, parfois une même langue, une culture partagée et une forme de conscience
collective en laquelle chacun se reconnaît quelle que soit sa position sociale dans le
groupe.
Bien que la recommandation et le présent exposé des motifs soient centrés sur la
diversité (culturelle) liée à la présence de minorités ethniques en Europe et sur sa
gestion, les experts soulignent que la diversité devrait être considérée comme une
caractéristique générale de la population. C’est pourquoi la gestion de la diversité
devrait faire partie intégrante de l’organisation des soins de santé destinés à
l’ensemble de la population.
A. Remarques sur l’état sanitaire des minorités ethniques
Les études réalisées établissent clairement que certaines maladies et causes de décès
sont beaucoup plus fréquentes dans certains groupes ethniques que dans d’autres.
Ainsi, la thalassémie ne touche pas les populations autochtones ouest-européennes,
mais elle représente un problème sanitaire rare – mais important – chez les personnes
originaires du bassin méditerranéen (Schulpen, 1994). Autre exemple : l’anémie
falciforme qui, en Europe occidentale, ne se rencontre que chez les minorités noires
(notamment au Royaume-Uni) (Ahmad, 2000).
Un domaine relativement bien étudié est celui de la mortalité périnatale et infantile :
celle-ci est généralement beaucoup plus élevée chez les groupes ethniques
minoritaires que dans la population autochtone. Elle est par exemple de 14,4 ‰ chez
les « nord-africains »
1
et de 17,7 ‰ chez les « Turcs » vivant en Belgique, contre
1
. Les termes « Turcs », « Marocains », etc. sont utilisés pour désigner l’origine nationale et non la
nationalité effective des personnes concernées.

4
10,7 ‰ pour la population belge autochtone (Peeters & De Muynck, 1994). Les
données sur la mortalité périnatale sont importantes, car elles sont considérées comme
l’un des indicateurs les plus objectifs de la santé d’une population (Schulpen, 1996).
De plus, une étude effectuée aux Pays-Bas révèle que la mortalité chez les enfants
d’origine marocaine ou turque est deux fois plus élevée que chez les enfants
néerlandais (Van Steenbergen et al., 1996). En Allemagne, on a constaté en 1999 que,
sur 1000 enfants immigrés nés en bonne santé, 5,4 en moyenne décédaient au cours de
leur première année de vie. Ce chiffre était de 4,4 dans le groupe allemand témoin
(Bureau fédéral allemand des statistiques, 2000).
Pour les autres problèmes de santé, les données sont peu abondantes. Au Royaume-
Uni, il s’est avéré que le diabète de type 2 était deux fois plus fréquent chez les
personnes venues du sous-continent indien. Roderick et al. (1994) ont montré que le
risque que ces personnes présentent une insuffisance rénale au stade terminal
(nécessitant un traitement de substitution rénale ou une greffe de rein) était dix fois
supérieur à celui couru par les Britanniques. De plus, il y a lieu de penser que, dans
certains pays, des obstacles à l’accès à la transplantation nuiraient à son équité,
comme une étude l’a récemment montré en Australie à propos des Australiens
autochtones (Cass, Cunningham, Snelling et al., 2003).
Plus important encore, plusieurs études indiquent que les minorités ethniques
présenteraient un moins bon état sanitaire général. Les Pays-Bas sont l’un des rares
pays à organiser des études sanitaires dans différents groupes ethniques
2
. D’après
l’étude sanitaire réalisée chez les Turcs habitant aux Pays-Bas, toutes les données
recueillies montrent que l’état sanitaire ressenti (et dans une mesure limitée objectif)
de ces personnes est moins satisfaisant que celui des Néerlandais. Quelque 25 % des
Turcs décrivaient leur propre état de santé comme « pas très bon », contre 11 % des
Néerlandais. Plus de 33 % des Turcs souffraient d’au moins une maladie chronique
(25 % des Néerlandais). La prévalence de l’obésité (définie par un indice de Quételet
supérieur à 27) était de 33 % chez les Turcs, soit deux fois plus importante que chez
les Néerlandais (CBS, 1991).
B. Causes des variations ethniques de l’état sanitaire
Le débat sur les inégalités de classe (ou socio-économiques) en matière de santé a
éclairé l’analyse des variations ethniques de l’état sanitaire. Cette question a
commencé à retenir l’attention en 1980 avec la publication du rapport Black au
Royaume-Uni. Pour expliquer le rapport inverse observé entre classe sociale et
mortalité prématurée, le rapport Black proposait quatre théories possibles – biais dans
les méthodes de mesure, sélection sociale, causes culturelles et causes matérielles –,
en privilégiant la dernière (à savoir les effets directs ou indirects des conditions
environnementales et économiques défavorables). Andrews et Jewson (1993) et
Smaje (1996) ont développé ce cadre en vue d’examiner les variations ethniques en
matière de santé. Ils distinguent les catégories suivantes :
Facteurs biologiques/génétiques
2
. Plusieurs auteurs estiment que les études sanitaires générales se prêtent mal à la collecte de données
sur la santé des minorités ethniques (voir par exemple Bhrolchain, 1990).

5
Facteurs culturels
Facteurs matériels – facteurs socio-économiques
Facteurs liés à l’immigration
Racisme
Effets sélectifs des soins de santé – qualité des soins
Compte tenu de son importance cruciale pour toute initiative visant à améliorer l’état
sanitaire des minorités ethniques, nous ferons brièvement le point sur l’état actuel de
la réflexion concernant les facteurs déterminants des variations ethniques en matière
de santé. Cette question a également été longuement débattue lors des réunions du
Comité d’experts.
1. Facteurs biologiques/génétiques : A ce jour, il n’a pas été clairement établi dans
quelle mesure les facteurs biologiques/génétiques peuvent contribuer aux
variations ethniques en matière de santé (Bradby, 1995 ; Smaje, 1996 ; Senior &
Bhopal, 1994). Certaines maladies et cause de mortalité sont beaucoup plus
fréquentes dans certains groupes ethniques que dans d’autres : la thalassémie et
l’anémie falciforme (drépanocytose) en sont des exemples classiques. De façon
globale, un certain nombre d’études indiquent que l’état sanitaire général des
minorités ethniques est moins bon, mais les données restent limitées.
2. Les facteurs culturels sont une autre des explications avancées. Des types de
comportement considérés comme caractéristiques de certaines minorités ethniques ont
été mis en cause. Un exemple de coutume très controversée dans de nombreux pays
d’Europe occidentale est l’excision, pratiquée par exemple en Somalie ou en Egypte.
Des études ont par ailleurs montré que la culture pouvait jouer un rôle important dans
l’attitude à l’égard du recours à une aide extérieure. Le fait que les femmes
marocaines de la première génération d’immigrés ne considèrent pas la grossesse
comme un état nécessitant une assistance médicale est sans aucun doute l’une des
nombreuses raisons pour lesquelles elles ne se présentent pas en temps voulu dans les
cliniques prénatales de Belgique, (Verrept & Timmerman, 2001). L’image
d’« impureté » que les Voyageurs et les Roms attachent à la population majoritaire
peut aussi être un frein à l’utilisation du système de santé. Les modèles explicatifs
appliqués par certains groupes ethniques – mais que ne partage pas la majorité –
peuvent les conduire à recourir à des services de santé traditionnels dans le pays
d’accueil ou le pays d’origine. En outre, certains secteurs du système de santé peuvent
être perçus comme trop dégradants pour qu’il soit possible d’y faire appel. C’est le cas
par exemple des traitements psychiatriques, comme cela a été observé chez certains
groupes ethniques au Royaume-Uni (Donovan, 1984). Des études médicales
anthropologiques et psychiatriques font apparaître l’existence de syndromes liés à la
une culture, notamment dans le domaine de la santé mentale (Kleinman & Good,
1985 ; Kleber, 1996). Il s’agit d’un groupe de maladies à caractère ethnique, dont
chacune ne se rencontre que dans une culture ou une région donnée et recouvre un
ensemble spécifique de symptômes, de signes ou de changements comportementaux
reconnus par les membres de ces groupes culturels et suscitant une réponse
normalisée (Helman, 1990). Comme ces syndromes ne correspondent pas aux
catégories biomédicales, il arrive que les professionnels de santé nient leur existence,
pourtant patente pour les membres des groupes culturels concernés. Ainsi, les
syndromes liés à la culture peuvent être une source de confusion et de malentendu
entre les professionnels de santé et les patients.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%