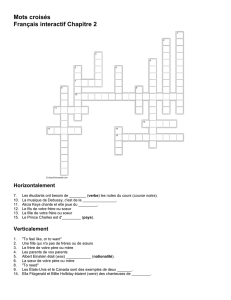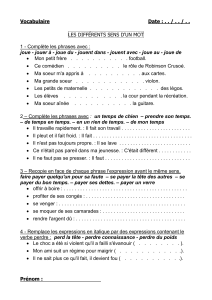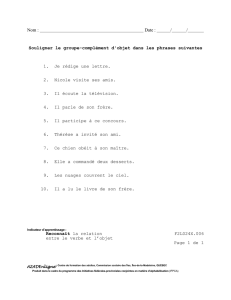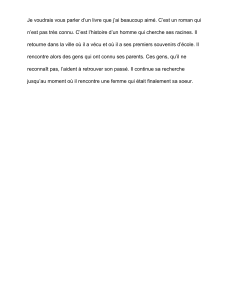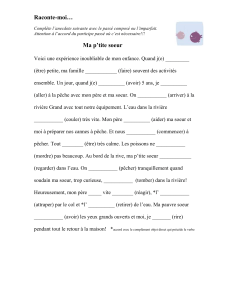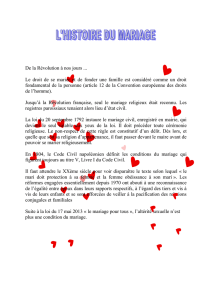Dernière sortie hors de l`Occident et loin de notre temps. À la

Dernière sortie hors de l'Occident et loin de notre temps. À la découverte des « abominations »
des anciens Égyptiens et Iraniens
« Si nous ne connaissions pas la coutume du mariage entre frère et sœur chez les Égyptiens, nous
affirmerions, à tort, qu'il est universellement reconnu que les hommes ne peuvent épouser leur sœur
86
. »
Sextus Empiricus, philosophe et physicien grec,IIème siècle ap. J.-C.
Les Na nous ont fourni l'exemple d'une société où existent des échanges (de sperme) entre matrilignées
sans que ces échanges soient l'occasion de fonder des alliances et donc de se faire des alliés. En allant
visiter les anciens Égyptiens, nous découvrons une société où, pendant des siècles, on a trouvé normal
que des frères et soeurs se marient ensemble et où on encourageait même fortement de tels mariages, ceci
non seulement au sein des familles dynastiques, mais aussi parmi les autres couches de la population.
Ainsi, un nombre très important de mariages, dans la mesure où ils unissaient deux consanguins les
plus proches l'un de l'autre, constituaient des alliances sans échange, à l'inverse des Na qui, eux,
pratiquaient des échanges sans alliances. Mais les Égyptiens, eux non plus, en se mariant au sein de leur
propre famille, ne se créaient pas de nouveaux alliés.
L’Égypte était l'une de ces sociétés du pourtour méditerranéen qui n'avaient pas encore été exposées
à l'influence et aux pressions du christianisme ni de l'islam. Or, dans toutes ces sociétés, et même à
Rome 87, les mariages avec des parents proches, des cousins ou cousines « germains » du côté
paternel ou maternel, étaient pratiqués. Un Athénien pouvait épouser sa demi-soeur agnatique, mais
pas sa demi-soeur utérine. Un Spartiate pouvait épouser l'une et l'autre de ces demi-soeurs. A Sparte,
plusieurs frères pouvaient épouser la même femme et se partager entre eux ses enfants (polygamie
adelphique). Mais Athénien et Spartiate ne pouvaient épouser une ascendante directe (mère, grand-
mère) ou une descendante directe (fille, petite-fille) ni une vraie soeur 88. À Athènes encore, quand un
homme décédait en laissant derrière lui une fille, mais pas de fils, le frère de cet homme épousait
sa nièce orpheline, tout ceci sous l'autorité et le contrôle des archontes de la cité qui veillaient à ce que
les « maisons » (oikoi) des citoyens athéniens ne s'éteignent pas faute de descendants, et autorisaient
ou imposaient ces mariages épiclériques 89.
Bref, en nous rendant en Égypte, nous entrons dans un monde aux antipodes de la parenté
chrétienne, qui a multiplié les degrés de parenté par le sang ou par alliance interdisant le mariage et
obligeant les gens à se marier très loin de soi (en termes de distance généalogique). Or, plus nous
observons le inonde méditerranéen antique, à l'exception de Rome, plus il apparaît que le nombre des
prohibitions matrimoniales envers les proches diminue. Tout se passe comme si les individus et les
groupes de parenté (familles, genos, etc.) avaient en permanence pratiqué une double stratégie, se
marier au plus près et se marier au loin, cumulant ainsi le double avantage de renforcer ce qui est déjà
acquis en ne le divisant pas et d'ajouter à l'acquis les bénéfices de nouvelles alliances. Cette double
politique est d'ailleurs toujours pratiquée aujourd'hui dans les sociétés islamisées où prévaut la loi
coranique. L'union préférée est alors celle avec la fille du frère du père, la cousine parallèle patrilatérale,
sans d'ailleurs que les autres cousines, du côté du père ou du côté de la mère, soient interdites
90
. Et
puisqu'un musulman a le droit d'épouser quatre femmes, il peut, lors de son deuxième ou troisième
mariage, se tourner vers des groupes de plus en plus distants du sien — et même vers des étrangers.
Quoi qu'il en soit, dès le XIXè siècle, l'existence, dans de nombreuses sociétés antiques ou
comtemporaines, de formules de mariages proches inconnues ou interdites en Occident avait fait
l'objet d'un inventaire remarquable par Alfred Henry Huth 91, qui s'appuyait sur des travaux plus
anciens de Wilkinson (1837) et de W. Adam (1865). Déjà les Égyptiens et les Iraniens tenaient la
vedette 92. En France, la discussion sur les mariages à des degrés très rapprochés ne devait s'ouvrir que
très tardivement tant pesa, pendant quarante ans, la thèse de Lévi-Strauss selon laquelle la parenté
est fondamentalement alliance et l'alliance pour se faire impose à un frère et à une soeur de
renoncer à s'unir sexuellement et à s'épouser 93.
Considérons donc l'Égypte, en cette époque tardive de son histoire, après la période hellénique (332
à 31 av. J.-C.), une Égypte qui sera ensuite intégrée dans l'Empire romain et administrée par un
gouverneur romain (31 av. J.-C. - 25 ap. J.-C.). Tous les quatorze ans, l'administration romaine
procédait à un recensement des familles de la totalité de la population afin de fixer l'assiette de l'impôt.
Or, l'analyse de ces recensements par Keith Hopkins montre que, à l'évidence, le mariage entre frère
et soeur était largement répandu dans toutes les couches de la société égyptienne, y compris parmi les
Grecs établis en Égypte. On évalue en effet à environ 15 à 20 % le nombre des mariages entre

frères et soeurs et entre demi-germains de même père ou de même mère. Comme, à partir du IIè siècle
ap. J.-C., les personnes recensées devaient délivrer les noms de leurs ascendants, parents et grands-
parents, on constate sans difficulté l'existence de mariages frère-soeur qui se répètent sur deux — ou
même trois — générations successives.
Rappelons que le statut de la femme en Égypte à toutes les époques, pharaonique, hellénistique et
romaine, était exceptionnellement élevé par rapport aux sociétés voisines. Un hymne à Isis, dont le
culte continuait à l'époque romaine, proclamait d'ailleurs : « Tu as fait du pouvoir des femmes l'égal de
celui des hommes. »
Les femmes
94
possédaient en propre des biens, elles étaient dotées à leur mariage, elles pouvaient vendre
ou acheter librement et accomplir toutes sortes d'actes juridiques. Elles avaient aussi le droit de disposer
de la vie de leurs enfants à leur naissance. Quand un frère et une soeur se mariaient, un contrat de
mariage était établi en bonne et due forme, et quand ils divorçaient, chacun reprenait ses biens (qu'il
avait d'ailleurs gérés séparément au cours de leur vie commune). Cette situation n'était pas nouvelle,
puisqu'un millénaire plus tôt, à l'époque du Nouvel Empire pharaonique, la femme égyptienne
jouissait déjà des mêmes droits. Dernier point à souligner : les documents abondent qui attestent de
l'amour, voire de la passion qui pouvait porter l'un vers l'autre et les unir dans le mariage un frère et
une soeur. L'amour entre frère et soeur représentait même l'idéal de l'amour charnel et de la passion. En
témoigne cette formule d'un charme destiné à susciter l'amour :
Conduis-la vers moi... fais naître mon amour dans son coeur et le sien dans le mien, comme entre un
frère et une soeur, je veux être le père de ses enfants 95.
Finalement, le mariage frère-soeur apparaît comme le mariage idéal pour les Égyptiens et,
comme l'écrit avec humour Keith Hopkins : « Rien ne permet d'imaginer qu'une soeur épousant, en
Égypte, son frère pensait faire une chose extraordinaire 96. » Sans jouer sur les mots, un frère et une soeur,
en s'unissant, accomplissaient un acte tout à fait « normal » dans leur société mais réalisaient du
même coup le mariage idéal, celui-là même qu'avaient toujours pratiqué les pharaons qui épousaient
leurs soeurs pour reproduire sur cette terre l'union divine dont étaient issus leurs ancêtres, celle d'Isis
et d'Osiris, à la fois frère et soeur et époux et épouse. Un hymne sacré du IVe siècle av. J.-C. célèbre
ainsi leur union :
« Ô Grand Taureau, Seigneur de la Passion, Couchez avec votre soeur Isis,
Ôtez la peine qui est en [son corps]
Et qu'elle puisse vous enlacer
97
. »
Les pharaons, à la différence de leurs sujets chez lesquels la polygynie, sans être interdite, était
inhabituelle, pouvaient avoir plusieurs épouses et des concubines, mais la « grande épouse », la
reine, était la plupart du temps une soeur du pharaon, parfois aussi une étrangère de haut statut. Les
alliances proches n'excluaient donc pas les alliances lointaines. Elles se complétaient. Mais la soeur
était choisie parce que, « héritant au même degré et à proportion égale de la chair et du sang du
Soleil [elle] était la mieux qualifiée pour partager le lit et le trône de son frère 98 ».
Bref, en matière de « cumul de l'identique », les Égyptiens étaient passés maîtres et aucune
menace de catastrophe cosmique ou sociale n'était attachée à cette union entre germains, considérée
par nous, Occidentaux, parmi les plus gravement incestueuses. Mais d'autres peuples d'Orient auraient
été encore plus loin, et auraient franchi les derniers degrés du mariage rapproché en autorisant non
seulement le mariage entre un frère et une soeur, mais aussi entre un père et sa fille, et enfin,
dernière des « abominations », l'union d'un fils avec sa mère. C'est ce dont Euripide accusait les
Perses, les plus grands ennemis des Grecs qui les considéraient comme des barbares
99
, mais les
redoutaient.
En 212 ap. J.-C., l'empereur Caracalla conféra la citoyenneté romaine aux Égyptiens et aux autres
peuples de l'Empire. Devenus citoyens romains, les Égyptiens se virent interdire, sous peine de
confiscation de leurs biens, de pratiquer leurs coutumes : « Des Romains ne peuvent épouser leurs
soeurs ou leurs tantes. » Après la conversion de l'empereur Constantin au christianisme en 312, la loi
romaine fut redoublée par les dogmes chrétiens. Les mariages frères-soeurs furent désormais classés
au-delà des choses concevables, et « exclus de la mémoire populaire ». Rome et le christianisme
en avaient triomphé. Mais un papyrus du VIIè siècle détaillant un contrat de mariage chrétien
rappelle que la fiancée doit être « vierge et ni la fille du frère, ni la fille de la soeur, ni la soeur du
père, ni la soeur de la mère ». L'Occident chrétien avait gagné, mais pour peu de temps, puisque
l'Égypte allait bientôt se retrouver conquise par l'Islam.

En Iran, les mariages xwêtôdas entre consanguins les plus proches, bien loin de disparaître sous l'effet
des sectes chrétiennes, furent restaurés et consolidés dès la fin du IIIè siècle lorsque le mazdéisme
triompha du manichéisme. Mais à partir du vile siècle et de la fin des Sassanides (224-650 av. J.-
C.), les « abominations » des Iraniens allaient, elles aussi, disparaître sous l'effet cette fois de l'islam.
Les documents les plus anciens qui témoignent des pratiques de mariage entre un frère et une ou deux
soeurs remontent à la période achéménide (550- 300 av. J.-C.), mais rien n'infirme l'idée que ces
pratiques aient pu exister auparavant et aient été aussi le fait d'autres couches de la population que les
dynasties royales, la noblesse et les prêtres. Quoi qu'il en soit, ces coutumes ont perduré sous les
Parthes (200 av. J.-C.-224 ap. J.-C.) et jusqu'à la fin de la période sassanide (650 ap. J.-C.).
Dès 1947, un anthropologue, J. C. Slotkin 101, attirait, dans l'American Anthropologist, l'attention de
ses collègues en publiant un article intitulé « On a possible lack of incest regulations in Old Iran ».
Deux ans plus tard, W. Goodenough crût, à tort, réfuter les conclusions de Slotkin, en affirmant que
les parsis, descendants des mazdéens réfugiés en Inde au Xè siècle, interprétaient ces unions non
comme celles entre frère et soeur mais entre cousins germains, et que lorsque les textes faisaient
vraiment référence à des unions entre frère et soeur, père et fille, etc., c'était pour renforcer les
convictions des populations auxquelles ces unions répugnaient.
Aujourd'hui, la documentation s'est enrichie, les traductions sont plus précises, et il ne fait plus de
doute que les unions xwêtôdas étaient pratiquées, et pas seulement au sein des familles royales
mais aussi dans d'autres couches de la population 1°3.
Tournons-nous d'abord vers la famille royale et la haute noblesse de la période achéménide.
Cambyse II, fils de Cyrus, deuxième roi de la dynastie achéménide, épousa deux de ses soeurs.
Artaxerxès II, fils de Darius II, épousa deux de ses filles. Enfin, cas très rare, Quinte-Curce, satrape
au temps de Darius III, épousa sa propre mère, dont il eut deux fils. Après la chute de l'Empire
achéménide, l'un des rois parthes du Ier siècle av. J.-C. épousa deux de ses soeurs. Plus tard, le
fondateur de la dynastie sassanide, Ardachis, épousa sa soeur germaine. Hors des familles
royales, les familles nobles pratiquaient également le mariage frère-soeur. C'est ainsi qu'au début
du vire siècle encore, un noble parent de la famille royale sassanide et adepte de la religion mazdéenne
épousa sa soeur, puis en divorça lors de sa conversion au christianisme.
Outre ces mariages au plus proche, d'autres formes de mariage étaient pratiquées avec, semble-t-
il, une préférence pour le mariage avec la fille du frère de la mère, la cousine croisée matrilatérale.
Nous nous retrouvons ici dans un monde connu, celui du mariage avec les cousins, avec cependant cette
particularité que le mariage avec la fille du frère de la mère était souvent associé au fait que les donneurs
d'épouses n'étaient pas en même temps preneurs parce que leur statut était supérieur à celui des
preneurs. Clarisse Herrenschmidt décrit le dilemme devant lequel se trouvaient les familles royales :
elles devaient à la fois affirmer que leur statut était supérieur et sans égal avec celui de la noblesse, et
en même temps consentir, par intérêt, à s'allier avec elle
104
. D'un autre côté, on comprend bien le désir
des familles aristocratiques de s'allier à la famille royale, aux nobles, de devenir gendre ou beau-
frère du roi. En témoigne le fait que les nobles qui avaient aidé Darius l
er
à prendre le pouvoir après
l'assassinat du frère de Cambyse, l'héritier légitime du trône, exigèrent qu'à l'avenir Darius épouse
des femmes issues de leurs lignées.
Mais les problèmes de statut et de stratégies de pouvoir ne sauraient expliquer la diffusion des unions
xwêtôdas dans les autres couches de la population, parmi les prêtres de la religion mazdéenne, que l'on
appelait les « mages », et le reste de la population, qui partageait ces croyances et ces rites. C'est là,
au coeur de ces croyances religieuses partagées par toutes les strates de la société, que gît probablement
la raison de la diffusion des unions xwêtôdas, et non pas seulement dans le désir du peuple d'imiter les
pratiques de ses maîtres. Résumons donc, à la suite de Clarisse Herrenschmidt, l'essentiel de la
cosmogonie et de la théologie mazdéennes, qui furent vivaces en Iran jusqu'au IX
e
siècle de notre ère,
sinon plus tard, sous le manteau de l'islam.
Les mariages xwêtôdas les plus parfaits sont ceux qui s'établissent « entre père et fille, fils et celle
qui l'a porté, frère et soeur ». Xwêtôdas est un mot de l'époque sassanide dérivé de l'iranien ancien
(avestique) xwaêtvadatha, qui signifiait mariage (vadatha) au sein des kwaêta (famille, lignage). Plusieurs
kwaêta formant un clan (probablement patrilinéaire), plusieurs clans une tribu. Donc, le mariage
parmi les siens (kwaê = sien) recouvre probablement à la fois le mariage avec les soeurs mais aussi
avec les filles des frères du père, les cousines parallèles patrilatérales. Mais du fait qu'on pouvait
épouser sa soeur, on pouvait peut-être aussi épouser les filles de la soeur de la mère.
Les mariages xwêtôdas sont doublement légitimés par la cosmogonie et la théologie mazdéennes pour les
517

raisons suivantes. D'abord, ils reproduisent les actes des divinités qui créèrent le monde. Ils garantissent le
paradis à ceux qui le contractent. Ils écartent ou tuent les démons et renforcent les puissances du Bien
dans l'univers. Ils sont une obligation pour les fidèles du mazdéisme. Ces mariages, en effet,
reproduisent les actes fondateurs du cosmos et de l'humanité, qui sont issus d'une triple union entre un
père et sa fille, un fils et sa mère, et entre les deux jumeaux qui furent le couple humain primordial. La
première union fut en effet celle d'Ohrmazd, maître du Ciel, et de sa fille, Spandarmat, la Terre. De
leur union naquit un fils, Gayomât, un géant qui s'accoupla avec sa mère, la Terre. De leur union
naquirent Mashya et Mashyani, les deux jumeaux qui s'unirent à leur tour dans le désir d'avoir un
fils. Tous les humains sont donc nés de ces trois xwêtôdas. Mais au départ, Mashya et Mashyani étaient
sexuellement indifférenciés, et c'est à l'âge de quinze ans que le souffle vital d'Ohrmazd les fit
différents pour qu'ils puissent s'unir l'un à l'autre et mêlent leurs semences. Or, les caractéristiqUes de
la semence féminine sont le froid, l'humide, le rouge, etc., celles de la semence masculine, le chaud, le
sec, le blanc, etc. Les os sont Féminins, le cerveau et la moelle épinière masculins, etc. De la bonne
proportion de l'eau (féminine) et du feu (masculin), la Puissance vient au cerveau, et la connaissance
naît de l'union (le l'intelligence intuitive (féminine) et de l'intelligence acquise (masculine).
On comprend à quel point était valorisé, aux yeux des Iraniens, le xwêtôdas entre frère et soeur. C'est
en effet l'union de deux êtres aux semences de force égale qui produit des êtres « remarquables en
l'équilibre des contraires ». Le fils né d'un xwêtôdas réalise en lui la plus exacte proportion des principes
féminins et masculins, il est un être armé pour combattre le Mal et propager le Bien. Pour les
mazdéens, l'intelligence innée est identique à la religion mazdéenne, qui est en fait présente à l'état inné
dans la nature de l'homme. Et à la limite, la religion mazdéenne s'identifie avec la « conscience » de
tout croyant dans le mazdéisme.
On aura compris que, bien loin d'être interdit aux yeux du commun et pratiqué seulement par une
élite, le mariage frère-soeur était, aux yeux des Iraniens anciens, l'union la plus valorisée, la plus
sacrée. Cette union ne pouvait être célébrée qu'avec l'aide d'un prêtre, d'un mage qui avait lui-même
contracté un mariage xwêtôdas. Et l'on comprend également que les références aux unions xwêtôdas
étaient présentes dans les grands rites saisonniers et les sacrifices qui reproduisaient chaque année
les différents moments de la création du monde, issu de l'union du père de tous les dieux et de tous
les humains, Ohrmazd, et de sa fille et épouse, Spandarmat, la Terre mère.
Nous sommes ici aux antipodes de la parenté chrétienne. Au lieu de prescrire l'union de deux
individus de sexe différent dans lesquels toutes traces de liens de consanguinité ou d'affinité
préexistants auraient disparu ou n'auraient jamais existé, les Iraniens prescrivent l'union entre les
deux consanguins les plus proches. Dans la parenté chrétienne, en s'unissant sexuellement, un homme
et une femme qui satisfont à tous les critères imposés par le christianisme pour se marier, n'en
transmettent pas moins, sans le vouloir et sans pouvoir l'éviter, la faute originelle commise par le
couple originaire dont est issue toute l'humanité, un couple qui n'était pas celui de jumeaux mais
fait d'un être, Adam, un être masculin, divisé en deux par la volonté de Dieu pour fabriquer Ève, la
première femme. À l'opposé, les anciens Iraniens faisaient de l'union d'un frère et d'une soeur le
mariage idéal, celui par lequel les humains prolongent et reproduisent la création divine de l'univers et
de l'humanité, un mariage qui, au lieu de les précipiter en enfer, était leur meilleure arme pour
combattre les démons et les faire accéder au paradis. Le mariage xwêtôdas, frère-soeur, était donc le
mariage idéal pour tous les humains. Les rois, eux, plus proches des dieux, pouvaient aussi y
ajouter les unions, rares et plus sacrées encore, entre un père et sa fille ou une mère et son fils,
réactivant les deux premières étapes de la création du monde.
Tirons de ces analyses quelques remarques théoriques de portée générale. Résumons. La plupart des
sociétés antiques du pourtour méditerranéen et du Proche-Orient combinaient deux principes, deux
stratégies pour assurer la continuité et le développement des groupes de parenté qui les composaient :
se marier au plus proche de soi, chez soi, ou s'unir à d'autres groupes plus ou moins distants de soi,
mais de statut équivalent ou, mieux encore, de statut supérieur. Des mariages entre un frère et une
demi-soeur, agnatique ou utérine, entre oncle et nièce, étaient courants, pour ne rien dire des unions
avec des parentes un peu moins proches, les filles du frère du père et d'autres sortes de cousines.
Parmi ces sociétés, les Égyptiens et les Iraniens sont allés plus loin encore dans la pratique des
mariages proches en autorisant et en privilégiant même les mariages entre frères et soeurs, et en Iran
entre frère et soeur, père et fille (très rares) et mère et fils (plus rares encore). Mais même dans ces
sociétés les mariages avec des parents lointains ou des non-parents ont toujours existé et constituaient
519

probablement la majorité des unions.
La première remarque à portée théorique que l'on peut faire est que les mariages entre frère et soeur
n'empêchaient pas de nouer des alliances avec des non-parents ou des parents lointains. Les familles
gardaient une partie de leurs femmes (filles) pour elles-mêmes et nouaient des alliances avec les autres.
Mais que devient alors la thèse de Lévi-Strauss ?
Lévi-Strauss nous dit que la parenté est fondamentalement alliance, et que cette alliance implique
l'échange des femmes entre les familles qui s'unissent et a pour condition universelle l’imposition du
tabou de l'inceste sur les unions entre frères et sueurs au sein de chaque famille. Or, les Égyptiens,
pour qui ces unions n'étaient pas interdites mais favorisées, nous démontrent que l'on pouvait
se marier sans échange (le mariage d'un fils et d'une fille), et par ailleurs que l'on pouvait pratiquer des
échanges en l'absence du tabou de l'inceste sur les unions entre frères et sœurs. Bref, l’hypothèse
théorique de Lévi-Strauss n’est pas universellement vérifiée.
(Maurice Godelier : Métamorphoses de la parenté » - Champs Flammarion – 2010 - p 510 à 519)
1
/
5
100%