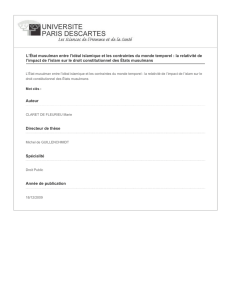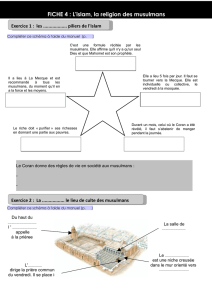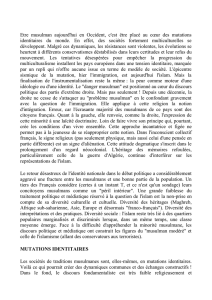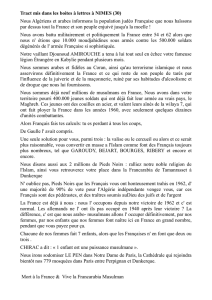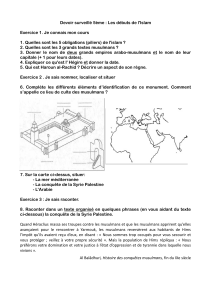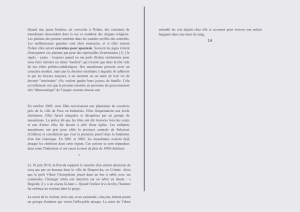Dossier - Canalblog

1
Carré Musulman
de
Saint-Etienne
Dossier réalisé par
Nadim Ghodbane
Claire Chevrier
Septembre 2005
Association Familiale Stéphanoise pour la Réhabilitation Du Carré Musulman
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
A. F. S. R. C. M.
25, Rue Descours 42000 Saint-Etienne
Tel : 06 10 84 79 40

2
Sommaire :
Partie A – Présentation
- Le contexte
- Pénurie de cimetières musulmans
- Les institutions
- Recensement des carrés musulmans en France
- Rappels de textes officiels
Partie B – Etat actuel
- Les concessions en Septembre 2005 depuis 1955
- Surface et densité
Partie C – Projections pour l’avenir
- Analyse des données : tendances et projections
pour les dix ans à venir
- Hypothèse 1
- Hypothèse 2
- Hypothèse 3
Partie D – Propositions concrètes
- Un carré dans plusieurs cimetières de Saint Etienne
- Cimetière intercommunal et nouvelles tendances
Partie E – Conclusion
Annexes
Carré Musulman de Saint Etienne
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
19
20
21

3
PRESENTATION

4
Le contexte
On estime à un peu plus de 10 à 11 millions(*) le nombre de musulmans vivant dans l'Union
européenne.
La France , avec près de 4 millions de personnes concernées, abrite la première population
musulmane en Europe et celle-ci revendique désormais sa pleine intégration dans l'espace
national.
Ce nombre ne tient pas compte des différents degrés d'adhésion religieuse.
La modernité, dans la mesure même où elle déstabilise les grands codes de sens qui
fournissent aux individus des réponses aux questions ultimes de leur existence, fait surgir en
même temps des demandes nouvelles de certitudes partagées.
L'instabilité propre à des sociétés soumises à l'impératif du changement suscite des
réaffirmations identitaires, à travers lesquelles les individus tentent de faire face à la condition
sociale et psychologique incertaine à laquelle ce changement les assigne.
Le recours identitaire à l'islam des jeunes générations trouve ici sa principale explication.
La présence de l'islam n'est pas en tant que telle une réalité nouvelle, il n'est pas nécessaire de
rappeler l'importance du fait musulman dans la France coloniale ni l'implantation ancienne de
populations immigrées en provenance des pays d'islam sur le territoire métropolitain. Mais la
situation s'est profondément transformée au cours des trente dernières années, en même
temps que la condition des immigrés venus du Maghreb pour travailler en France. La
sédentarisation définitive des familles dans le pays d'accueil et l'arrivée à l'âge adulte de
générations musulmanes nées en France et, couramment, de titulaires de la nationalité
française contribuent à l'établissement durable d'un islam de diaspora, pour lequel la
perspective d'un retour au pays d'origine a perdu toute plausibilité concrète.
La revendication que des carrés musulmans soient aménagés dans les cimetières s'affirme
avec une force d'autant plus grande que l'intégration économique, sociale et culturelle se
révèle plus difficile pour les intéressés et particulièrement pour les jeunes.
Pendant longtemps la vie d'un immigré en France fut considérée comme «provisoire » (Sayad :
1980). Ainsi, une des caractéristiques essentielles de l'immigration en France est de s'être
longtemps perçue comme une quasi migration saisonnière, alors même que l'installation des
familles, avec le regroupement familial, modifiait les conditions du projet initial.
La retraite, la mort sont deux nouvelles donnes de la modification du projet migratoire de
l'immigration, elles résument le cheminement de l'émigré-immigré.
La demande de cimetières séparés n'est pas une volonté d'isolement par rapport à la société
d'accueil, mais un désir d'y être intégré, avec son identité propre. Le mouvement de visibilité
religieuse actuel révèle une volonté d'organiser sa vie ici, en refusant de s'y sentir éternellement
étranger.
D'ailleurs, la réapparition de revendications de type religieux ne signifie pas forcément
une crispation sur une identité passéiste. Au contraire, la volonté d'insertion
s'accompagne, nous l'avons vu, d'une réaffirmation d'une identité propre. Bien que ce
double mouvement puisse paraître paradoxal, il ne l'est pas forcément : c'est au moment où l'on
se rend compte qu'on est en train de s'intégrer que des velléités d'affirmation identitaire
réapparaissent, comme si, maintenant qu'on était suffisamment intégré pour être accepté et
aussi pour se défendre, on se permettait de réaffirmer ce qu'on avait préféré cacher au moment
où l'on se sentait si différent. Cette réaffirmation n'est d'ailleurs la plupart du temps pas un
simple retour aux sources, mais recomposition.

5
Pénurie de cimetières musulmans
A l'heure où l'on essaye d'organiser les instances de l'islam en France, la question de
l'inhumation semble primordiale en terme d'intégration et d'enracinement. A l'heure où les
premières générations d'immigrés vieillissent et sont confrontées à la mort, il apparaît que rien
n'est prévu pour créer un nombre suffisant de cimetières musulmans et enraciner définitivement
les immigrés sur le sol français. Si le droit musulman prévoit l'enterrement du mort là où il
meurt, certains musulmans réalisent que la France ne leur accorde que des possibilités limitées
de s'y faire enterrer selon leurs normes. Et bien que l'islam soit la deuxième religion de France
avec ces 4 millions de musulmans dont plus de la moitié sont français, on ne compte qu'un seul
cimetière musulman, celui de Bobigny, ouvert par décret présidentiel en 1934. Au fil des
années, les places se font rares ; certains accommodements ont toutefois permis la constitution
de carrés confessionnels dans les cimetières communaux, bien qu'une loi de 1885 fasse des
cimetières des espaces à la fois publics et laïques dans lesquels tout regroupement par
confession sous la forme d'une séparation matérielle du reste du cimetière est en théorie
interdite. A partir de 1991, une circulaire adressée aux préfets préconise la création de ces
«carrés» confessionnels. La circulaire stipule qu'il revient aux maires de décider du
«regroupement, dans les cimetières communaux, des sépultures de défunts de confession
musulmane». Cette idée n'est pas neuve, puisqu'elle reprend les termes d'une circulaire de
1975, rarement appliquée, qui prévoyait déjà de regrouper les sépultures de Français
musulmans. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des cimetières islamiques mais des lopins
de terrain réservés aux inhumations des populations de confession musulmane, juive,
bouddhiste...
La circulaire de 1991 étend désormais son champ d'application «aux personnes de nationalité
étrangère souhaitant que leurs défunts soient inhumés sur le sol de la société d'accueil». Les
musulmans pourront ainsi, selon la tradition coranique, se faire enterrer la tête tournée vers La
Mecque, puisque «l'orientation des tombes dans une direction déterminée» est autorisée par la
circulaire. Néanmoins, contrairement aux pratiques courantes dans les pays musulmans,
«l'inhumation directement en pleine terre et sans cercueil ne pourra être acceptée» (pour des
raisons d'hygiène).
Pour ce qui est de l'inhumation sur le sol français, le seul obstacle à l'application du rite
musulman est qu'elle ne respecte pas le repos perpétuel des défunts. Comme la mise en terre
en direction de La Mecque, il est de la liberté de chacun de faire effectuer la toilette du mort par
un imam selon le rite, de même que la prière sur le mort qui ne pose aucun problème quant à
son application. Enfin, enterrer le corps à même le sol en islam a pour but d'assurer une
dégradation rapide du corps, qui doit ensuite se mélanger à la terre, dans une perspective de
retour au lieu d'origine, ou encore de processus le plus naturel possible ; mais il est également
considéré que le corps ne doit pas être écrasé par la terre, de peur qu'il ne soit endommagé.
C'est pourquoi les musulmans le protègent d'une dalle. Compte tenu de cela, le cercueil
n'apparaît plus trop étranger au rituel islamique et peut être compris comme une étape dans
cette protection du corps. Rapatrier les défunts dans les pays d'origine représente un certain
coût. La solution est l'ouverture de cimetières musulmans régionaux, voire
départementaux, territoires d'enracinement qui réunissent les familles musulmanes de
France et créeraient une mémoire collective pour les générations à venir.
Certes, la volonté de rassembler les tombes musulmanes d'une part, l'exigence de perpétuité
d'autre part, sont des motivations religieuses, mais il y en a d'autres, culturelles et
sociopolitiques. Le fait même qu'une partie de plus en plus large de la population
musulmane s'intéresse à une solution sur le sol français peut signifier une «intégration
réelle».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%