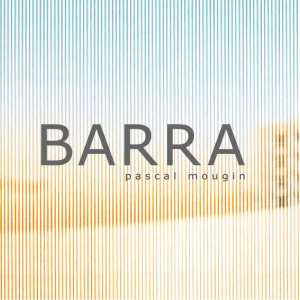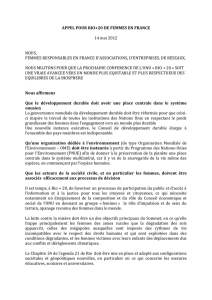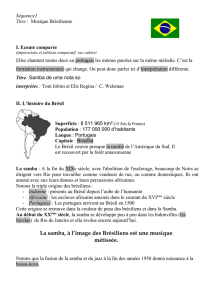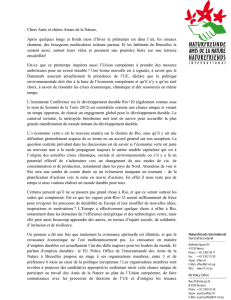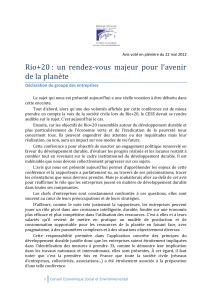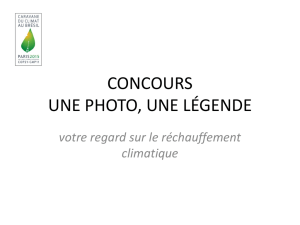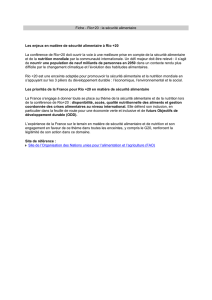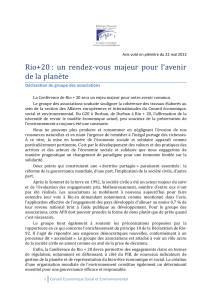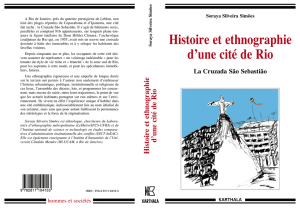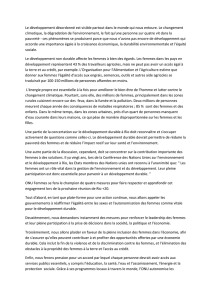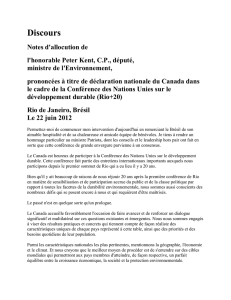L`espace musical en départage. Haut-lieux de

Titre : L’espace musical en départage. Haut-lieux de musique à Rio de Janeiro.
Acronyme : RIO
JOUVE-VILLARD Laura
Doctorante en Musique, Histoire et Sociétés
sous la direction de Denis Laborde, ethnologue.
EHESS
Laboratoire de rattachement : Centre Georg Simmel
Mots-clefs : Rio de Janeiro, espace de musique, quartier, haut-lieu, ville, samba des racines,
carnaval, Praça Onze, Pedra do Sal.
Discipline : Anthropologie de la musique
Qui s’est déjà rendu à Rio de Janeiro a presque inévitablement déjà emprunté l’Avenida Presidente
Vargas, un des axes routiers les plus importants de la ville, traversant la zone portuaire d’Est en Ouest,
marquant une limite symbolique entre la Zone Sud de Rio et ses plages mondialement connues, et la
Zone Nord des favelas. Les embouteillages encombrant aux heures de pointe les quatre kilomètres de
longueur de cette Avenida offrent de fait aux automobilistes la possibilité d’observer de près les
différents sites et paysages urbains qu’elle traverse. C’est en général dans ces circonstances que l’on
remarque qu’à environ trois kilomètres du port, entre les quatre voies de circulation de vingt mètres
chacune, se trouve un étroit terreplein au gazon presque vert sur lequel a été érigée une statue
représentant le visage d’un homme noir : c’est Zumbi dos Palmares, un des chefs de guerre les plus
importants du royaume autonome des Palmares, fondé au XVIIe siècle par des esclaves insurgés dans
le Nord-Est du Brésil. Les monumentos Zumbi rendent hommage dans la plupart des grandes villes du
pays aux racines africaines de la nation brésilienne.
Stricto sensu, le terrain de recherche que je propose de soumettre à une approche réflexive lors du
colloque « Espaces en partage », c'est ce terre-plein au milieu d’un axe routier. Il s’agit de la dernière
marque del’existence physique d’un territoire ayant reçu dans les années 1870 le nom de Praça Onze
de Junho1
1
. A l’exact emplacement de ce carré de gazon se trouvait donc une place publique qui
n’existe plus depuis le début des années 1940, mais qui depuis lors, a acquis une place d’honneur dans
la mémoire culturelle de la ville de Rio de Janeiro. En effet, dès le tournant du XXe siècle, les
nombreuses familles qui habitaient dans les quartiers pauvres de la zone portuaire se retrouvaient en
grande liesse sur cette place, costumés, chantant et dansant dans le sillon des chars décorés qu’ils
avaient construits l’année durant pour les fêtes de la semaine du mardi-gras. C’est ainsi dans le
quartier entourant la Praça Onze que l’on date les premières occurrences de ce qui allait devenir au
cours de la première moitié du XXe siècle le fameux carnaval de Rio de Janeiro.
La Praça Onze a été détruite en 1942 pour l’ouverture de l’Avenida Presidente Vargas, il n’en reste
aujourd’hui plus qu’un morceau, un terre-plein au milieu de quatre voies routières. Son nom désigne
un quartier non-administratif et aux limites indécises, et d’autre part, un espace mythique occupant une
place de choix dans le Panthéon des haut-lieux de la musique carioca. Mon entrée en « terrain de
recherche » s'est ainsi faite par la porte de cette entité linguistique charriant avec elle un fort
imaginaire culturel local. Tout l'enjeu de mon travail a été de porter mon attention non pas à un
territoire aux limites fixes ou mêmes administrativement fixées (comme un quartier, un district ou une
région), mais à des occurrences diverses faisant exister un lieu, un quartier, un terre-plein ou la
reconstruction d'une place publique à l'occasion du carnaval en tant que Praça-Onze-berceau de la
samba et du carnaval cariocas.
1
11 juin 1865, date de la bataille du Riachuelo opposant la Triple Alliance Brésil-Argentine-Uruguay au
Paraguay, considérée comme un des plus grands affrontements militaires de la Guerre du Paraguay, 1864-1870.

Mais voilà qu'au cours de l'année 2012, j'apprend par l'intermédiaire d'un nombre grandissant de
reportages écrits et audiovisuels diffusés au Brésil et à l'étranger, que le berceau de la samba carioca
n'est plus la Praça Onze, mais un rocher, situé en bordure du port et au pied, la Pedra do Sal.
Enregistrée à la liste du patrimoine culturel de l'Etat de Rio depuis 1984 en tant que monument
historique et religieux, rappelant le passé esclavagiste de la ville ainsi que l'importance de l'héritage
culturel apporté par les africains dans la définitionde l'identité brésilienne, la Pedra do Sal est devenue
en l'espace de quelques mois un espace de référence dans le paysage du tourisme musical de la ville.
Quant à la Praça Onze, elle ne gardera dès lors qu'une partie de sa légitimité, celle du quartier du
carnaval qui reçoit aujourd'hui la grandiloquence des spectacles des écoles de samba, là où il y a un
siècle, défilaient les premières occurrences de ce qu'on appellera à partir des années 1930, le carnaval
de Rio de Janeiro.
Ce que je propose de retracer sous forme d'une communication lors du colloque du mois d'avril, c'est
l'histoire au temps court d'un espace musical en départage ; le processus de scission entre un territoire
qui serait celui du carnaval, et un territoire qui serait celui de la samba. La présentation de ce cas
d'étude sera la plus courte possible afin de laisser le temps à une mise en perspective sur les deux
questionnements suivants.
Premièrement, le constat qui sous-tend celui d'une géographie des espaces de la musique carioca
historique, comme celle que j'ai présentée succinctement dans ces lignes, c'est que la samba ne peut
pas être jouée partout. Si des quartiers, des lieux, des places publiques et des monuments historiques
lui sont affectés pour qu'elle puisse avoir lieu, tandis que d'autres ne parviennent pas à exister comme
des espaces de musique, c'est qu'il existe des « conditions de félicité » pour qu'un espace puisse être
investi de samba, et même de samba « authentique ». Je me placerai ici du point de vue des musiciens
et de leur musique enregistrée sur le terrain (qui sera diffusée pendant la communication) pour tenter
de comprendre en quoi un espace urbain peut-il déterminer la façon de jouer un répertoire dit de «
samba des racines ». Ce premier point sera l'occasion de dresser un bref aperçu de la façon dont les
sciences de la musique (musicologie, ethnomusicologie et anthropologie de la musique) pensent
l'espace urbain comme une donnée influente sur la matière musicale (et ce d'un point de vue autre
qu'acoustique).
Deuxièmement, une approche comparative de mes deux terrains de recherche – à savoir celui de la
Praça Onze et celui de la Pedra do Sal - autorise à se poser la question de ce qui distingue une
recherche sur un territoire « qui existe » sur une carte (un rocher) d'un autre qui « n'existe pas » (une
place publique détruite, ou un quartier « affectif »). Nous verrons que dans un cas comme dans l'autre,
si l'on choisit d'adopter une approche non pas strictement représentationnelle de l'espace, mais plutôt
une approche qui se place du point de vue des modes d'existence (Souriau, Latour) d'un lieu, d'un
quartier, d'un rocher, d'une place publique, la question de la matérialité ou de l'identification des
contours de cet espace ne se posent plus ; en tout cas, elle ne se pose plus en termes de difficultés à la
définition d'un « terrain ». Cette accroche au terrain par les acteurs qui le disent et (donc) qui le font
pose enfin la question traversant l'ensemble du colloque de l'avenir des frontières disciplinaires. Elle se
pose aussi dans le cas des disciplines dites « de l'espace » et de celles qui s'intéresse à la musique,
science du temps et du diffus.
AUTHIER J-Y, BACQUÉ M-H et GUÉRIN-PACE F, Le Quartier. Enjeux scientifiques, actions politiques et
pratiques sociales. La Découverte, 2007.
DESROCHES Monique (et al.) Territoires musicaux mis en scène. PU de Montréal, 2011.
GOFFMAN Ervin. Les rites d’interaction. Les Editions de Minuit, Paris, 1974.
GOODMAN Nelson, Manières de faires des mondes. Folio Essais, Paris, 2006
GUIU Claire, 2006, « Géographie et musiques : état des lieux », Géographie et cultures, n°59, pp. 7-27.
LABORDE, Denis. La Mémoire et l’Instant. Les improvisations chantées du bertsulari basque, Bayonne, Elkar,
2005
LABORDE, Denis. Identifier, enquêter, analyser, conserver : Tout un monde de musiques, Paris, L’Harmattan,
1996.
LABORDE, Denis. « A etnomusicologia serve ainda para alguma coisa ? » Musica em contexto. Brasilia, 2008,
n°1
LATOUR, Bruno et HERMANT, Emilie. Paris Ville Invisible. La Découverte, 2007
LATOUR, Bruno. Enquête sur les modes d'existence : une anthropologie des Modernes, La Découverte, 2012.

MONDADA Lorenza. Décrire la Ville. Ed.Collection Villes, Paris, 2000.
NETTL Bruno. The Study of Ethnomusicology: Thirty-one Issues and Concepts, 2nd Edition. University of
Illinois,
2005.
RECANATI, François. Les énoncés performatifs. Les Editions de Minuit, Paris, 1982.
STOKES Martin, Ethnicity, Identity and Music. The Musical Construction of Place. Oxford/Providence : Berg,
1994.
1
/
3
100%