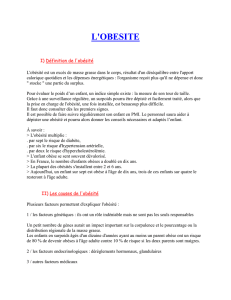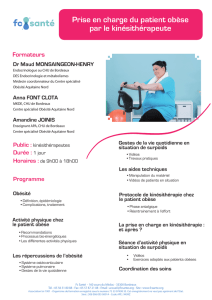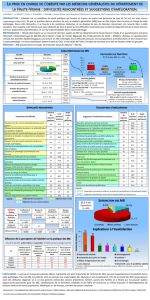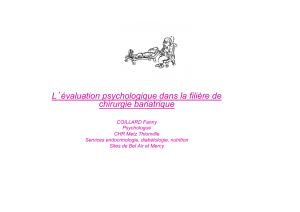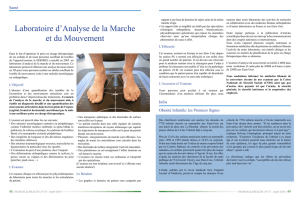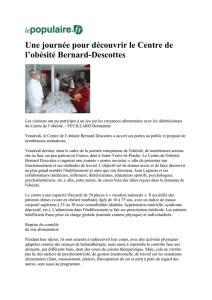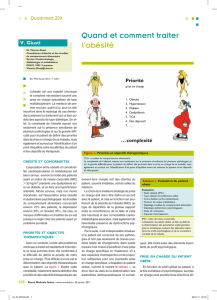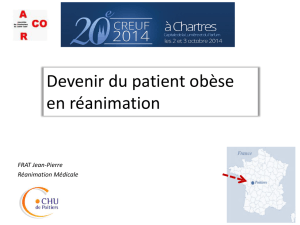Anesthésie du patient obèse

Anesthésie du patient obèse
J.E. Bazin, J.M. Constantin, G. Gindre, C. Frey
Département d'anesthésie-réanimation, Hôtel-Dieu, centre hospitalier universitaire,
BP 69, 63003 Clermont-Ferrand cedex, France
e-mail : jebazin@chu-clermont-ferrand.fr
POINTS ESSENTIELS
· L'obésité est définie par un indice de masse corporelle (poids/taille2) supérieur à 30 et est
morbide au-dessus de 40.
· L'évaluation préopératoire apprécie le retentissement cardiovasculaire et respiratoire. Les
difficultés de ventilation au masque et d'intubation doivent être dépistées. Le risque
anesthésique est évalué et annoncé.
· L'obésité entraîne des perturbations du volume de distribution, de la fixation protéique et de
l'élimination de nombreux médicaments.
· Le patient obèse doit être placé en position proclive. Le matériel et l'environnement doivent
être adaptés.
· L'ALR réduit les risques liés à l'intubation difficile, à l'inhalation du contenu gastrique et
aux modifications pharmacologiques. L'association ALR et anesthésie générale semble
judicieuse pour les interventions abdominales et thoraciques. La réalisation d'une anesthésie
locorégionale est parfois difficile.
· Une préoxygénation soigneuse précède l'induction à séquence rapide. La présence de deux
personnes compétentes est recommandée.
· Les agents anesthésiques de cinétique rapide sont les mieux adaptés pour l'entretien
permettant un réveil rapide facilitant la mobilisation.
· La ventilation contrôlée est un compromis entre oxygénation, capnie, débit cardiaque et
PEP. La ventilation spontanée est formellement contre-indiquée.
· Les techniques de laparoscopie semblent relativement bien supportées chez l'obèse et leur
bénéfice postopératoire est important.
· En période postopératoire, l'incidence des thromboses veineuses est plus importante et doit
être prévenue, une analgésie postopératoire est impérative permettant mobilisation et
kinésithérapie.
La prévalence de l'obésité augmente continuellement dans tous les continents et s'accompagne
de l'émergence de nombreux problèmes médicaux et chirurgicaux spécifiques [1]. Par
conséquent, les anesthésistes se trouvent de plus en plus fréquemment confrontés au véritable

challenge de la prise en charge périopératoire de patients obèses [2]. Une compréhension de la
physiopathologie et des complications de ce groupe particulier de patients permet un
traitement plus efficace et sûr.
ÉPIDÉMIOLOGIE
Définitions
L'obésité correspond à une présence excessive de graisse dans l'organisme. Le terme est
dérivé du latin « obesus » qui veut dire engraissé. La distinction entre l'obésité et la normalité
est arbitraire, on peut considérer que, pour un individu donné, l'obésité correspond à une
augmentation de sa masse grasse suffisante pour affecter son état de santé physique et mental
et pour réduire son espérance de vie [3]. Dans les sociétés occidentales, la matière grasse
représente chez l'homme moyen 20 à 25 % du poids du corps et 20 à 30 % chez la femme.
Cette quantité de graisse n'est que de 10 à 12 % chez un footballeur professionnel et de 7 %
chez un marathonien. On considère fréquemment qu'il existe une obésité lorsque la matière
grasse dépasse 25 % chez l'homme et 30 % chez la femme [4]. La graisse corporelle peut être
estimée par la mesure du pli cutané tricipital, et plus précisément par impédancemétrie ou par
résonance magnétique. En fait, généralement, cette approximation est réalisée en rapportant le
poids à la taille et en le comparant à un poids dit idéal. La notion de poids idéal, introduite par
les sociétés d'assurance vie, correspond au poids associé au plus faible taux de mortalité pour
une taille et un sexe donné. Le calcul du poids idéal (en kg), grâce aux formules de Lorentz
plus ou moins simplifiées, est égal à la taille du patient en cm moins 100 chez l'homme, et
moins 105 chez la femme. De plus, en plus en clinique et en épidémiologie, l'obésité est
quantifiée par le calcul de l'indice de masse corporelle (IMC) ou indice de Quetelet. L'IMC
(ou BMI, body mass index chez les Anglo-Saxons) est un indice de poids simple, BMI = poids
en kg/taille au carré en mètre. Un BMI inférieur à 25 kg·m-2 est considéré comme normal ; un
BMI compris entre 25 et 30 kg·m-2 correspond à un excès de poids (pré-obésité) qui ne
s'accompagne pas de complications médicales graves, un BMI supérieur à 30 kg·m-2
correspond à une véritable obésité, enfin l'obésité morbide se définit comme un BMI > à 40,
la « super-morbidité » étant définie par un BMI > 55 kg·m-2 [5]. S'il existe une très étroite
corrélation entre BMI, morbidité et mortalité (pour les BMI > 30 kg·m-2), le BMI possède ses
limites : par exemple, un homme extrêmement musclé sera classé obèse. D'autres éléments
comme l'âge ou la répartition de la masse graisseuse sont aussi des éléments à prendre en
compte [3] [6]. Dans l'obésité de type androïde ou centrale, qui concerne surtout les hommes,
la graisse se concentre dans la partie supérieure du corps et au niveau des organes intra-
abdominaux. Dans l'obésité gynoïde ou périphérique, qui touche surtout les femmes, la masse
adipeuse est principalement localisée dans les hanches, les fesses et les cuisses [7]. L'adiposité
de type centrale, prédispose plus au risque de maladies métaboliques et d'ischémie
myocardique [6] [8].
Incidence
En 1997, une enquête internationale définissant l'obésité comme un BMI > 30 kg·m-2
retrouvait une prévalence de l'obésité en Europe de 15 à 20 %, avec de grandes variations en
fonction des régions [3]. En Grande-Bretagne, un adulte sur deux souffre actuellement de
surpoids et la prévalence de l'obésité a doublé entre 1980 et 1991, passant de 6 à 13 % chez
les hommes et de 8 à 15 % chez les femmes. La situation est approximativement la même en
France, elle est un peu plus favorable dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas avec une
prévalence de 10 % et pire dans les pays d'Europe de l'Est avec une prévalence de près de 50

% chez les femmes dans certains pays. On considère qu'en France, comme au Royaume-Uni
et en Allemagne, il y a environ 10 millions d'obèses avec un BMI > 30 kg·m-2. Aux États-
Unis, le nombre d'obèses est encore plus élevé que partout dans le monde avec une prévalence
de 55 % d'adultes des deux sexes confondus ayant un BMI > 25 kg·m-2 [6].
Étiologie
L'obésité est une maladie complexe et multifactorielle, mais, en résumé, il s'agit toujours d'un
déséquilibre sur une période prolongée de la balance énergétique [7]. Il existe cependant une
très grande inégalité interindividuelle liée à différents facteurs.
Facteurs génétiques
Il existe une tendance familiale à l'obésité et un enfant, dont les deux parents sont obèses, a 70
% de risque de développer à son tour une obésité, contre seulement 20 % si ses parents ne
sont pas obèses. Ceci pourrait être lié à des habitudes alimentaires, mais l'évolution d'enfants
adoptés (dont le profil morphologique correspond à celui de leurs parents naturels) prouve une
origine génétique à l'obésité. Ce facteur génétique a été prouvé expérimentalement par la mise
en évidence du gène ob codant pour la leptine chez la souris, l'insuffisance de leptine
conduisant à l'hyperphagie et à l'obésité [9]. Malheureusement, chez l'homme, les choses
semblent beaucoup plus complexes et l'augmentation importante de la prévalence de l'obésité
alors que le patrimoine génétique humain reste globalement stable rend compte de
l'importance d'autres facteurs.
Facteurs ethniques
Aux États-Unis par exemple, les populations d'origine africaine ou mexicaine sont plus
exposées à l'obésité que les populations d'origine asiatique [10].
Facteurs socio-économiques
Il existe, en particulier chez les femmes, une relation inverse entre le niveau socio-
économique et le risque d'obésité [11]. La prévalence de l'obésité varie avec les conditions
socio-économiques : dans les pays développés on retrouve une incidence plus élevée dans les
classes défavorisées alors que c'est l'inverse dans les pays en voie de développement.
Pathologies médicales
Certaines maladies endocriniennes (Cushing, hypothyroïdie...) ou thérapeutiques (corticoïdes,
antidépresseurs, antihistaminiques...) peuvent favoriser la prise de poids.
Balance énergétique
Les apports caloriques, notamment lipidiques jouent un rôle majeur dans l'obésité. La
consommation d'alcool semble aussi être déterminante. Contrairement à l'idée généralement
admise, la dépense énergétique est augmentée chez l'obèse. L'absence d'activité est souvent la
conséquence et pas nécessairement la cause de l'obésité. Enfin, il faut rappeler que l'excédent
calorique journalier peut être très modeste, par exemple une prise de poids de 20 kg sur 10 ans
ne correspond qu'à un excès quotidien de 30 à 40 kcal soit un demi-sandwich [1].
Mortalité

S'il n'est pas prouvé qu'un surpoids modéré soit un facteur de risque morbide, il est clairement
établi que le risque de morbidité et de mortalité augmente de façon majeure à partir d'un
indice de masse corporelle supérieur à 30 kg·m-2 [12]. Les patients obèses morbides ont plus
de risques de mourir des complications du diabète, de maladies cardiovasculaires, d'accidents
cérébraux méningés ou de cancers. Si une perte de poids permet de réduire ces risques, il n'a
jamais été prouvé qu'une perte de poids juste avant une intervention chirurgicale diminuait le
risque de mortalité périopératoire [3].
PHYSIOPATHOLOGIE DE L'OBÉSITÉ
ET IMPLICATIONS POUR L'ANESTHÉSIE
Troubles cardiovasculaires
La plupart des pathologies cardiaques liées à l'obésité résultent de l'adaptation
cardiovasculaire à l'excès de masse corporelle et à l'augmentation de la demande métabolique
[13] [14]. Ces pathologies dominent le pronostic vital de l'obèse. Une étude récente a montré
que la prévalence de toutes les pathologies cardiaques confondues était de 37 % chez les
adultes présentant un BMI > 30 kg·m-2, de 21 % pour un BMI de 25 à 30 kg·m-2 et seulement
de 10 % si le BMI est inférieur à 25 kg·m-2 [15].
De nombreux facteurs physiopathologiques sont à l'origine des troubles cardiovasculaires
chez l'obèse.
Augmentation de la volémie
Chez l'obèse, l'augmentation de la masse corporelle, des tissus adipeux et musculaires,
entraîne une élévation de la volémie [16], alors que le rapport volume sanguin et poids est
plus faible par rapport au sujet de poids normal (50 mL·kg-1 vs 75 mL·kg-1) [17]. L'activité
croissante du système rénine-angiotensine joue aussi un rôle dans l'augmentation de la
volémie [18]. La majeure partie de cette augmentation de volume est distribuée vers les
masses graisseuses, mais le débit sanguin splanchnique est aussi augmenté de 20 % alors que
les débits rénaux et cérébraux restent stables [19].
Augmentation du débit cardiaque
La demande métabolique et le débit cardiaque sont augmentés chez le patient obèse [20],
proportionnellement à la surcharge graisseuse : le débit cardiaque doit augmenter de 0,1
L·min-1 pour perfuser 1 kg supplémentaire de tissu adipeux. Pour un niveau de pression
artérielle donné, les résistances vasculaires systémiques sont diminuées [13] sans changement
du tonus sympathique [20]. L'augmentation de débit cardiaque pourrait aussi être expliquée
par une augmentation de la fréquence cardiaque [21].
Hypertension artérielle
L'hypertension artérielle est beaucoup plus fréquente dans la population obèse avec en
moyenne une augmentation de 3 mmHg par 10 kg de poids excédentaires. Cette hypertension
artérielle est en partie secondaire à l'augmentation de masse circulante et de débit cardiaque,
mais son mécanisme physiopathologique exact en est inconnu et fait probablement intervenir
des facteurs génétiques, hormonaux, rénaux et hémodynamiques. L'hyperinsulinisme pourrait
contribuer à cette hypertension par l'activation du système nerveux sympathique et la

rétention sodée qu'il induit. De plus, la résistance à l'insuline potentialise les effets
vasopresseurs de la noradrénaline et de l'angiotensine II [22]. L'hypertension artérielle va
entraîner une hypertrophie ventriculaire et une insuffisance cardiaque gauches [20]. Une perte
de poids s'accompagne d'une réduction de l'hypertension et de l'hypertrophie ventriculaire
gauche [23].
Ischémie myocardique
Dans la plupart des études, l'obésité est retrouvée comme un facteur majeur et indépendant de
risque coronarien et de mort subite [24] [25] [26]. Cette complication peut s'observer même
en l'absence d'hypertension, de troubles lipidiques, de diabète et de sédentarité. L'étude
Manitoba, qui a suivi 3 983 hommes pendant 26 ans, a montré une relation significative entre
obésité et mort subite, infarctus du myocarde ou insuffisance coronaire [27]. L'association
entre obésité et insuffisance coronaire est beaucoup plus fréquente en cas d'obésité de type
central [28]. L'association avec d'autres facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le
diabète, l'hypercholestérolémie, le niveau des HDL, majore le risque. Il faut noter que 40 %
des patients obèses présentant une angine de poitrine n'ont pas de pathologie coronarienne
identifiable, l'angine de poitrine serait donc un symptôme direct de l'obésité [15].
Troubles du rythme
Différents facteurs peuvent être à l'origine des troubles du rythme fréquents chez l'obèse : une
hypoxie, une hypercapnie, une hypokaliémie résultant d'un traitement diurétique, une
coronaropathie, une hypercatécholaminergie [29], un syndrome d'apnée obstructive du
sommeil, une hypertrophie myocardique [24], une infiltration graisseuse des voies de
conduction intracardiaque [30] [31]. L'arythmie et les troubles de conduction peuvent être à
l'origine d'une mort subite chez certains patients obèses [32].
Insuffisance cardiaque
L'insuffisance cardiaque du patient obèse n'est pas en rapport, comme cela a été longtemps
cru, avec une infiltration graisseuse myocardique. Des études autopsiques ont démontré que la
graisse ne se répartissait qu'au niveau du péricarde et du cœur droit où elle peut être
responsable des troubles du rythme et de conduction [3] [30]. Le cœur grossit de façon
proportionnelle au poids du corps jusqu'à 105 kg, au-delà, le poids du cœur continue à
augmenter mais plus lentement que le poids du corps [26]. Cette augmentation du poids du
cœur est essentiellement liée à l'hypertrophie concentrique de la paroi du ventricule gauche
[33]. Même si le patient obèse présente une augmentation de débit cardiaque, la fonction
systolique du ventricule gauche est altérée, essentiellement au cours de l'exercice, la fraction
d'éjection augmentant moins et plus lentement que chez les patients minces [3]. La
cardiomyopathie de l'obèse est due, dans un premier temps, à l'augmentation du volume
sanguin circulant et du débit cardiaque, celui-ci augmentant de 20 à 30 mL·kg-1 de graisse
supplémentaire. Il est ensuite aggravé par l'hypertension artérielle, l'insuffisance coronarienne
et la maladie respiratoire. La paroi du cœur étant hypertrophiée, sa compliance est moins
bonne s'accompagnant de l'augmentation des pressions de remplissage du ventricule gauche et
de risque d'œdème pulmonaire. L'adaptation à l'effort est mauvaise, l'augmentation du débit
cardiaque ne pouvant se faire que par augmentation de la fréquence, le volume d'éjection ne
pouvant plus s'adapter.
Implications pour l'anesthésie
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%