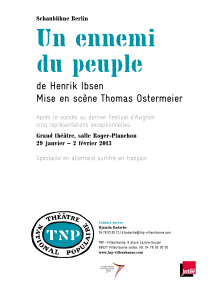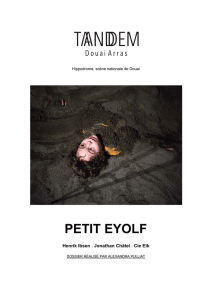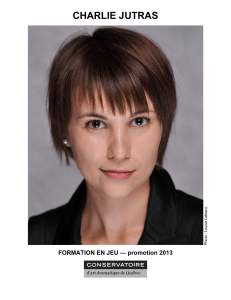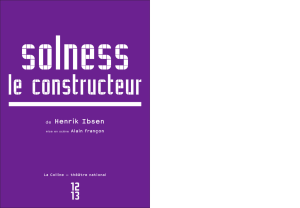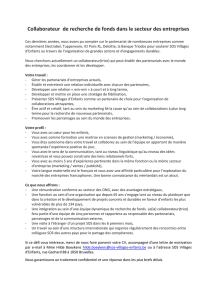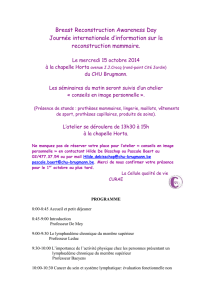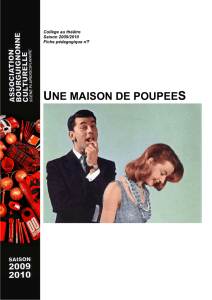ibsen - Compagnie Divine Comédie

ssssssssss
www.compagniedivinecomedie.com
COMPAGNIE
DIVINE
COMEDIE
73 rue du Champ des Oiseaux - 76000 Rouen
09 54 49 06 12 - 06 60 82 74 30 - compagniedivinecomed[email protected]
Solness,
Constructeur
Henrik Ibsen
Présentation
du spectacle
Projet
Pédagogique
SOLNESS Seul, on ne peut rien faire advenir d'aussi
grand. Non, - les aides et les serviteurs doivent y
participer si on veut obtenir un résultat. Mais les
aides et les serviteurs, ils ne viennent jamais d'eux-
mêmes. Il faut les appeler avec ténacité. En son for
intérieur, voyez-vous.
HILDE Et qui sont les aides et les serviteurs ?
SOLNESS Oh, nous en parlerons une autre fois.
Tenons-nous en à l'incendie.

Page 2
Equipe
Jean-Marie Winling, Halvard Solness
Eléonore Joncquez, Hilde Wengel
Hubertus Biermann, Knut Brovik, le docteur Erdal
Aline Solness, Ragnar Brovik, Kaja Fosli : distribution en cours
Mise en Scène Jean-Christophe Blondel
Scénographie Marguerite Rousseau
Costumes Tormod Lindgren
Création musicale en scène Hubertus Biermann (violoncelle)
Production
Compagnie Divine Comédie, La Plate-Forme des Producteurs
Normands (Le Préau CDR de Vire, La Comédie CDN de Caen, Les
Deux Rives CDR de Rouen, Le Trident SN de Cherbourg, Le Volcan
SN du Havre), le Quai des Arts - Argentan, dans le cadre des Relais
Culturel Régionaux, Subventions : DRAC Haute Normandie, Région
Haute Normandie, Département Seine Maritime, ville de Rouen.
Avec le soutien de CartT@too (CR Basse Normandie), de l’ODIA
Normandie, et du Festival des Boréales.
Planning 2012 2013
26 et 30 janvier 2012 : maquette à Lilas en Scène
14 et 15 avril 2012 : rendu d’atelier au TGP Saint-Denis
Mai 2012 : rendu d’atelier au lycée Marie Curie, Vire
Mi septembre à mi novembre 2012 : répétitions
Deuxième quinzaine de novembre 2012, puis avril 2013.
Tournée : Le Préau CDR de Vire, La Comédie CDN de
Caen, Les Deux Rives CDR de Rouen, Le Trident SN de
Cherbourg, Le Volcan SN du Havre, Quai des Arts –
Argentan, Théâtre de Lisieux, Théâtre de Saint-Lo, Archipel
de Granville, Théâtre de Gisors, Théâtre du Garde Chasse
des Lilas. Discussions avec le Théâtre de la Paillette
(Rennes) et le Théâtre Antoine Vitez (Aix en Provence).
Sommaire
L’œuvre en quelques lignes 3
Une lecture 4
Notes de mise en scène 7
L’équipe 8
Pistes d’actions artistiques 11
Anne Ubersfeld, à propos de notre extrait Solness/Hilde 14
Quelques extraits et citations 15

Page 3
L’œuvre en quelques lignes
Résumé
Solness : l’histoire d’un autodidacte, ancien employé dans un cabinet d’architecture, qui a
conquis le monopole du bâtiment dans sa région sur le cadavre de ses deux enfants et les
décombres du patrimoine incendié de sa femme. Ruinant puis exploitant son ancien patron,
jouant d’autorité ou de séduction, il a défendu bestialement son règne, tué dans l’œuf toute
concurrence, toute relève possible. Vieux fauve effrayé par la jeunesse et surtout par la
Mort, vieil artiste qui a cru pouvoir apporter le bonheur avec l’humanité de son architecture,
il contemple l’étendue des dégâts : un territoire conquis par le cancer de ses constructions,
une maison coupée en deux, hantée par une femme, Aline, omniprésente et passivement
tout contre lui, et le fantôme de deux enfants morts ; un idéal mort, un couple sans désir, et
un instinct de survie toujours là, sauvage, indestructible. C’est alors qu’arrive « la
jeunesse ». Hilde Wangel se présente, elle a quelque chose à réclamer. Dix ans plus tôt,
alors qu’il était ivre et qu’elle avait douze ans, Solness l’aurait embrassé… Il lui aurait
promis… un royaume. Elle vient, à l’heure dite, chercher son dû. Etre de chair ou production
hallucinatoire d’un fou ? Elle va s’installer au cœur de la vie du couple et travailler à bras-le-
corps l’âme malade du Constructeur
Autobiographie
Le Constructeur Solness est tout autant le portrait de son auteur, à la fois comme artiste et
comme homme politique. Ibsen, Norvégien né en 1828, issu de la classe moyenne, a
consacré sa jeunesse à la fois à remettre en cause le fonctionnement politique et
économique de la société de son temps, et à tenter de développer un art théâtral alors
inexistant dans son pays. Il quitte la Norvège en 1864 et développera son talent et son
succès en vivant dans différents pays d’Europe. Il ne retournera au pays que vingt-sept ans
plus tard, précédé d’un immense succès.
Sur le plan esthétique, Ibsen décrit un créateur qui lui ressemble : lui aussi connaît un plein
succès, mais en lui aussi, se développe cette peur de ne pouvoir dépasser ce qu’il a
construit (à ce moment, le naturalisme qu’il a porté au sommet est réinterrogé par la
génération suivante qui laisse éclore la subjectivité, l’autobiographie, la vision intérieure, le
symbolisme). Sur le plan politique, le capitalisme construit par la société bourgeoise, qu’il a
dénoncé dans ses œuvres, génère toujours plus d’exploitation et d’injustice : comme
Solness, Ibsen doute de la possibilité d’apporter un progrès par l’art. Enfin, sur le plan
existentiel, l’approche de la mort exacerbe la question « Kierkeggaardienne » posée trente
ans plus tôt dans Peer Gynt : que fait-on de notre vie ? Comment « être soi-même » ?

Page 4
C’est sur ces trois terrains, esthétique, philosophique et économique, que nous pouvons
construire un projet pédagogique en lycée, reliant systématiquement chaque point abordé à
la question pratique de sa transcription, sa représentation et son incarnation sur scène.
Une lecture
Un Faust
Solness réunit le portrait d’un entrepreneur sans scrupules et l’autoportrait d’un artiste qui a
« réussi ». Le moteur de sa vie était-il la quête spirituelle, et l’espoir d’apporter du bonheur
aux hommes, dont il parle au troisième acte ? Quelle est la part de la soif de puissance
dans cet élan ? Quoi qu’il en soit, lorsque le rideau se lève, l’œuvre derrière lui est jugée
vaine, inutile, fruit de chimères fatiguées. Ce regard sur la création déroulée derrière soi, on
le retrouve dans la successions des périodes de construction de Solness : les églises, les
maisons, le « château chimérique », qui correspondent aux grandes époques d’écriture
d’Ibsen, poèmes patriotiques et spirituels, drames bourgeois, et les œuvres « symbolistes »
à partir de Solness. Et la pièce elle-même est la synthèse du « merveilleux » de Peer Gynt,
du réalisme des drames bourgeois qui ont suivi, au service d’une aspiration nouvelle.
Solness déplie peu à peu, au fil des trois actes, sa perception d’un monde peuplé de Trolls,
de diables, d’esprits invisibles, qu’il aurait le pouvoir de guider, pour sa propre gloire et pour
le malheur de son entourage. Une théorie Faustienne à laquelle les évènements passés,
mais aussi les attitudes sur le moment, et jusqu’aux entrées en scène magiquement
« reliées » à la discussion en cours, semblent donner raison. Sa femme Aline pleure la
disparition de ses poupées, figures énigmatiques, voire effrayantes, qui semblent sorties
d’un conte d’Hoffman. Partout, le fantastique affleure sans que jamais le fil de la rationnalité
ne soit rompu. Partout, la présence d’un monde invisible, proche de l’inquiétante étrangeté
de Freud, menace de déborder la vie sociale et de tout faire basculer dans la folie.
Questions théologiques, politiques, psychanalytiques
Les personnages reviennent souvent à l’évocation d’une scène fondatrice : avant d’accéder
au succès en construisant des maisons, Solness est monté, en dépit de son vertige, au
sommet d’une tour d’église pour parler à Dieu. La scène est calquée sur la tentation du
Christ au sommet du temple, et on se demande : est-ce à Dieu qu’il a parlé comme il le dit,
ou est-ce le Diable ? Le succès est-il fruit du mérite, comme l’affirmaient les Protestants qui
fondèrent l’Amérique moderne et le capitalisme contemporain, ou fruit d’un pillage sans
scrupule des ressources ? Solness est rongé par une culpabilité que cachent mal les
idéologies de facade. Il incarne notre société bâtie sur l’exploitation, hier des colonies,
aujourd’hui d’ateliers qui fabriquent la mode et la technologie dont nous sommes obsédés.

Page 5
Il y a aussi cette angoisse d’être détrôné par ce qu’Ibsen appelle un « drapeau nouveau ».
Quand j’ai monté un extrait de la pièce en 2005, je ressentais surtout l’actualité personnelle
et française de cette problématique de la place qu’on laisse ou non à la génération qui vient.
Auourd’hui, je sens que cette peur est planétaire. Elle se ressent par exemple vis-à-vis de l’
Asie « étrangère », « conquérante », qui ressemble à ce jeune Ragnar qui veut la place de
Solness, avec la spécificité, la richesse culturelle d’une force nouvelle – mais aussi, le désir
caricatural et désespérant d’imiter, de perpétuer le vieux modèle. L’angoisse de Solness
d’être submergé résonne, je crois, avec notre inconscient collectif, elle reflète l’expression
d’un début de lucidité, un dégrisement, un sentiment d’immense vanité couvé par toute
notre société occidentale, l’ivresse de la course s’essoufflant avec la course elle-même.
Je crois ainsi pouvoir expliquer mon attraction pour les auteurs de la fin du XIXe et le début
du XXe par certaines similitudes entre nos époques. Comme nous, Maeterlinck, Ibsen ou
Claudel ont vécu un temps matérialiste de « foi » en la rationnalité, le commerce, le progrès
technique. Et comme beaucoup d’entre nous, ils ont éprouvé en réaction le besoin d’une
esthétique du mystère humain, d’œuvres profondes, non simplifiables, non élucidables,
mais stratifiées, foisonnantes, contradictoires comme la vie même. Même s’il se défend de
toute lien avec le symbolisme de Maeterlinck, Ibsen donne à entendre un monde primordial
et silencieux que les spectacles trop explicites, trop bruyamment socio-politiques par
exemple, ont du mal à laisser émerger. La pièce échappe à tout interprétation réductrice et
didactique parce qu’elle n’est pas seulement une construction raisonnée, mais aussi une
empreinte de son âme, un feuilletage de lancinantes questions philosophiques, politiques,
théologiques, intimement, organiquement reliées en lui. C’est peut-être cela, une œuvre
symboliste ? Une œuvre qui produit des signes issus non de la raison, mais de l’intimité
psychique. Qui s’appuie sur les mythes, leur ouverture, leur polysémie, pour établir un
dialogue silencieux entre cette intimité de l’auteur celle de chaque spectateur.
L’ivresse, sans la foi
A la différence du cinéma commercial, qui exploite souvent les mythes selon une vision
platonicienne du bien et du mal, Ibsen ne donne tort à personne. On aime à la fois la vitalité
de Solness faisant table rase pour construire l’avenir, et l’attachement d’Aline au passé
détruit. On adhère à la figure libératoire de Hilde, rebelle à l’éducation moraliste, incarnation
débridée des désirs de Solness, même si on constate la destruction que provoque son élan.
Chacun va droit à l’échec et à la mort, mais suscite l’empathie, laissant là le spectateur
vacant, avec ses questions ouvertes. L’œuvre n’apporte pas de réponse morale, mais tente
un équilibre élevé et périlleux entre lucidité et vitalité ivre. Réapprendre à conjurer l’ennui, à
s’étonner, à s’engager, même si la foi est mourante, le doute béant. Il faut que tout soit
« terriblement excitant », comme le répète Hilde inlassablement. Une excitation perpétuelle
qui fait de Hilde l’incarnation même de la libido qui a porté Solness à ce sommet, et qui
aujourd’hui arrive à son épuisement. L’épuisement du désir qui a porté si longtemps la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%