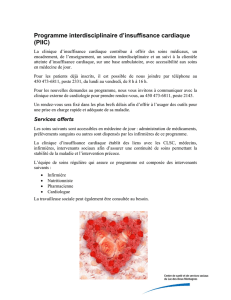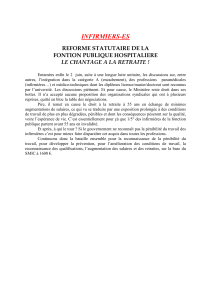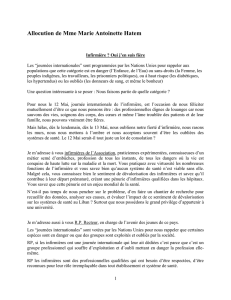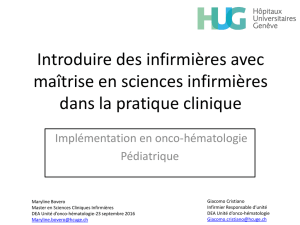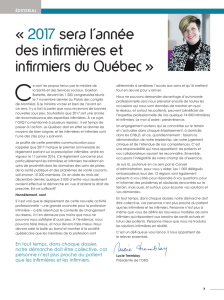Lettre n° 30 - La crise de l`hôpital public - AMPR-IDF

Lettre n° 30 - La crise de l’hôpital public : dysfonctionnement
et déshumanisation
- Rencontre avec Marie-Ange Coudray -
http://www.lattention.com/article.asp?ArtID=5&lk=servicepublic
La surmortalité pendant la canicule et le problème récurrent du financement du système de santé ont de nouveau
fait apparaître les difficultés et les graves dysfonctionnements existant au sein des hôpitaux. Les signes de la crise
de l’hôpital public sont manifestes : pénurie d’infirmières, attentes dans les services d’urgence, « grèves » et
manifestations, démissions de chefs de service... Si tout le monde s’accorde pour dire que l’hôpital public va mal,
encore s’agit-il d’essayer d’en cerner les causes. Deux types d’explication sont souvent mises en avant dans les
débats : le manque de moyens ou le manque de rigueur dans la gestion. Le texte de Marie-Ange Coudray,
infirmière, directrice de l’Institut de Formation des Cadres de Santé Île-de-France [1] que nous publions, montre
que ces facteurs bien réels ne peuvent, loin s’en faut, expliquer le mal-être et les dysfonctionnements des
hôpitaux publics. Ils doivent en fait être resitués dans des évolutions sociales et culturelles qui mettent
directement en jeu la conception même de la santé. La revendication de l’autonomie individuelle, la notion
d’« acteur » de sa propre santé et leur traduction en termes de « droit à » sont désormais présentes dans le
rapport à la maladie. Tel n’est pas le moindre des paradoxes dans un domaine où les individus se trouvent
confrontés à la limite, à la souffrance et à la mort, et qui implique précisément l’aide et les soins des autres. On
glisse facilement de la notion de « patient » avec ce que ce mot implique de rapports de dépendance, à celle de
client avec ses « besoins » et ses exigences qu’il faudrait satisfaire dans l’instant. Au sentiment fataliste de
résignation devant la maladie et la mort a succédé la volonté de repousser sans cesse les limites du possible. Le
modèle de la jeunesse éternelle, le culte intériorisé de la performance, le modèle du client roi... entraînent un type
de rapport à la vie et à la santé impossible à satisfaire. Si des réformes sont nécessaires, encore s’agirait-il
d’aborder frontalement ces questions, plutôt que de « surfer », là aussi, sur les évolutions et la « demande
sociale » en essayant d’y répondre dans une optique étroitement gestionnaire et comptable. Ces évolutions
culturelles, peu abordées dans les discours sur l’hôpital, constituent une dimension essentielle de sa crise. C’est
aussi en portant le débat et la contradiction sur ce plan qu’on peut garder figure humaine aux pratiques de soins
qui engagent une conception de la condition humaine. L’hôpital est en train de vivre des changements avec des
effets de déshumanisation dont il importe de prendre la mesure.
Politique Autrement
Quelle « demande » de santé ?
Inflation de la demande et restrictions budgétaires
L’hôpital est placé dans une situation paradoxale : il se trouve confronté à une inflation de la demande
croissante des patients, alors que les responsables politiques ne cessent de répéter qu’il est de moins en moins
possible d’y répondre sur le plan économique. L’exemple des urgences est très révélateur. Lorsque quelqu’un a
mal aux dents à minuit, - je caricature à peine -, il ne va pas voir un dentiste. Sachant désormais qu’il a le
« droit » de ne plus souffrir, il va à l’hôpital. Si quelqu’un glisse au même moment sur le verglas, le patient qui
a mal aux dents devra attendre deux, trois ou quatre heures. Depuis quinze ans, on ne cesse de répéter qu’il
faut un médecin traitant entre le patient et l’hôpital, pour s’occuper de la « bobologie », certes importante pour

le patient, mais qui n’est pas du ressort des urgences d’un centre hospitalier. Les hôpitaux sont surchargés.
Aujourd’hui, 70% des gens meurent à l’hôpital. Il est arrivé qu’une personne atteinte d’un cancer en phase
terminale ait dû attendre sept heures aux urgences avant d’être prise en charge. Nous sommes confrontés à
une logique terrible. Que faire de cette personne en fin de vie, lorsqu’on n’a pas de place pour les autres,
lorsqu’on n’a pas les moyens financiers pour l’accueillir, lorsque le médecin ne peut pas s’en occuper et que
l’infirmière n’a même pas le temps de lui parler ? On aimerait aider cette dame en train de mourir, mais il ne
nous est pas possible de le faire. C’est un exemple extrême, mais fréquent et significatif.
Sur le plan financier, le déficit ne cesse de se creuser. Les dépenses de santé augmentent régulièrement
d’année en année. Les médicaments, les soins ambulatoires et l’hôpital jouent, dans cet ordre, un rôle essentiel
en volume dans la croissance de la consommation de soins et de biens médicaux. Toutefois, en valeur, ce sont
les soins hospitaliers suivis des médicaments et des soins ambulatoires qui ont contribué aux plus fortes
augmentations. _ En 2003, le déficit prévu du projet de loi sur la Sécurité sociale est de 3,9 milliards d’euros.
Mais on sait que le déficit de 2002, de 3,3 milliards d’euros, est dû essentiellement au déficit des recettes
envisagées. Une diminution d’un seul point du PIB réduit les recettes de 1,5 milliards d’euros. Par contre, un
seul point d’augmentation de la masse salariale en France réglerait le déficit actuel de la sécurité sociale. Jean-
François Mattei, ministre de la santé, exclut une augmentation des cotisations qui serait forcément impopulaire.
Nous sommes confrontés à un phénomène classique : les dépenses augmentent de 5 à 7% par an, tandis que
les recettes augmentent beaucoup moins rapidement. Un contrôle plus serré des dépenses est nécessaire.
Même si elle n’est pas du tout dans la culture médicale, cette idée commence à faire son chemin.
Ces tendances à l’augmentation des dépenses de soin ne vont que s’accentuer, comme dans tous les pays
industrialisés. Le progrès technique est coûteux et les transformations du rapport au corps et à la maladie
pèsent sur les comptes. Le vieillissement est un facteur supplémentaire : des études ont montré qu’on dépense
beaucoup plus dans les cinq dernières années de sa vie et bien des personnes ont accès à des soins qu’elles
n’auraient pas eu autrefois. Il faudra bien se poser les vraies questions : soit rationner le système, soit y mettre
le prix.
Les nouveaux droits du malade
C’est dans ce contexte difficile que, depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé, un nouveau pouvoir trouve une légitimité dans l’hôpital : le pouvoir des patients. Le
changement introduit est considérable. Il ne tient pas tant au fait que le médecin doive informer le patient de
sa maladie (il le devait déjà en théorie), ni que le patient puisse refuser les soins (il le pouvait déjà, sans
toujours le savoir). D’après le texte de loi, il convient de trouver un nouvel équilibre des relations soignants-
soignés pour instituer un véritable partenariat : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé, et
compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ».
Il s’agit bien d’un changement culturel auquel les médecins ne sont pas préparés et qui nous vient directement
de la culture d’« autonomie » des États-Unis. Traditionnellement, notre culture médicale - suivant en cela la
culture de la société française -, était fondée sur la protection et le paternalisme : « C’est bon pour ce que vous
avez. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous ». Ces idées ont bercé les études de nos médecins, voire
de nos infirmières, de tous ceux qui savent pour les autres. Rien, jusqu’à maintenant, ne troublait ce discours.
Ce qui est nouveau à présent, ce n’est pas seulement l’état d’esprit de plus en plus revendicatif et exigeant des
patients, mais la légitimation de cet esprit revendicatif sous forme de droits. Tout le monde le comprend quand
il est dans la position du soigné, mais cela engendre des modifications profondes de comportement pour le
corps médical dans son ensemble, pour les structures de soins, et remet en question la reconnaissance sociale
de ces professions et le statut du « savoir ».
On reconnaît ici l’influence des groupes de patients et en particulier des groupes de malades atteints par le
SIDA. Ce sont eux qui ont induit ce grand changement. Il a fallu, en effet, leur dire la vérité, alors qu’on avait
pu cacher le diagnostic pendant longtemps à ceux qui étaient atteints de cancer. Ils se sont regroupés et ont
exigé d’en savoir davantage. Ils ont fini par mieux connaître leur maladie, ce qui a modifié les rapports de
pouvoir et fait réfléchir les autres catégories de malades atteints en particulier des maladies dites chroniques.
À ceci s’ajoute un autre changement exprimé par les patients, le désir du non-acharnement, c’est-à-dire à la
fois la volonté d’être soigné, mais de ne pas l’être trop, ou dans des proportions qui maintiennent la qualité de
la vie. Le temps où quantité et qualité se rejoignaient est déjà loin et on sait que la prolongation de la vie peut
se faire au prix d’une existence non seulement médiocre, mais carrément inhumaine. D’où le choix de certains
de « mourir dans la dignité », ou en tout cas de refuser parfois pour leur parent des soins qui confinent à
l’acharnement thérapeutique. Pour le corps médical, cette évolution ne va pas de soi.
Ces phénomènes marquent un changement culturel profond. Les patients ont des droits : le droit de décider
pour leur propre santé, ce qui constitue une vraie révolution pour le corps médical ; ils revendiquent le droit de

pouvoir profiter du maximum de la science, mais aussi de ne pas en profiter lorsqu’ils ne le souhaitent plus. Les
médecins ont des responsabilités : ils se doivent d’être efficaces tout en étant soumis d’une certaine façon aux
désirs des patients. Ils doivent apprendre non plus à « ordonner » ou à « faire des ordonnances », mais à
convaincre, persuader et apporter des informations contradictoires pour que le patient puisse décider. Les
médecins voient donc leur position traditionnelle remise en cause par des gens qui ont moins de savoir médical
et scientifique, mais qui se connaissent et veulent poursuivre ou non un traitement, avec ce médecin ou un
autre, en fonction de leurs intérêts personnels.
Un principe de précaution effrayant
La question du risque jette également le trouble dans les repères concernant les rapports entre les médecins et
les patients. Auparavant, c’était le médecin qui prenait le risque de pratiquer une thérapie et, si celle-ci ne
marchait pas, on savait que le risque zéro en médecine n’existe pas. Mais les questions du sang contaminé et
du risque nosocomial à l’hôpital ont montré comment le patient pouvait attraper dans l’établissement hospitalier,
du fait même des structures, un germe ou une affection qu’il n’avait pas à l’entrée. Cette question de l’aléa
thérapeutique a été prise en compte par la loi en mars 2002 et a donné lieu à des ruptures de contrat de la part
des assurances.
Il existe donc une contradiction entre l’application d’un principe de précaution qui n’a pas de sens dans un
milieu hospitalier, car il peut ralentir l’avancée scientifique, et un dédommagement des risques, alors même
qu’ils ont été pris dans l’intérêt du patient. Le médecin est tenu de prouver qu’il a bien informé celui-ci de
l’ensemble des risques encourus et on voit fleurir des documents de « prévention » expliquant que pour tel type
d’anesthésie l’opéré a « x » chances de mourir ou d’avoir une hémiplégie, mais que si l’intervention n’a pas lieu,
il a « x » chances d’y rester. J’ai vu distribuer ces documents de deux pages, effrayants, écrits en petits
caractères, à des personnes devant être traitées par sismothérapies (électrochocs), ce qui démontre bien le
ridicule de l’affaire. La médecine devient-elle un simple calcul de probabilités ? Ces papiers d’autre part n’ont
aucune valeur juridique et le fait de les signer ne change rien. Les rapports de clientèle se transforment en
rapports de contractualisation et ceux-ci mettent mal à l’aise les médecins qui n’ont pas réfléchi à ce type de
questions. C’est pourquoi un nombre de plus en plus important d’entre eux suivent des formations en droit
médical et en éthique.
Comme les médecins, mais de façon moindre, les infirmières sont effrayées par les responsabilités qu’on leur
attribue. Se développe chez elles une sorte de crainte, pas toujours justifiée, que les patients portent plainte et
qu’elles aient à produire des preuves et des documents pour justifier ce qui a été fait ou non. Le formalisme
atteint parfois des sommets. Il arrive malheureusement que les mises en cause ne s’avèrent pas toujours
fausses ; dans ces circonstances, les infirmières ne peuvent pas attendre une aide du médecin, au contraire ;
s’il est lui-même impliqué, il cherchera à se défausser sur les paramédicaux. Plusieurs affaires le prouvent.
C’est pourquoi les infirmières demandent à être formées elles aussi dans le domaine du droit et refusent de
prendre des responsabilité à la place des médecins, ou même de les couvrir.
Quelles réformes ?
Il est important de comprendre les pressions nouvelles en termes d’évaluation, de répartition de moyens, de
coûts médicaux qui pèsent sur les professions de soins. Il s’agit d’un changement profond qui entre
culturellement en contradiction avec la formation médicale traditionnelle.
On manque de moyens en personnel médical, mais on souffre surtout d’une très mauvaise répartition de ces
moyens. Il existe une contradiction entre l’autonomie médicale et la nécessité d’un équilibre et d’une bonne
répartition. Si l’on étudie la répartition de l’offre de soins par rapport aux besoins des années à venir, on peut
dire aujourd’hui qu’elle est largement inadaptée tant du point de vue de l’installation médicale que du nombre
de médecins spécialistes. Les psychiatres sont en PACA (Provence - Côte d’Azur) et les suicides dans le Nord ;
les dermatologues sont sur le littoral méditerranéen et les maladies de peau sont liées à la misère et à la pluie...
Par ailleurs, il existe un manque important de structures pour s’occuper des soins de suite et des problèmes
sociaux qui sont à la frontière entre le sanitaire et le social, surtout dans certaines régions comme l’Île-de-
France.
Nous sommes dans l’incapacité, en France, d’élaborer une politique de santé publique, à la fois en raison du
déficit des indicateurs et surtout du manque d’une réelle volonté politique dans ce domaine. La difficulté à
réorganiser le système est aggravée par le frein des pouvoirs locaux. Les maires ont des positions différentes,
selon qu’ils votent des lois (quand ils sont également députés) et selon qu’ils doivent les appliquer chez eux. De
leur côté, les syndicats sont sur la défensive et les personnels unis dans la colère...

De nouveaux outils de calcul des coûts
Depuis quelques années, pour tenter de contrôler les dépenses de santé et mieux répartir les crédits, on
cherche à connaître la productivité des hôpitaux en France, à l’instar de ce qui se passe aux États-Unis avec le
système Fetter. Il a d’abord fallu trouver un système pour normaliser l’activité et rechercher le « coût d’un
patient » ou plutôt d’une « pathologie » donnée. Des outils ont été progressivement mis en place, à travers le
Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Les patients ont été classés dans des
« groupes homogènes de malades » en fonction de leur pathologie, de leur âge, d’éventuelles pathologies
associées et des traitements. Puis, on a examiné le coût du traitement des ces patients. On constate une
grande disparité entre les établissements. Elle peut s’expliquer par la différence de prise en charge médicale,
mais aussi par les modalités particulières des traitements. Il faut aussi être attentif aux coûts induits qui ne
sont pas calculés ou pris en compte : paiement et formation du personnel, prise en compte de personnel
diplômé, système de protection du personnel de la fonction publique... Chaque année, sont publiés, tout à fait
officiellement, ce qu’on appelle les points ISA (Indice synthétique d’activité) calculés en fait à partir d’une
division entre les dépenses de l’hôpital et les activités produites, chaque type d’activité ayant été affecté
précédemment d’un certain nombre de point par la méthode du PMSI.
Un énorme progrès a été réalisé au cours de ces dernières années. Il représente un changement culturel auquel
personne n’était habitué, mais il n’existe pas encore de lien réel entre ces analyses et l’attribution de moyens,
sans doute parce que, pour le moment, elles ne sont pas encore bien validées. Ceci devrait progresser
prochainement, mais les conséquences peuvent être rudes. Les outils statistiques, de plus en plus performants,
sont loin d’être parfaits et sont encore très contestés. Ils pourraient cependant être utilisés davantage. C’est le
constat que vient de faire la Cour des comptes : elle dénonce la lenteur dans la connaissance du
fonctionnement et de l’organisation du système hospitalier dont on ne mesure ni la performance ni les coûts. Il
n’existe pas, en effet, de comptabilité analytique correcte dans ce domaine. Pour le moment, la liaison entre
ces informations sur la productivité des hôpitaux et l’attribution des moyens n’est pas directe et totale. C’est un
des points du programme « Hôpital 2007 » de Jean-Pierre Raffarin qui veut aller jusqu’au bout de la démarche.
Quelle évaluation et quelle répartition des moyens ?
Depuis les ordonnances de Juppé du 24 avril 1996, ont été mises en place deux instances très importantes :
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) et les Agences régionales d’hospitalisation
(ARH).
L’ANAES a pour mission de mener les hôpitaux à l’accréditation. C’est une sorte de label évaluant la qualité des
pratiques qui permettra finalement aux hôpitaux de survivre ou pas. Il s’agit d’un Établissement public
administratif (EPA), organisme d’État, qui doit examiner l’ensemble du parc hospitalier public et privé. II a pris
pour le moment beaucoup de retard, compte tenu du temps et des moyens dont il dispose et de l’énorme
difficulté de mettre en place des indicateurs. Ce type de procédure est complètement nouveau dans les
hôpitaux et il a mis sous pression à la fois les directions et les personnels, produisant certains modes de
management jugés trop stricts par les personnels concernés. Les rapports de l’ANAES sont publics et bien
entendu cette publicité pèse davantage sur les directions d’établissements.
Les Agences régionales d’hospitalisation (ARH) sont des Groupements d’intérêt public (GIP). Elles prennent
connaissance des dossiers d’évaluation des pratiques des établissements de santé et ont pour mission de
proposer et de mettre en oeuvre des restructurations régionales visant à faire autant ou mieux en matière
d’offre de soins, mais de façon plus équilibrée. Par exemple sur l’Île-de-France, le rapport de l’ARH, que l’on
trouve sur Internet, est fort instructif sur les actions développées par l’agence et les difficultés qu’elle a dû
affronter : augmentation des lits de suite (déficit de 4 850 lits) et diminution des lits de chirurgie, ce qui signifie
le remplacement des uns par les autres et cela n’a pas manqué de provoquer des heurts entre les personnels et
les politiques. Sur ce dernier point, ce sont surtout les cliniques qui en ont fait les frais : entre 1997 et 2001,
sur 238 cliniques de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO ) existant, cinquante d’entre elles ont fermé leurs
portes et douze ont été reconverties en soins de suite. Pour le moment, la jonction avec les enveloppes
financières n’est pas totale. Mais on voit bien que le pouvoir a changé de lieu, puisque ce sont les ARH qui ont
pour mission de répartir les enveloppes régionales, même si elles ne décident pas encore de l’ensemble des
finances. On voit donc que le système est encore très centralisé pour ce qui concerne les nominations, les
règlements et les attributions de certaines enveloppes financières, alors que la volonté affichée est de
régionaliser la restructuration de l’offre et la répartition des crédits. Les ARH se plaignent de n’avoir pas
suffisamment de pouvoirs pour effectuer leurs missions et d’être même en contradiction avec le pouvoir
national à propos de décisions contradictoires ou d’attributions d’enveloppes ciblées.

L’hôpital mis à mal
Les trois pouvoirs : l’administratif, le médical et le soignant
L’hôpital est un milieu très hiérarchisé et très cloisonné. Ceci peut étonner, alors que chacun est censé travailler
à la même oeuvre. Mais il se trouve que chacun croit dans l’utilité de sa fonction, sans forcément se rendre
compte de l’importance de celle des autres. Traditionnellement, on dit qu’il existe deux pouvoirs à l’hôpital :
celui des médecins et celui des administratifs. Mais on oublie de préciser que ces deux catégories de personnels
sont les moins nombreuses et qu’il existe d’autres groupes qui revendiquent leur utilité à faire marcher
l’ensemble. On pourrait donc dire qu’il n’y a pas deux pouvoirs à l’hôpital, mais trois, l’administratif qui serait le
plus gestionnaire, le médical, le plus scientifique, et le soignant, le plus quotidien.
Les directions des établissements publics de santé en France sont administratives et non médicales. Le
personnel des hôpitaux publics (soit 600 000 personnes) est géré par le statut de la fonction publique
hospitalière et dépend, hiérarchiquement, de la ligne administrative. Les directeurs d’hôpitaux sont formés à
l’École de santé publique à Rennes. Ils sont recrutés souvent parmi les diplômés de Sciences politiques ou les
facultés de droit. L’école leur dispense une formation strictement administrative qui entre en contradiction avec
la culture médicale. Ils deviennent des directeurs gestionnaires qui savent surtout appliquer des règlements,
mais moins prendre des risques, à leur côté on trouve de plus en plus fréquemment des jeunes pleins d’allant,
sortant d’écoles de commerce ou de grandes écoles comme l’ESSEC, mais qui ignorent totalement le milieu
hospitalier dans ce qu’il a de quotidien et peuvent entrer en rupture avec le personnel soignant. Ceux-ci
s’identifient à l’image du jeune cadre dynamique, portable à la main, et viennent vous faire de brillants discours
dans le domaine de la qualité, agrémentés de PowerPoint, sur des choses que vous faites depuis vingt ans...
Les médecins ont une autorité scientifique, disposent d’un pouvoir technique et fonctionnel, mais ils sont dans
une position particulière. Leur nomination échappe au directeur de l’hôpital, puisqu’ils sont nommés par le
ministre. Ils ne donnent qu’un avis pour la notation des personnels, et la nomination de ces derniers ainsi que
celle des cadres peut se faire sans leur aval. Parmi les médecins, les psychiatres occupent une place spécifique,
le traitement de la folie bénéficiant d’une valorisation symbolique importante. Sans les médecins, l’hôpital ne
pourrait pas fonctionner, mais ils n’ont pas de place officiellement dans l’équipe de direction d’un établissement.
De son côté, l’« infirmière générale » en a une dans cette équipe. Depuis avril 2002, elle est dénommée
« directeur des soins ». Certaines catégories de médecins ont formulé un recours contre cette dénomination : si
les infirmières « dirigent » les soins, que font donc les médecins ? Le management au quotidien, dans les
services de soins hospitaliers, contrairement à ce que croit le public parfois, n’est pas confié aux médecins,
mais aux paramédicaux. Officiellement il existe treize professions paramédicales recensées, les infirmières sont
les plus nombreuses, avec les trois spécialités : puéricultrices, anesthésistes, bloc opératoire ; puis viennent les
manipulateurs d’électroradiologie, les kinésithérapeutes, les orthoptistes, les diététiciens, les techniciens de
laboratoires, les ergothérapeutes, les psychomotriciens [2]... Les médecins gardent leur fonction technique et
scientifique, la connaissance et le traitement des pathologies, mais la fonction d’organisation des soins est
partagée. Cette contradiction existe depuis longtemps, mais elle devient plus sensible depuis que les
paramédicaux revendiquent leur part officielle dans le management.
Les infirmières craignent une évolution de leur profession allant dans le sens de ce qui existe déjà en Angleterre
et au Canada : faire des prescriptions légères pour soulager les médecins. Les paramédicaux, - qui d’ailleurs ne
veulent plus se faire appeler ainsi -, refusent ce rôle exclusif et demandent une meilleure prise en compte de
leur profession.
Pénuries et dysfonctionnements
La pénurie a pris de plein fouet les structures sans que l’on ait les moyens de les réorganiser dans le même
temps. Quand un service ne tourne plus qu’avec des intérimaires qui ne connaissent pas les règles de
fonctionnement, les pathologie de ce service, voire les personnes avec qui elles travaillent, cela peut devenir
catastrophique. Et on se rend compte alors que la compétence des soignants ne se limite pas au dialogue en
direct avec le patient. Une foule de choses dysfonctionnent parce qu’on ne connaît plus les circuits, les modes
d’organisation, les gens ; on ne sait plus qui prévenir, ni pourquoi celui-là mérite d’être réveillé la nuit et l’autre
pas... La réalité de certains hôpitaux, en région parisienne particulièrement, est catastrophique. Par exemple,
un cadre de neurochirurgie d’un centre hospitalier dont le service s’est déjà vu amputé de plus de la moitié des
lits, ne sait pas qui va venir travailler le soir comme infirmière pour s’occuper de six lits de réanimation, alors
qu’en temps normal, pour ce genre de service, il faut au minimum une infirmière et une aide-soignante par lit,
ou à la rigueur pour deux lits.
On ne trouve plus d’infirmières en dehors des intérimaires. On peut se demander pourquoi, alors qu’on en
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%