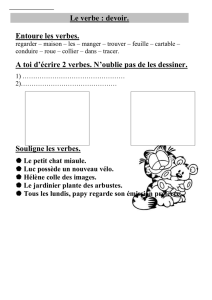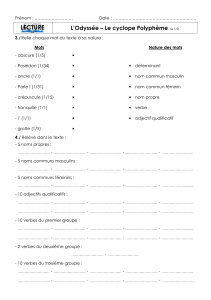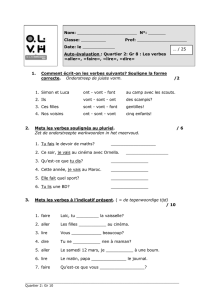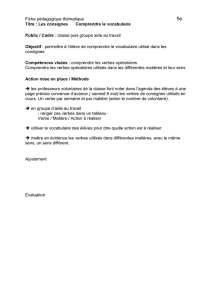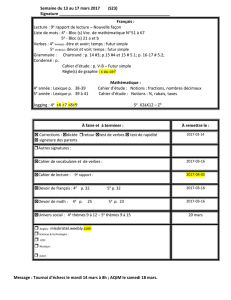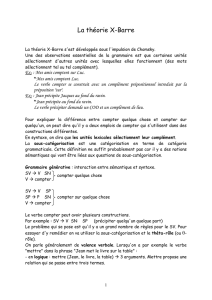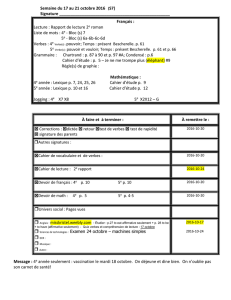Chapitre 2 : La sous-catégorisation Linguistique

Chapitre 2 : La sous-catégorisation Linguistique - CM
1
La sous-catégorisation
Transitivité et intransitivité sont des notions rendues célèbres par la grammaire
traditionnelle. Elles s’appliquent aux verbes. Elles correspondent aux propriétés
relationnelles des verbes : le verbe appelle-t-il un complément ?
Cette notion a été reprise dans le cadre de la théorie thématique (ou θ-theory,
ou théorie argumentale) qui est l’un des nombreux modules de la grammaire
générative.
La théorie argumentale étudie les propriétés relationnelles des unités
lexicales/des termes lexicaux.
La grammaire générative à travers la théorie thématique a repris ces notions de
transitivité/intransitivité et a cherché à les justifier, les affiner et les
systématiser en partant du double constat suivant :
il n’y a pas que les verbes qui soient susceptibles d’avoir des propriétés
relationnelles, tous les items lexicaux (quelque soit leur catégorie
grammaticale) sont susceptibles d’avoir des propriétés relationnelles.
le concept de transitivité/intransitivité constitue une approximation qu’il
faudrait affiner. Il est nécessaire de savoir le nombre de compléments
appelés et leur catégorie.
Le concept de sous-catégorisation permet de préciser :
les propriétés relationnelles des items lexicaux
la catégorie syntaxique des éléments appelés
La sous-catégorisation est une information qu’on peut établir dès le niveau lexical.
On suppose donc que les relations syntaxiques sont déjà prédéfinies dès le
niveau lexical et donc qu’il n’y a aucune relation syntaxique possible si elle n’est
pas déjà prévue dès le niveau lexical.
Ex : *Pierre dort Marie
dormir (Agent)
*Pierre rencontre sur Marie
rencontrer (Agent, Thème) et non (Agent, Lieu)

Chapitre 2 : La sous-catégorisation Linguistique - CM
2
I. La théorie thématique
La théorie argumentale est une théorie de type logico-sémantique qui se propose
d’étudier les fondements logico-sémantiques de toutes les relations syntaxiques
entre les items lexicaux.
Son postulat fondamental est que les relations syntaxiques entre les termes ne
sont possibles que si les termes entretiennent entre eux à un niveau plus
fondamental et plus abstrait un certain nombre de relations logiques.
Ex : J’ai offert des fleurs à Léa
Les trois participants sont prévus dans la structure même du verbe offrir :
offrir (Agent, Thème/Objet, Destinataire)
Prédicat : tout terme qui pour être employé exige de se combiner avec d’autres
termes.
Argument : tout élément qui pour être employé est appelé par un autre élément,
un prédicat.
C’est le prédicat qui détermine le nombre d’arguments.
Il y a en plus des restrictions sélectionnelles :
Ex : *J’ai mangé une chaise
On a vu que le prédicat assigne des rôles thématiques à ses arguments. Il faut
savoir que ces arguments doivent en plus comporter un certain nombre de traits
sémantiques : manger
arg. 1 : agent arg. 2 : objet/thème
[+ animé] [+ mangeable]
Le plus souvent, les prédicats correspondent à des verbes. Cependant tous le
verbes ne peuvent pas être des prédicats : par exemple, les verbes d’état (être,
paraître, sembler, etc.), les verbes impersonnels (falloir, etc.).
Les arguments quant à eux correspondent le plus souvent aux noms (ou
équivalents), mais uniquement les noms référentiels.
Le prédicat détermine le nombre d’arguments et le rôle thématique de ces
arguments.
Ex : pleuvoir ( )
marcher (Agent)
manger (Agent, Objet)
offrir (Source, Objet, Destination)

Chapitre 2 : La sous-catégorisation Linguistique - CM
3
II. La liste de sous-catégoriastion
C’est le versant syntaxique de la théorie thématique.
Ex : pleuvoir < >
marcher < SN >
manger < SN, SN >
offrir < SN, SN, SP >
Le nombre d’actants est directement lié au nombre d’arguments. On ne précise
plus le rôle thématique mais la catégorie syntaxique et également la fonction
syntaxique.
La présence du SN Sujet dans la liste de sous-catégorisation est actuellement un
sujet de débat.
Adverbes : conformément < SP >
Adjectifs : intelligent < SN >
contraire < SN, SP >
Préposition : dans < SN >
III. La sous-catégorisation des noms
La tradition grammaticale française parle de complément du nom aussi bien pour
les véritables compléments du nom (constituants sous-catégorisés par la tête
nominale) que pour les modifieurs de nom.
Ex : Le frère de Marie complément du nom (car sous-catégorisé par le nom frère)
Le portable de ma grand-mère modifieur du nom (car pas sous-catégorisé par
portable)
Pour le verbe, il existe des tests sémantiques formels pour savoir si un
constituant donné est complément (suppression, déplacement). En revanche, il
n’existe pas de tests formels pour voir si un constituant est un véritable
complément du nom :
suppression : il est très facile de supprimer un complément du nom (ex :
l’auteur [ ] est parti ce matin)
déplacement : l’opération n’est pas possible puisque qu’il s’agisse d’un
modifieur ou d’un complément, le SP qui suit est de toute façon toujours
après le nom.
Pour faire la différence entre complément et modifieur, il faut donc regarder la
structure argumentale (l’organisation logico-sémantique) et donc recourir à la
théorie argumentale et à la liste de sous-catégorisation.
On opposera deux grandes familles de noms : les noms catégorématiques (qui
n’appellent aucun complément) et les noms syncatégorématiques (qui appellent un
ou plusieurs compléments).

Chapitre 2 : La sous-catégorisation Linguistique - CM
4
1. Les noms catégorématiques
Les noms catégorématiques sont essentiellement composés des noms concrets
(noms qui désignent des objets concrets). Ils ne sous-catégorisent aucun
complément (comme les verbes intransitifs).
Les noms catégorématiques peuvent tout de même être accompagnés de
modifieurs.
Ex : le livre de mon père SP modifieur du nom livre
La relation entre une tête et son complément est sémantiquement fixe.
Ex : j’ai mangé une pomme toujours la même relation sémantique
vs le livre de mon père son livre ? le livre qu’il a écrit ? le livre qu’il est en train de
lire ? etc. relations sémantiques différentes
Contrairement à ce qui se passe entre un nom syncatégorématique et son
complément, le modifieur d’un nom catégorématique peut jouer différents rôles
sémantiques par rapport à la tête nominale.
Cadre de sous-catégorisation :
livre < >
village < >
2. Les noms syncatégorématiques
Les noms syncatégorématiques sont quant à eux comparables aux verbes
transitifs. Comme eux, ils sélectionnent un complément mais comme eux aussi ils
peuvent apparaître sans leur complément.
Les noms syncatégorématiques demandent systématiquement au niveau logico-
sémantique un complément, même si ce dernier peut éventuellement ne pas
apparaître.
Il y a une relation sémantique fixe entre la tête et son complément.
Il y a quatre grands types de noms syncatégorématiques qui sont :
les noms relationnels
les noms abstraits
les noms déverbaux
les noms méronymiques
a) Les noms relationnels
Ce sont les noms qui expriment des relations entre deux termes. Il y a les noms
de parenté (frère, sœur, cousin, mère…), et d’autres noms comme mari, auteur,
habitant, etc.
Il y a un rapport syntaxique fixe entre la tête et le SP (frère < SP >). Le SP peut
être supprimé s’il est restituable par le contexte.

Chapitre 2 : La sous-catégorisation Linguistique - CM
5
Le complément prépositionnel post-posé au nom peut se réaliser sous la forme
d’un déterminant possessif antéposé.
Ex : le frère de Marie son frère
La liste de sous-catégorisation ne change pas pour autant.
b) Les noms abstraits
Il s’agit de noms comme fait, idée, sentiment, etc. (Le fait que Marie l’ait quitté,
le sentiment qu’il allait lui arriver quelque chose, etc.).
Les noms abstraits nécessitent un complément de type complétive. Le
complément du nom sous forme de complétive est quasi-obligatoire.
Il peut parfois se réaliser sous la forme d’un déterminant démonstratif antéposé
(ce fait, ce sentiment, etc.)
fait < S’ > (ou < S COMP > ou < Ph’ >
c) Les noms déverbaux
Ce sont les noms qui sont dérivés à partir de verbe par l’adjonction d’un
morphème nominalisant (-eur, -tion, etc.).
Ex : construction, attente, espoir, etc.
Construction < SP >
Le SP fait partie de la liste de sous-catégorisation d’un nom déverbal s’il
correspond au complément d’objet direct du verbe correspondant.
Ex : l’ennemi nous craint (avec cette lecture : modifieur du V)
la crainte de l’ennemi
nous craignons l’ennemi (seule cette lecture donne
naissance à un complément du nom)
la démonstration du théorème (démontrer le théorème)
C du N COD
Les noms déverbaux ont pour complément un nom déverbal ou parfois une
complétive qui dépend du nom (ex : l’espoir que le gouvernement intervienne,
espoir < S’ >).
Son désir de partir comment analyser « de partir » ? comme un SP ? comme un
S’ (proposition infinitive) ?
Le SP complément correspond dans tous les cas au complément d’objet direct du
verbe correspondant.
 6
6
1
/
6
100%