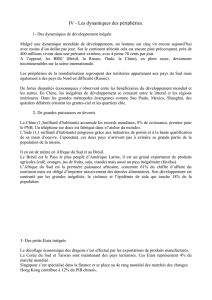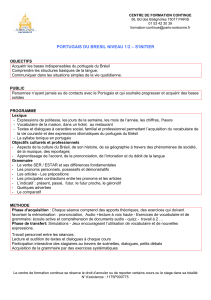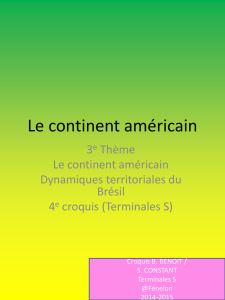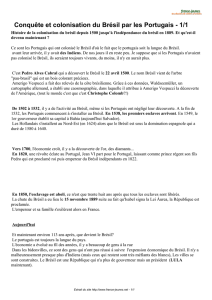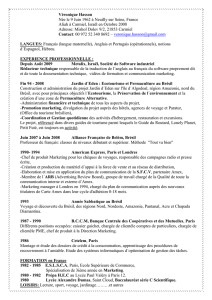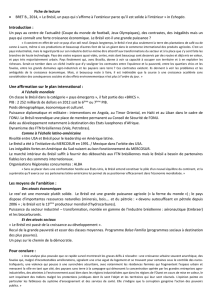fichier matériaux Espace de voisinage

1
Matériaux
Espaces de voisinage

2
Sommaire
Introduction (ou insérer dans les chapitres géogr et rédiger une introduction commune)
1. Retour sur les concepts
Denis Rolland : la doctrine de Monroe en ses miroirs (une définition moderne du voisinage : les
échelles de voisinage)
J. Chr Romer : politique de voisinage et étranger proche (une définition récente du voisinage : voisins
européens)
2. L’Europe de l’UE (titre à revoir, discutable/chronologie)
. Catherine Lanneau () : La Belgique francophone et la France
. Maud Joly (Lyon 3) : L’Espagne de Franco et ses voisins
. Matthieu Trouvé (Bordeaux) : L’Espagne et l’Europe de la Guerre froide
. Louis Clerc (Tuku) : La Finlande et l’étranger 1889-1980
3. Les voisins européens
Birte Wassenberg (UdS) : le voisinage moderne ou les Euro-régions
Denis Rolland (UdS) : le Conseil de l’Europe sa politique de voisinage
Charles Urjewicz : Caucase
Shaki Yousifov : La Russie et la Turquie face à la PEV
4. Les voisins de l’Europe : Les voisins proches
Linda Amiri : Le voisinage des guerres de décolonisation : la Suisse et le FLN
Tewfik Hamel : Le voisinage en Méditerranée
Ekaterina Kasymova : le voisinage en Asie centrale
5. Les voisins américains et transatlantiques
Jim Cohen : Mexique-Etats-Unis (texte promis pour le 13-06)
Mariejo Ferreira (Sciences Po-Poitiers) : Refonder l’espace de voisinage entre Brésil et Portugal 1910-
1922
Luc Capdevila, Voisins et Frontières
Marcio Perreira (éventuellement) : le voisinage culturel entre France et Brésil (me semble mauvais)

3
INTRODUCTION
Denis Rolland et Jean-Christophe Romer
1. Justifier pas seulement relations internationales
Histoire culturelle
Histoire de représentations
Histoire de frontières
Histoire stratégique
Histoires de relations internationales
2. Aperçu sur les concepts
3. Annonce du plan et présentation des articles

4
1. RETOUR SUR LES CONCEPTS
Une définition moderne du voisinage :
les échelles de voisinage ou la doctrine de Monroe en ses miroirs
Denis Rolland
FARE-IEP-Université de Strasbourg
IUF-Centre d’histoire de Sciences Po
1776. Au début, était un petit pays au régime singulier, sans puissance internationale autre que celle
d’avoir su créer son territoire, premier exemple de décolonisation, menacé par l’impérialisme des
puissances européennes en terre américaine : Royaume-Uni d’abord, au Nord, puissance évincée mais
grand voisin ; Russie tsariste ensuite, grande puissance voisine en pleine expansion territoriale qui a
traversé le détroit de Behring et est propriétaire de l’Alaska
1
; Couronne espagnole enfin, maîtresse du
Sud et de l’Est et dont personne n’envisage à la fin du XVIIIe siècle le naufrage imminent.
1815. La géographie du monde contemporain vient de changer après le Traité de Vienne. Après quinze
années d’incertitudes, l’union s’est faite contre la France révolutionnaire, l’Europe est redevenue
uniformément monarchique. L’Espagne lutte depuis quelques années pour se maintenir sur le
continent contre des créoles décidés à suivre le chemin ouvert par les xxx des Etats-Unis. Mais l’union
des Couronnes européennes pour maintenir ou élargir leur espace impérial américain est une
possibilité que Washington ne peut exclure.
1823. Le Portugal vient de perdre le Brésil (1822) et l’Espagne lutte pour se maintenir sur nombre de
ses territoires continentaux. Pour les Etats-Unis, demeurent deux catégories d’étrangers proches,
continental : au premier plan, le Royaume-Uni et la Russie d’une part ; au second plan, l’Espagne qu’il
importe de ne pas affronter directement car c’est l’un des voisins dont on peut espérer des cessions
territoriales essentielles, Floride au Sud et territoires au-delà de la Louisiane à l’Est (entrée dans
l’Union : Ohio 1803 ; Louisiane 1812, achetée à la France en 1803, intégrée aux Etats-Unis en 1806,
Indiana 1816 ; Illinois 1818 ; Alabama 1819 ; Maine 1820 ; Missouri 1821) et les nouveaux pays
indépendants ibéro-américains, d’autre part.
Les voisinage continental de l’Union
d’Est en Ouest : Etats fondateurs, territoires du Nord-Ouest, Louisiane et Nouvelle-Espagne
superposition avec les Etats actuels des Etats-Unis
Russie Royaume-Uni
Espagne
1
. Jusqu’à son achat par les Etats-Unis en 1867. Au début du XIXe siècle la Russie considère que son territoire jusqu'au
détroit de la Reine-Charlotte (actuel Canada) et que les étrangers n'ont pas droit de passage. Comme la Californie est
espagnole et que l'Oregon et la Colombie britannique sont anglais, il n’y a pas d’accès officiel au Pacifique pour les États-
Unis.

5
F : Floride, acquise en 1819 par les Etats-Unis (traité proclamé en 1821)
1
. M : Mississippi,
limite est de la Louisiane L : L'État américain de Louisiana formé en 1812
Les Etats-Unis et ses voisins après 1819
D’après www.radicalcartography.net
La vision du monde à partir des Etats-Unis détermine un des espaces les plus caractéristiques de la
notion d’espaces de voisinage telle que nous l’envisageons dans ce numéro de Matériaux : un espace
considéré ou imaginé comme construit de manière volontariste, construit en vision du monde tout
autant qu’en élément de doctrine.
Plan : Les frontières de Monroe en ses terres, le miroir latino-américain, le miroir scientifique français
et le prisme déformant de la latinité
Monroe en ses terres
Rappels sur le texte et le contexte
- Rien de « confus » ou spontané (comme on l’a parfois suggéré côté français)
2
?
Discours sur l’Etat de l’Union, rituel depuis 1790 (vérifier)
texte
3
Aussi bien l’historiographie anglo-saxonne de qualité que l’historiographie latino-américaine de
qualité (du type de l’ouvrage de référence de Demetrio Boersner
4
/ :
1
. Par le Traité d'amitié, de colonisation et de limite entre les États-Unis d'Amérique et sa Majesté catholique » connu sous le
nom de le Traité d'Adams-Onís. L'Espagne avait initialement refusé de négocier. Mais le poids de la guerre contre
les créoles révoltés en Amérique du Sud l’ont conduit à réviser cette position. En outre, Jackson, poursuivant les
Indiens Séminoles en Géorgie était passé en Floride espagnole, attaquant et prenant des forts espagnols.
2
Site internet Histoire.
3
. Texte complet par exemple in http://millercenter.org/scripps/archive/speeches/detail/3604
4
. Demetrio Boersner, Relaciones internacionales de América latina, Breve historia, Nueva Sociedad, Caracas, 1996.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
1
/
92
100%