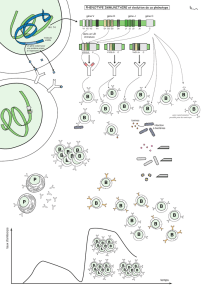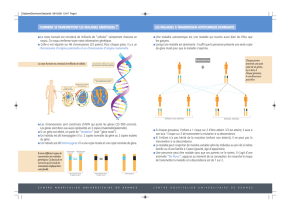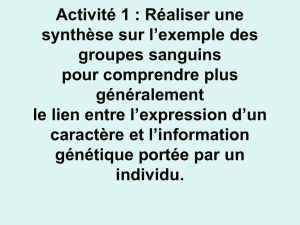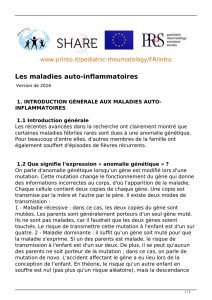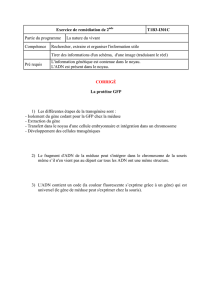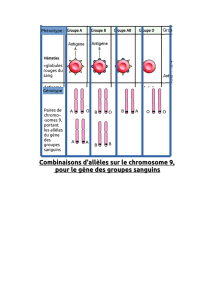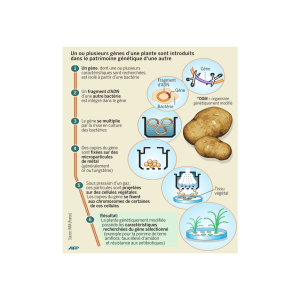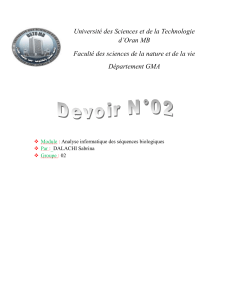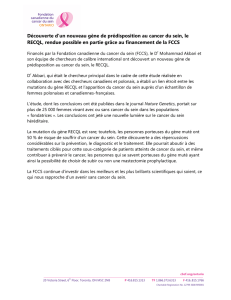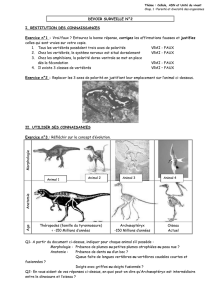Génétique des grandes pathologies

Génétique des grandes pathologies
d'après le cours de G. Pagès
On utilise des modèles animaux pour mimer une maladie, ou alors on mute un gène pour voir
comment les animaux réagissent : comment contrôler cette mutation?
Le cours va porter sur l'obtention d'animaux «transgéniques», plusieurs notions sont abordées, dont
des notions de biologie moléculaire
1) Notions de biologie cellulaire
Génération d'animaux mutants pour un gène nécessite l’utilisation de cellules embryonnaires
souches. On va utiliser ces cellules ES (embryonic stem cells). On les obtient en les isolant à partir
d'embryons de souris à un stade précoce du développement embryonnaire. Le stade utilisé est le
stade blastocyste
(3 j après fécondation). Il est facile de les isoler. Il y a de 8 à 16 embryons chez la souris. Il suffit
de disséquer le système des ovaires, et par flush (seringue) on fait passer un liquide osmotique qui
décroche les embryons que l'on récupère dans les boîtes de culture.
On peut les récupérer par aspiration à l'aide d'une micropipette, et les transférer dans une boîte
(technique courante en laboratoire). Les blastocystes à la loupe binoculaire ont l’aspect décrit dans
la figure ci-dessous.
Les cellules ES se trouvent au niveau de cette masse cellulaire interne (« Inner Cell Mass ») que
l'on récupère et que l'on met en culture. Il existe des milieux de culture utilisés pour garder les
propriétés de cellules souches, qui sont extrêmement bien définis. Ce milieu contient des facteurs de
croissance qui sont présents dans le sérum de veau fœtal. Il contient également le LIF (« leukemia
inhibitory factor »), facteur de croissance absent du sérum de veau fœtal. Ce milieu défini contient
également du beta mercapto-éthanol.
Cellule souche embryonnaire : cellule ayant la capacité une fois qu'elle se différencie, de donner
tous les types cellulaires de l'organisme (cellules nerveuses, adipeuses, musculaires, ...). A ce
niveau, le LIF joue un rôle essentiel et permet aux cellules ES de rester dans un état indifférencié.
On dit que les cellules ES s'auto renouvellent. Si on l'enlève le LIF du milieu de culture, les cellules
ES se différencient. En quelques jours on aura des cellules à morphologie différente des cellules ES
ayant des caractéristiques de toutes les cellules de l'organisme (adipeuses, nerveuses, et même
cardiaques qui se mettent à battre). On visualise ainsi le potentiel de différenciation.
On sait obtenir des cellules ES à partir de certaines souches de souris mais pas à partir d'autres.
C'est pour cela que dans les articles on voit des cellules ES isolées à partir de la souche SV 129. Ce
sont les plus utilisées dans le monde. Deux autres souches de souris sont très utilisées : Black 6 et
OF1 ou MF1 ou FVB. A partir de blastocystes de souris SV129, la réussite d'obtention de cellules
ES, le taux de réussite est d'environ 100% (obtention de lignées de cellules ES à partir des toutes les
Masses cellulaires internes des blastocytses prélevés). Black6 : 50%, les autres : 0.
On ne comprend pas encore très bien pourquoi : dissociation plus difficile des blastocystes dans

certaines souches ?
Les cellules ES humaines ont pu être obtenues, les milieux de culture définis sont différents de ceux
de souris. Il faut autre chose que le LIF pour maintenir les cellules : le FGF (fibroblast growth
factor 2).
Législation : l'utilisation de cellules souches humaines est extrêmement réglementée : comité
d'éthique auquel a été associé un comité spécial, il faut définir les objectifs, des pièces de cultures
spécifiques où aucune autre culture n'est faite. Le laboratoire niçois de Daniel Aberdam a obtenu
une autorisation.
L'utilisation est intéressante : infarctus, diabète de type I... Le problème de rejet (histocompatibilité)
est posé et des expériences intéressantes chez la souris ont été faites à la dans l’équipe de Michel
Pucéat (génopole d’Evry) : des infarctus ont été induits chez le rat, puis on a réinjecté des cellules
embryonnaires souches de souris. Il a réussi à récupérer une fonction cardiaque quasi normale après
injection de cellules embryonnaires souches. Il a réussi ensuite en injectant des cellules ES chez ...
le mouton ! L'étude porte actuellement sur les raisons du fonctionnement : les cellules ES n'ont elles
pas de HLA?
Y a-t-il un problème de prolifération (cancer) ? Dans ces expériences, quelle que soit la quantité de
cellules injectée, il n'y a eu aucun cas de cancer.
Si on injecte des cellules ES en sous cutané chez des souris athymiques («nude»), on induit la
formation de tumeurs excessivement agressives. Plusieurs paramètres sont observés : quantité
minimale de cellules à injecter pour provoquer une tumeur (100 000 cellules ES suffisent), temps
qu'il faut après injection pour développer des tumeurs (1 semaine après injection chez les ES). Les
tumeurs induites par l’injection de cellules ES sont des tératocarcinomes : les coupes de tumeurs
montrent des structures ressemblant à tous les tissus de l'organisme : dents, tissu corné,
musculaire...
Le micro-environnement de l'organe semble entraîner la différenciation de la cellule ES injectée
dans la lignée de l'organe.
Les cellules ES permettent de générer des animaux pour lesquels on a muté un gène particulier.
Comment à partir d'une cellule ES qui va être sauvage peut-on créer une cellule ES mutée sur un
gène donné? Pour faire cela on utilise un processus de recombinaison homologue. Il faut transfecter
les cellules ES, c'est à dire introduire de l'ADN dans une cellule donnée, eucaryote (équivalent de la
transformation chez les cellules procaryotes). Il existe différentes méthodes : micro injection,
lipofection (utilisation de liposomes), électroporation, phosphate de calcium. Dans la cellule ES on
utilise l'électroporation. Quand on fait de la transfection, l'ADN va dans le noyau, une faible
proportion s'intègre au génome. Pour détecter ce qui s'est intégré on utilise des gènes de résistance à
un antibiotique (ex : néomycine, hygromycine, puromycine). L'efficacité de transfection liée au fait
que l'intégration de l'ADN dans le génome est assez faible nous force à utiliser beaucoup de
cellules. 1010 cellules + 10 µg ADN (sous forme de plasmide), on obtient de 100 à 500 clones
cellulaires. C'est donc un événement relativement rare. Les plasmides possèdent une origine de
réplication bactérienne, un gène X, un gène de résistance à un antibiotique procaryote (ex :
ampicilline) et un gène de résistance à un antibiotique eucaryote avec promoteur eucaryote et un
terminateur permettant la poly adénylation. Le promoteur est important dans les cellules ES, tous
les promoteurs ne sont pas fonctionnels dans ces cellules. On utilise des promoteurs de virus SV40
et CMV de façon courante mais ils ne fonctionnent pas dans les cellules ES. On préfère utiliser des
promoteurs ubiquistes comme le PGK (phosphoglycérate kinase).
Il faut également muter un gène donné. Il faut connaître la structure de ce gène (composition en
introns et exons voire sa séquence, ou au moins des sites de coupures ou sites de restriction avec
leur position exacte). Il faut connaître autant que faire se peut l'intégralité du gène (généralement 15
à 20 kb, mais il existe des exceptions, comme par exemple le gène de la dystrophine qui est mutée

dans le cas de la myopathie de Duchenne, 3000 kb). Ceci n'est pas toujours aisé. Pour faire de la
recombinaison homologue, il faut mimer sur papier la manipulation pour prédire tout ce dont on va
parler.
Il faut cloner le gène en question qu'on va muter dans les cellules ES. Il s'agit de criblages de
banques d'ADN génomique. Il faut intégrer cet ADNg dans un vecteur donné, généralement dans un
plasmide tel que décrit précédemment.
Exemple : gène à 3 exons
Il faut cloner le gène à partir d'une banque qui a été réalisée à partir de l'ADNg de cellules ES, car
dans le cas des transfections dans les cellules eucaryotes il y a 2 types d'intégrations possibles si on
transfecte avec un plasmide contenant une partie correspondant à de l'ADNg de la cellule. Il y a
l'intégration hétérologue, et l'intégration homologue (par crossing over). Le mécanisme d'intégration
hétérologue est plus fréquent que l'homologue. Le mécanisme homologue dépend de plusieurs
paramètres, et on peut augmenter sa fréquence : l'ADN transfecté doit être homologue à 100% avec
l'ADN cellulaire. C'est pour cela que l'ADNg a du être cloné et obtenu à partir de la cellule ES que
l'on va transfecter. Si on utilisait de l'ADNg d'une autre souche, l'homologie ne serait pas totale
(allèles de gènes différents, ou encore différences au niveau intronique). La taille de l'ADNg
présente dans le vecteur est également importante.
Il faut une taille minimale pour avoir au moins un événement de recombinaison homologue.

On veut sélectionner les cellules transfectées tout en détruisant la fonction d'un gène. On va au
niveau d'un exon donné éliminer une partie de l'exon et la remplacer par un gène de résistance à
l'antibiotique eucaryote. Il doit être autonome (promoteur lui permettant de fonctionner, séquence
de poly adénylation...). La mutation doit supprimer totalement la fonction du gène. Il faut donc
connaître à l'avance la séquence complète du gène.
On transfecte le plasmide ainsi construit par électroporation. La fréquence de recombinaison
hétérologue est plus importante que celle homologue (1 pour 1000 hétérologues). Pour réduire le
nombre de positifs à recombinaison hétérologue, on utilise le gène TK (thymidine kinase) placé
comme sur la figure, en dehors de la région homologue. TK permet le principe de sélection
négative. En présence de gancyclovir les cellules possédant le TK (par recombinaison hétérologue)
vont le métaboliser. Ces produits issus du métabolisme du gancyclovir par l’action du gène TK sont
toxiques. On provoque ainsi la mort de la cellule. Le rapport sera bien réduit (1 pour 200
hétérologues). Cette technique n'augmente pas la fréquence absolue de recombinaisons homologues
mais diminue le nombre de faux positifs.
On peut détecter par Southern Blot les recombinaisons homologues. Il faut couper avec des
enzymes de restriction extérieures à la partie recombinée. Si c'est interne, on détectera aussi les
hétérologues. La sonde utilisée est généralement en dehors de la région transfectée, de préférence
une région exonique.
Couramment, on fait un Southern avec 2 types de sondes, une externe à la recombinaison
homologue et une avec le gène de résistance. On aura donc un fragment à la taille attendue
comprenant le gène de résistance.
Résultat du Southern : Recombinaison homologue sur un des deux allèles du gène (16 kb), l'autre
n'a pas été affecté (15 kb).
Le Southern est une manipulation assez courte, mais sur 300 clones... Il vaut mieux procéder par
PCR avec une amorce à l'extérieur de la région de recombinaison homologue (oligo 1) et une
amorce soit dans néo-R (oligo2), soit plus loin que néo-R (oligo3)
Il faut savoir que les vecteurs sont rarement symétriques, mais plutôt dissymétriques par rapport au
gène de résistance. Ceci permet de faire le diagnostic par PCR car l'amplification sur des grandes
distances est compliquée. On préfère ne pas dépasser les 2 kb.

Nous avons vu comment diagnostiquer s'il y a eu intégration ou non. Cependant dans ce cas il faut
déjà connaître de façon aussi détaillée que possible le gène. Ce sont des manipulations délicates, il
faut cribler de nombreux clones. Une des principales difficultés est que le nombre de clones ayant
subi un processus de recombinaison hétérologue est beaucoup plus important que celui de
recombinaison homologue.
Il existe des astuces de sélection :
Si on place le gène de sélection (antibiotique) au niveau de l'exon 1, et que ce gène de sélection n'a
pas un fonctionnement autonome (pas de promoteur dans ce cas), la seule manière qu'il aura de
s'exprimer est qu'il y ait un phénomène de recombinaison homologue qui le place à proximité du
promoteur. Ce type de vecteur risque cependant une insertion à proximité d'un promoteur différent
de celui du gène voulu. Un tel vecteur correspond donc à 1 clone sur 30 qui sera bon. Dans 30% des
cas, on a une recombinaison homologue. On a éliminé de nombreux faux positifs.
Il faut cependant que le promoteur fonctionne dans les cellules ES. Ceci peut être vérifié avec une
construction artificielle contenant le promoteur du gène en amont d'un gène rapporteur (luciférase,
beta galactosidase...). On peut aussi vérifier le fonctionnement du promoteur en analysant l'ARN
par Northern ou RT-PCR.
D'autres personnes ont essayé de placer le gène de résistance au niveau du dernier exon, avec un
promoteur mais sans séquence de poly adénylation. C'est le même principe, mais la méthode est
moins stringente car il peut y avoir expression du gène de résistance à dose plus faible... Ces deux
méthodes permettent d'augmenter la proportion de recombinaisons homologues chez les positifs.
Des expériences de promoter-trap ont été réalisées. L'idée de ce type d'expérience est de transfecter
dans des cellules ES un gène rapporteur beta géo (beta gal + néo résistance). Ceci a été réalisé par
l'équipe d'Austin Smith à Edimbourg (recruté maintenant à Cambridge). On prend le gène beta géo
dépourvu de promoteur, et on le transfecte dans les cellules ES.
L'objectif est d'obtenir des animaux mutants pour un gène... On va donc réinjecter les cellules ES
modifiées au niveau du blastocyste de souris.
On va faire s'accoupler des souris blanches pour obtenir des blastocystes (au 3ème jour). On prélève
les blastocystes et on microinjecte les cellules ES. C'est une manipulation de haute précision
nécessitant des appareillages très sophistiqués. Un premier micromanipulateur permet de coincer le
blastocyste sur une première micropipette. Une seconde micropipette bizeautée permet, avec un
deuxième micromanipulateur, de pénétrer le blastocyste. On va alors aspirer les cellules ES (une
centaine). On dépose ces cellules ES dans le blastocyste. Ce dernier sera réimplanté dans une souris
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%