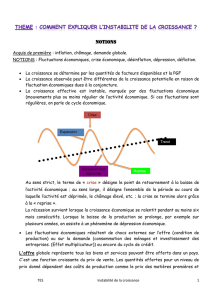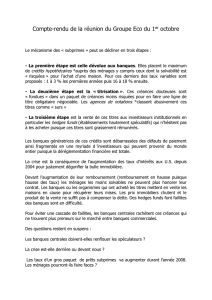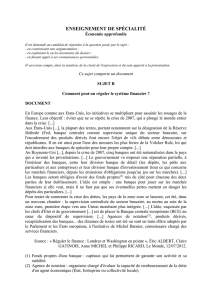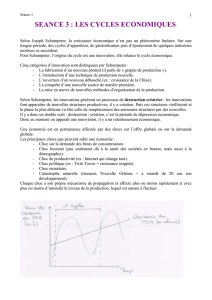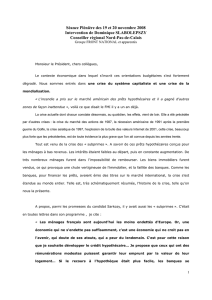causes - Apses

CAUSES
FAITS
CONSEQUENCES
Surproduction ventes insuffisantes =>
prix et faillites des entreprises aux coûts
les plus élevés
BAISSE DE LA
PRODUCTION
profits, investissements, emploi
(licenciements)
salaires + chômage non indemnisé
(19ème siècle) ou faibles indemnités
BAISSE DES
REVENUS
consommation
revenus + insécurité sociale et
anticipations pessimistes =>
épargne de précaution
BAISSE DE LA
CONSOMMATI
ON
demande de biens de consommation =>
la production des secteurs des biens de c° est
ralentie
Surproduction existence de surcapacités
de production
profits => ressources
d’autofinancement
anticipations pessimistes
BAISSE DE
L’INVESTISSE
MENT
demande de biens de production
La crise au 19ème siècle en économie de marché concurrentielle : un processus cumulatif
Les mécanismes de la reprise
Ils sont liés aux variations des prix (= mécanismes de marché, libéralisme) et au
comportement des acteurs :

Le problème à résoudre : O > D. Or, la dépression conduit « spontanément » à un freinage de
l'offre (faillites, baisse de la p°...) et à la baisse des prix et des coûts de production
salaires (= du prix du facteur travail)
des taux d'intérêt car il y a moins d'emprunteurs sur le marché des capitaux du fait
de la baisse de l'investissement) => du prix du facteur capital.
la baisse des prix va entraîner l’élimination des entreprises les moins rentables au
profit des plus dynamiques et au bout d'un certain temps une stimulation de la
demande quand les consommateurs vont vouloir profiter des aubaines liées aux baisses
de prix ...
la baisse des coûts de production = des facteurs moins chers (concurrence entre
travailleurs => Baisse des salaires. La baisse des taux d'intérêt rend l'investissement
plus rentable) => incitation à investir et à embaucher à nouveau. L’investissement et
l’embauche stimulent la demande et redressent les anticipations.
Le marasme économique stimule la nécessité de trouver de nouvelles solutions, d'être
plus productifs => Recherche de gains de productivité et Innovations
REPRISE ECONOMIQUE : O et D
...Mais, ces mécanismes (de marché) prennent du temps et sont coûteux économiquement
(faillites = gaspillage de moyens de p°) et socialement (chômage, freinage des salaires et de la
c°...).
Trois types de mécanismes sont donc à l’œuvre :
– Des mécanismes lies au fonctionnement du marché : les variations des prix permettent de corriger les
déséquilibres ;
– Des mécanismes lies aux comportements des acteurs : par exemple, les entreprises ajustent leurs
investissements a la demande ;
– Des mécanismes macroéconomiques : l’investissement est source de croissance économique, mais, lorsque le
stock de capital est suffisant (ou excessif), l’investissement cesse, contribuant au retournement conjoncturel.
2.1 / Conditions de production et fluctuations : les « chocs d’offre »
Livre p. 51
« Les chocs d’offre négatifs sont causés généralement par une hausse du coût des matières
premières (chocs pétroliers de 1973 et 1979 par exemple), par des augmentations de salaires
supérieures aux gains de productivité (comme au cours des années 1970) ou par un
alourdissement de la fiscalité sur les entreprises. En cas de choc d’offre négatif, l’activité
économique devient plus coûteuse et les entreprises les moins productives et compétitives
risquent d’être acculées à la faillite.
Inversement, lorsque des innovations permettent des gains de productivité et abaissent les
coûts unitaires de production, elles produisent un choc d’offre positif : en abaissant les prix
des produits, elles favorisent leur diffusion auprès des consommateurs et donc l’augmentation
de la production. En cas de choc d’offre positif, la situation des producteurs s’améliore par la
diminution de leurs coûts de production ; ils peuvent dès lors éventuellement produire
davantage et tirer la croissance économique. » Eduscol 2012
« De nouvelles technologies, une augmentation des investissements en capitaux ou [une
hausse] de la population active peuvent produire une accélération de la croissance du
produit potentiel et, par conséquent, un boom économique. Les variations du taux de
croissance du produit potentiel fournissent incontestablement une bonne part de l'explication
des expansions et des récessions. Aux États-Unis par exemple, le boom économique de la

seconde moitié des années 1990 s'explique largement [...] par les nouvelles technologies de
l'information [et de la communication - NTIC] telles que l'Internet. »
Robert H. Frank et Ben S. Bernanke, Principes d'économie, Économica, 2009.
A / Le progrès technique et les innovations : un processus de destruction créatrice
Livre p .50
Quelle sera la prochaine victime du téléphone mobile ? Après avoir relégué aux oubliettes l'assistant numérique personnel
(PDA), très en vogue au début des années 2000, le petit appareil s'attaque maintenant au téléphone fixe, à l'appareil photo
numérique, à l'iPod, voire à la montre. Il est l'illustration même de la "destruction créatrice" définie par l'économiste
autrichien Joseph Aloïs Schumpeter. Et c'est loin d'être fini...
Les investisseurs auraient intérêt à se pencher sur les puissantes capacités schumpétériennes du téléphone portable. Au
tout début de ce nouveau siècle, les banquiers s'échangeaient des informations via les rayons infrarouges d'un Palm Pilot
désormais désuet. La société Palm arborait avec fierté une capitalisation de 92 milliards de dollars. Sa métamorphose dans les
téléphones mobiles lui a coûté 97 % de sa valeur.
Le téléphone classique est la prochaine cible la plus évidente. Il a déjà disparu dans près d'un quart des foyers
américains. Un vrai drame pour AT & T ou Verizon, qui doivent continuer d'entretenir à grands frais des infrastructures. Il
n'est pas jusqu'à l'iPod qui n'ait pris un petit coup de vieux. Les ventes baissent. Apple ne s'en émeut guère : les clients
écoutent leur musique sur un iPhone qu'ils ont payé plus cher.
Ne parlons pas du malheureux fabricant de montres. La plupart des adolescents consultent leur téléphone portable pour
donner l'heure. Les concepteurs de gadgets sophistiqués qui mesurent le rythme cardiaque ne sont pas non plus à l'abri : il
existe maintenant des applications sur téléphone mobile qui offrent le même service. C'est encore pire pour les systèmes GPS,
les appareils photo et les détecteurs de radars. Pour donner une idée de l'ampleur des dégâts, lorsque Google a ouvert il y a
peu une application de navigation gratuite, les titres Garmin et Tom-Tom se sont respectivement effondrés de 16 % et 23 %
en Bourse. Comme Palm, Garmin espère s'en sortir en lançant son propre téléphone portable.
La destruction créatrice chère à Schumpeter fera aussi le bonheur de certains. Apple, Google et Facebook veulent bourrer
les téléphones mobiles d'informations, de logiciels et de publicité. Une pléiade d'entreprises naîtra pour inventer de nouveaux
produits. Il est moins facile de prévoir la direction que la tornade du téléphone prendra ensuite. Disons qu'il y a de bonnes
chances que cela ait un rapport avec tout ce que l'on peut avoir dans les poches ou dans le sac à main. Cartes de crédit, argent
liquide, clefs, papiers d'identité, livres, journaux, tickets et cartes d'embarquement pour le transport aérien constituent autant
d'objets qui pourraient devenir électroniques. Alors, la dynamique de l'innovation récompensera les esprits créatifs et
entreprenants, et laissera couler les autres. Face à la plainte portée par le premier fabricant finlandais de téléphones mobiles
Nokia pour violations de brevets, la marque à la pomme riposte et poursuit à son tour le leader mondial.
(Source : Robert Cyran et Rob Cox, Le Monde du 04 janvier 2010)
Qu’est-ce que la « destruction créatrice » selon Schumpeter ?
Innovation de procédé
exemples
- Chaîne de montage avec convoyeur
- Traitement informatique de données
- Transport par conteneur
Schumpeter citait entre autres l’usine mécanisée, l’usine électrifiée, les
fusions de sociétés, les nouvelles routes commerciales.
Innovation de produit
exemples
- NTIC : DVD, MP3, écran à cristaux liquides
- Énergie : bioéthanol, solaire
- Santé : scanner, thérapies géniques, carte Vitale
Le progrès technique (plus précisément, les innovations) transforme les conditions de production et de consommation en
agissant de façon différenciée sur la productivité et les prix des différents secteurs et en faisant disparaître des activités
anciennes et apparaître des activités nouvelles : c’est ce que Schumpeter a appelé le mécanisme de « destruction créatrice ».
Il est nécessaire, pour la survie du capitalisme que les entreprises les moins rentables et/ou fabriquant des produits dépassés
disparaissent : en effet, dans ces entreprises, les facteurs de production (capital et travail) sont utilisés moins efficacement
qu'ils pourraient l'être ailleurs.
Le progrès technique imprime un rythme cyclique à la croissance économique.
Schumpeter a aussi beaucoup insisté sur cet aspect. Les innovations ne surviennent pas
régulièrement. Il montre que les périodes d'expansion du capitalisme correspondent à
l'apparition de grappes d'innovations et de groupes d'entrepreneurs. L'arrivée d'entrepreneurs
porteurs d'innovation n'est pas un phénomène continu mais un phénomène discontinu qui se traduit
par des fluctuations dans la croissance économique et l’apparition de cycles longs. La croissance
économique au 19ème siècle n'a pas été linéaire. Elle a été jalonnée de périodes d'expansion et de
récession, de cycles économiques. Schumpeter explique ces cycles par le rôle des innovations. Et
l'investissement que requiert l'innovation se distingue de l'investissement de routine, car il ne s'agit pas
de renouveler ou d'accroître les capacités de production, mais bien d'introduire un changement
profond.

Un cycle de Kondratiev est un cycle économique de l'ordre de 40 à 60 ans aussi appelé cycle de longue durée. Mis en
évidence dès 1926 par l'économiste Nikolai Kondratiev dans son ouvrage Les vagues longues dans la vie économique, il
présente deux phases distinctes : une phase ascendante (phase A) et une phase descendante (phase B).
Joseph Schumpeter propose une interprétation l'alternance des phases A et B. Il relie les fluctuations de l'économie à
l’apparition d’innovations majeures qui surviennent par « grappes » donc au progrès technique. Ainsi, selon lui, la
phase A correspond à la période de diffusion et d'amortissement des nouvelles innovations. Durant cette période, la demande
de biens est forte, ce qui permet une augmentation générale de la production et assure donc la croissance économique. Peu à
peu, lorsque les agents économiques sont équipés en nouveaux produits, la demande baisse, alors que la concurrence entre les
entreprises est de plus en plus rude. On parvient alors au point de retournement du cycle. La phase B correspond à
l’élimination des stocks, à la fermeture des entreprises et des filières les moins rentables ce que Schumpeter appelle le
phénomène de « destruction créatrice » et à la préparation d’une nouvelle vague d’innovations.
(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Kondratiev, 2012)
B / Des chocs exogènes ou des dynamiques internes
Livre p .51
Des chocs exogènes (ex chocs pétroliers) et/ou des dynamiques internes (augmentation
excessive des salaires, de certains prix, freinage de la productivité...) peuvent affecter la
productivité et la compétitivité* de façon plus ou moins favorable.
* La compétitivité est l'aptitude à soutenir la concurrence des autres firmes ou des autres nations grâce à ses
prix (« compétitivité prix ») ou à d'autres facteurs: la qualité, le degré d'innovation, le service après-vente, etc.
(« compétitivité hors prix »).
Exemples de chocs d’offre négatifs :
Un choc d'offre négatif lié à l'augmentation des coûts de production peut conduire à la faillite
d'entreprises et entraîner une phase de récession. Des conditions climatiques défavorables ou
une tension sur les marchés de matières premières, de même qu'une baisse du taux
d'innovation technologique, réduiront le taux de croissance potentiel.
De nombreux éléments peuvent être en cause : ................................................... ?

Question de synthèse : « Comment peut-on expliquer les fluctuations économiques en
raisonnant en termes d'offre ? »
2.2 / Conditions de débouchés et fluctuations : les « chocs de demande »
Rappelez-vous l'équation de la comptabilité nationale: PIB = C + I + G + X – M
Trouvez des phénomènes qui peuvent influer sur chacun des éléments de l’équation ( = sur
chaque composante de la demande) dans un sens positif ou négatif
« Lorsqu’une des composantes de la demande globale adressée aux producteurs se modifie, on parle de « choc de
demande ». Lorsque la demande globale est affectée par des chocs positifs, sa hausse peut impulser une phase
d’expansion. Inversement, si des chocs de demande négatifs se produisent, ils peuvent provoquer une diminution
de la demande globale et conduire à une récession. Ces chocs de demande risquent d’avoir un impact amplifié
sur l’activité économique du fait du comportement des entreprises en matière de stocks. Lorsque la demande
ralentit, la production peut baisser beaucoup plus fortement si les entreprises décident de réduire leurs stocks afin
d’anticiper une baisse plus marquée de la demande ; la hausse du chômage, la baisse du nombre d’heures
travaillées en général risquent alors de contribuer à accentuer ce ralentissement. Inversement, lorsque la hausse
de la demande s’accélère, les entreprises produiront d’autant plus qu’elles devront reconstituer leurs stocks ; la
baisse du chômage et la hausse du nombre d’heures travaillées peuvent alors contribuer à entretenir
l’augmentation de la demande, de même que les investissements réalisés par les entreprises pour étendre leurs
capacités de production. » Eduscol 2012
ZOOM : le rôle de l’investissement dans les fluctuations :
Les variations de l’investissement jouent à la fois sur l’offre et sur la demande
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%