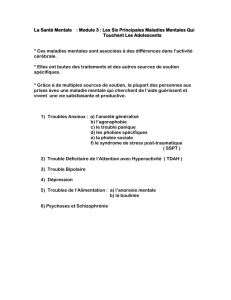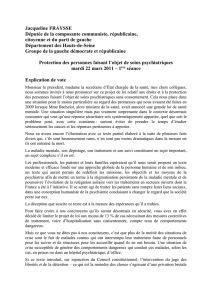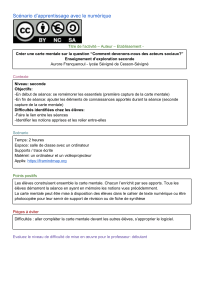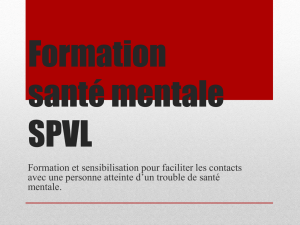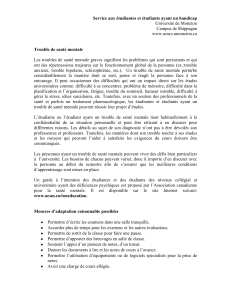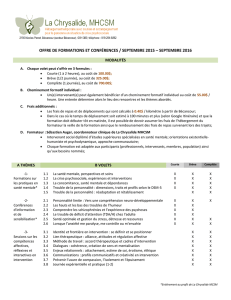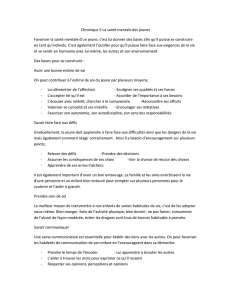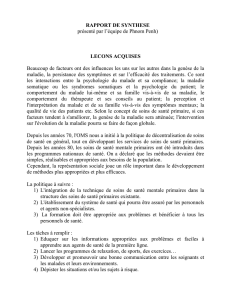Mercredi 12 octobre 2005

L
L’
’i
in
nc
cl
lu
us
si
if
f
La veille des personnes ayant des incapacités
Mercredi 12 octobre 2005
Numéro 153
Aujourd’hui en veille
o CHSLD Saint-Charles-Borromée
o Bisbille entourant le déménagement d’un centre de personnes âgées à
Sainte-Foy
o Médicaments pour le TDAH sous surveillance
o Problèmes de santé mentale et justice
o Problèmes de santé mentale et justice Hospitalisation et santé mentale
o Sécurité incendie et personnes à mobilité réduite
CHSLD Saint-Charles-Borromée
Paru mercredi 12 octobre 2005 dans Le Journal de Montréal
Exclusif Journal de Montréal
Saint-Charles-Borromée: un rapport dévastateur
Fabrice de Pierrebourg -Le Journal de Montréal
12/10/2005 04h18
La résidence Saint-Charles-Borromée, déjà éclaboussée à l’automne 2003 par des cas de mauvais
traitements envers ses patients, fait l’objet d’un autre rapport ministériel dévastateur dans lequel elle
n’obtient pas la note de passage.
Ce rapport de l’équipe de visite du ministère de la Santé et des Services sociaux, obtenu par Le
Journal de Montréal en vertu de la Loi d’accès à l’information, recense une fois encore de graves
lacunes dans la façon dont sont traités les résidants.
Plus d’un an après le scandale, après d’autres inspections, de multiples recommandations et
promesses de changements, même l’équipe de direction reconnaît, dans ce document, qu’elle
hésiterait à être admise dans sa propre installation si sa situation l’exigeait !
D’une façon générale, le CHSLD Saint-Charles-Borromée reçoit une mauvaise évaluation. La
majorité des cotes d’appréciation se situent en bas de 60 % et beaucoup en dessous de 40 %.

Le ministère conclut donc sans détours que «les objectifs sont peu rencontrés» dans l’établissement
du boulevard René-Lévesque.
Roulement de personnel
Les enquêteurs déplorent d’abord que les intervenants du centre ne connaissent que «partiellement
ou très peu» les habitudes de vie, les centres d’intérêt et les problèmes des résidants. Le trop grand
roulement de personnel en serait la principale cause.
Les services seraient aussi «difficilement accessibles» à certaines périodes de la journée et les suivis
se feraient mal lors des changements d’équipe.
Le centre obtient une bonne note au niveau des soins médicaux, spécialisés et cliniques en dépit de
quelques problèmes de listes d’attente. Le point faible concerne en revanche un manque de
consultation des usagers lors des changements de médication (effets secondaires, état de santé).
Il y a unanimité pour reconnaître la bonne qualité des activités récréatives ou sociales et la facilité
d’accès en journée. Mais le CHSLD est mal noté pour l’accessibilité aux activités spirituelles,
hormis la religion catholique.
Mauvaises notes
Mauvaises notes aussi dans tout ce qui touche l’organisation de la vie quotidienne des patients. Les
auteurs du rapport reprochent à l’institution de peu tenir compte des opinions des résidants lors des
changements les concernant (visites, bains, repas, heure du lever…), et en ce qui concerne le respect
de leurs habitudes de vie, etc.
Les enquêteurs ont aussi observé «un manque d’interaction et d’empathie» entre certains
intervenants et résidants lors des repas ainsi que des «faiblesses» en ce qui concerne la dignité et le
respect du résidant. Entre autres, trop de familiarités.
Enfin, il est noté des ratés tant dans l’affichage du code d’éthique que dans son application. On
déplore aussi une certaine lenteur de la direction à intervenir lorsqu’un employé «manifeste un
comportement insatisfaisant».
Cette visite surprise s’est déroulée fin novembre 2004. Elle entrait dans le cadre d’une campagne
générale d’inspection des CHSLD de la province ordonnée par Philippe Couillard à la suite
justement du scandale ayant éclaté dans l’établissement montréalais.
Une nouvelle inspection est suggérée d’ici la fin de cette année.
Saint-Charles-Borromée héberge jusqu’à 204 adultes lourdement handicapés.
Ce que dit le rapport
«Le groupe d’appréciation a observé un manque d’interaction et d’empathie entre certains
intervenants et les résidents qu’ils faisaient manger. […] Certains résidents sont dirigés vers la salle
à manger jusqu’à 45 minutes avant le début du repas […] il n’y a aucun choix de menus, le choix se
faisant 4 semaines à l’avance.»
«… faiblesse de l’organisation concernant l’évaluation et le suivi rigoureux de la revue de la
médication.»

«L’attente est parfois très longue avant de pouvoir aller à la toilette et se faire aider une fois le
besoin terminé. […] Entre 14 h 30 et 15 h 30, les services sont difficilement accessibles et […] les
soins dentaires plutôt rares.»
«Certains résidents ont manifesté leur gêne lorsqu’ils prenaient une douche en même temps que
d’autres résidents, car les rideaux n’étaient toujours pas tirés adéquatement.»
«Il est important de souligner que l’équipe de direction considère que l’organisation et la prestation
des services ne permettent qu’en partie d’assurer le respect et la dignité du résident.»
«De façon générale, l’établissement présente un environnement agréable et fonctionnel et des lieux
propres et bien entretenus.»
Paru mercredi 12 octobre 2005 sur SRC.CA/Montréal
Saint-Charles-Borromée: nouveau rapport accablant
Mise à jour le mercredi 12 octobre 2005, 14 h 58 .
.
Le ministre de la Santé, Philippe Couillard, confirme qu'un rapport ministériel, datant de novembre
2004, rapporte des failles importantes dans l'organisation des soins aux résidants de Saint-Charles-
Borromée.
M. Couillard a déclaré en entrevue que le rapport de 2004 identifiait clairement de nombreuses
lacunes dans les soins aux résidants.
Le ministre ajoute qu'il s'agit maintenant de déterminer ce qui a été fait depuis un an pour améliorer
la situation et corriger les lacunes, de façon à ce que les services donnés à Saint-Charles-Borromée
en viennent à se comparer aux services disponibles dans les autres institutions du genre au Québec.
Rapport accablant
Ce nouveau rapport d'une équipe d'inspecteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux met
au jour des problèmes persistants au Centre d'hébergement et de soins de longue durée Saint-
Charles-Borromée.
C'est ce que rapporte le Journal de Montréal qui a obtenu copie du document grâce à la Loi d'accès à
l'information.
La résidence Saint-Charles-Borromée
Plus d'un an après la crise qui a secoué le centre de soins Saint-Charles-Borromée, à la suite de la
mise au jour de mauvais traitements à l'endroit de certains résidants, l'établissement du boulevard
René-Lévesque, à Montréal, se retrouve une nouvelle fois dans une situation inconfortable.

Parmi les lacunes relevées dans le rapport, on note la familiarité excessive à l'endroit des résidents, le
manque d'empathie, la connaissance insuffisante des problèmes des usagers, les services peu
accessibles à certaines heures, le manque de consultation des résidents et les mauvaises
communications entre membres du personnel lors des changements d'équipes.
La directrice de Saint-Charles-Borromée réagit
La directrice générale associée du centre d'hébergement et de soins de longue durée, Lise Guimond,
admet que tous les correctifs nécessaires n'ont pas encore été apportés. Elle souligne cependant que
des améliorations notables ont eu lieu depuis le passage des inspecteurs, notamment en ce qui
concerne la formation des employés et les critères d'embauche de ces derniers.
35 employés ont été suspendus ou congédiés depuis avril dernier.
La directrice ajoute que le manque de personnel disponible lors de ce qu'elle nomme les périodes de
pointe, soit les repas et l'hygiène corporel, constitue un problème.
Selon le quotidien montréalais, la « note » globale attribuée à l'établissement après une visite de
contrôle fin 2004 se situe en deçà des 60 %, la plupart des objectifs étant « peu rencontrés », selon le
ministère.
La résidence Saint-Charles-Borromée a fait l'objet de plaintes très médiatisées de la part de familles
de résidants, il y a deux ans. Le suicide de son directeur général peu de temps après avait également
défrayé les manchettes. Ce centre de soin de longue durée accueille plus de 200 adultes lourdement
handicapés.
[Retour sommaire]
Bisbille entourant le déménagement d’un centre de personnes âgées à Sainte-Foy
Paru mercredi 12 octobre 2005 dans Le Soleil
12-10-2005
Sainte-Foy-Sillery
Le CHSLD sur Neilson obtient le feu vert
Claude Vaillancourt
Le Soleil
Québec
Le conseil d'arrondissement Sainte-Foy-Sillery a décidé d'aller de l'avant avec le projet de
construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) en bordure du
boulevard Neilson, et de faire fi des objections de certains citoyens qui craignent que son
aménagement entraîne une trop forte augmentation de la circulation automobile dans le secteur.

Le projet, d'une valeur de 13 millions $, est patronné par l'Agence de santé et des services sociaux de
Québec, qui estime qu'il faut absolument déplacer le désuet centre d'hébergement Saint-Sacrement
où sont entassées, dans des conditions discutables, une soixantaine de personnes âgées.
« Les promoteurs vont pouvoir se mettre au travail dès le printemps s'ils le veulent », a assuré le
conseiller Gilles Bolduc, peu de temps après que le conseil eut voté une proposition qui consacre le
terrain situé au coin du boulevard Neilson et de la rue des Compagnons comme un lieu réservé au
seul établissement d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).
« Pour nous, c'est clair, de dire le président du conseil d'arrondissement. Le terrain ne peut être
utilisé que pour un CHSLD, et il n'y aura pas de référendum là-dessus. »
Plus de détails dans la version papier du journal Le Soleil.
[Retour sommaire]
Médicaments pour le TDAH sous surveillance
Paru mercredi 12 octobre 2005 dans Le Devoir
Ritalin et compagnie sont sommés de montrer patte blanche
Louise-Maude Rioux Soucy
Édition du mercredi 12 octobre 2005
Mots clés : Canada (Pays), Médicament, santé, ritalin, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans
hyperactivité
Écorchées par la crise du Vioxx qui avait mis tous les anti-inflammatoires sur la sellette, les
compagnies pharmaceutiques doivent aujourd'hui montrer patte blanche dans le dossier épineux du
trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Pendant que les Nations unies
sonnent l'alarme, Santé Canada et son pendant américain, la Food and Drug Administration (FDA),
somment les fabricants de faire promptement leurs devoirs.
Cette entreprise, que les trois parties qualifient de «préventive», tire principalement son origine de
signaux lancés récemment par le milieu médical et pharmaceutique. Au premier rang figure celui du
géant Eli Lilly, qui, le 29 septembre dernier, modifiait la monographie de son Strattera pour y ajouter
une mise en garde indiquant que ce médicament peut donner des idées suicidaires à ses utilisateurs,
jeunes et vieux.
Dans la foulée, Santé Canada et la FDA ont décidé d'effectuer une révision de tous les médicaments
utilisés pour soigner le TDAH, soit le Concerta, l'Adderall XR, le Dexadrine, le Ritalin et l'Attenade.
«Tous les fabricants devront soumettre les données de tous les tests cliniques et de tous les rapports
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%