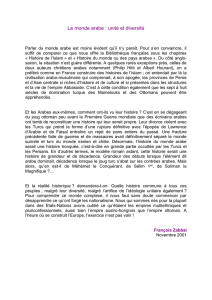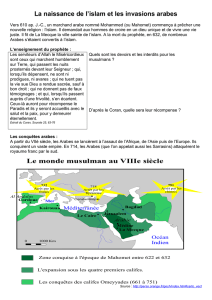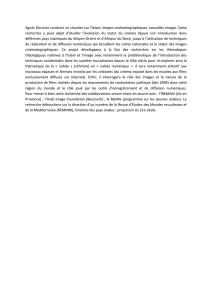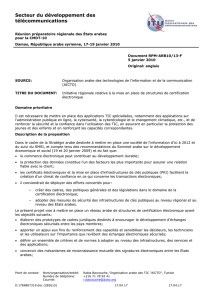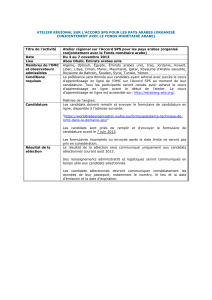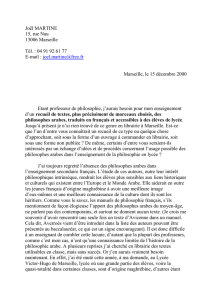Ibrahim NAJJAR Word - Institut international de Droit d`Expression et

LE CODE CIVIL ET LES DROITS DES PAYS DU
PROCHE-ORIENT
par Ibrahim NAJJAR
Professeur à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques
De l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Avocat à la cour
Un survol même superficiel du paysage juridique arabe prouve à
l’évidence que, si l’expression et la pratique du droit des obligations et des
contrats internationaux sont dominées par l’utilisation des langues arabe et
anglaise, le droit privé sous-jacent est souvent d’inspiration française.
Ce constat est aussi vérifiable en droit public, dans les pays du golf,
comme dans ceux du Proche-Orient, les Etats francophones d’Afrique du
Nord et, d’une manière générale, la plupart des pays de la région.
Cette contamination est largement due au rayonnement du Code civil
français, mais aussi de l’idée même de codification et à divers facteurs
d’ordre socio-historiques.
Durant la seconde moitié du 19ème siècle, l’Empire ottoman a, en effet,
cherché à européaniser ses législations et à se doter de différentes
codifications. Auparavant, le législateur ottoman, voulant sans doute, tenter
une codification « islamique », avait pris le parti d’adopter et de publier un
« code civil », la « mejellé ». Ce code fut un échec, bien qu’il ait dominé
longtemps les autres sources gouvernant le régime juridique et les cadres
notionnels en vigueur dans la région. Ce code civil ottoman fut une tentative
de codifier les préceptes du rite (officiel) hanafite… en matière civile et
commerciale, alors même que ces questions ne touchent point à la foi. La
codification – en tranches successives – fut achevée en 1876, après sept
années de travail, et comprenait 1851 articles et 16 titres.
Néanmoins, cette codification, peu inspirée et rudimentaire, fut vite
abandonnée dans de nombreux pays qui étaient sous la domination
ottomane, dès la chute de l’Empire ottoman. Les textes européens, adoptés
par l’Empire ottoman, restèrent soit en vigueur, soit une source législative
déterminante.

2
En outre, si les différentes influences britanniques dans de très
nombreux pays arabes (Irak, Jordanie, Arabie Saoudite, état des Emirats
Arabes Unis, Oman, état de Bahrein, état du Qatar, Egypte, etc…) furent
d’ordre commercial, linguistique, culturel et politique, le retrait de la Grande
Bretagne de la région s’est opéré sans qu’elle laisse une codification de
nature à influencer la législation(1).
Quant au chareh islamique, il a toujours distingué entre les questions
touchant à la foi (ibadate) et celles découlant des relations quotidiennes de
droit civil ou de droit commercial (mo’amalate). Autant les premières sont
restées encadrées par une sorte de sacralisation, en raison de leur racine
religieuse, autant les secondes furent perméables aux influences les plus
diverses. Ces dernières (les Moa’malate) furent ainsi favorisées par les
codifications égyptienne, libanaise et syrienne.
Dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, parmi lesquels on peut
ranger le Liban, la Syrie, l’Egypte, la Jordanie (dans une certaine mesure)(2),
le code civil français de 1804 a dès lors bénéficié de ces facteurs qui en ont
pérennisé l’influence.
Ce survol général, forcément réducteur, montre ainsi que quatre
sources de droit se partagent l’inspiration des différents droits dans les pays
arabes du Proche-Orient :
1°) le chareh islamique, pour les matières du droit extrapatrimonial de la
famille et les successions musulmanes ;
2°) la codification ottomane, en matière de droit des contrats et des principes
d’interprétation par le juge des actes juridiques ;
3°) Le droit des affaires anglo-saxon ;
4°) Le droit des obligations issu de la codification française de 1804.
On pourrait schématiser et proposer une distinction majeure entre:
1- les questions de statut personnel (naissance, mariage, filiation,
succession, etc…), largement soumises à des considérations
(1) Pourtant, des voix s’étaient élevées, ici et là, pour que la Grande Bretagne dote les pays placés sous son
« protectorat » ou sa gouvernance d’un corps de droit écrit.
(2) Le droit civil de l’Irak est fortement influencé par le code civil ottoman. V., par exemple, la
jurisprudence civile irakienne, par Salman BAYATE, éd. Al Ahlya, 1962 (en arabe).

3
religieuses et sacrées, évoluant à des vitesses plus ou moins multiples,
selon les principaux rites de l’Islam(1) et l’intensité des
conservatismes ;
2- et le droit privé en général, où les relations juridiques sont
franchement organisées en fonction des législations européennes,
particulièrement françaises. A tel point qu’au travers des différentes
classifications juridiques arabes, on retrouve les repères du droit
français.
Mieux, on peut relever que, dans les pays visés, suite à la technique
juridique française, le droit public s’oppose au droit privé ; le droit
commercial au droit civil ; le droit administratif au droit civil ; le droit pénal
aux autres disciplines de droit privé, le droit processuel au droit substantiel ;
etc…
Sont ainsi consacrés, dans de nombreux pays arabes, les domaines et les
classifications que le droit français soumet à des catégories logiques et
abstraites. A tel point, que la rédaction d’un dictionnaire juridique français-
arabe(2) répond à des besoins réels et contribue, par ricochet, à une – difficile
– homogénéisation de la terminologie juridique de la langue arabe.
Le rayonnement du droit privé égyptien, dont les travaux d’Al Sanhoury
(fortement inspiré par le traité de droit civil de Planiol et Ripert), n’ont pas
peu contribué à l’édification d’une telle culture juridique française, dans un
environnement pourtant non francophone. Cela a conduit à une véritable
acculturation des systèmes juridiques et du droit de nombreux pays arabes
cultivant dorénavant les concepts du droit français(3) quoique moyennant des
leviers et une terminologie parfois désuets voire problématiques.
Il ne peut être question dans le cadre de cette approche comparative
d’étudier toutes les disciplines du droit privé, pourtant écrit dans les pays
(1) Au Moyen-Orient, ce sont, essentiellement les rites hanafite (applicable aux sunnites en Syrie, Jordanie,
Egypte et au Liban) et jaafarite (applicable aux chiites (en Irak, au Liban).
(2) Le soussigné en a fait l’expérience au quotidien en publiant un dictionnaire juridique français-arabe (qui
en est à sa 9ème édition !) avec la collaboration de deux juristes égyptiens.
(3) Des cours spéciaux d’Al Sanhoury sont publiés en deux volumes (« Les sources du droit dans la doctrine
islamique – Etude comparée avec la doctrine occidentale », 1953 à 1954, éd. Dar Ihia’ el Tourath el Arabi)
et démontrent à quel point le droit français des obligations et de la formation du contrat (autonomie de la
volonté, objet, cause, nullité, effet relatif, résolution…) habite le droit égyptien.

4
arabes. Une telle tentative nécessiterait de nombreux développements
pluridisciplinaires.
En outre, s’il faut, à l’évidence, marquer les différences majeures(1) qui
séparent le droit musulman et le droit civil français – le chareh est
essentiellement casuistique à l’instar de ce qu’était le droit romain –, il reste
que de larges zones de recoupements et de rencontres caractérisent les droits
arabes et le droit civil français, du moins tel qu’issu de la codification de
1804.
Si le droit extrapatrimonial de la famille des pays arabes visés n’accorde
pas un grand crédit aux principes généraux du droit, la codification civile
française reste, dans les autres domaines, omniprésente, sous-jacente ; elle
joue le rôle d’un repère, guidant l’interprète même si celui-ci doit, par
endroit, marquer l’originalité de son droit positif. Le Coran n’est-il pas une
codification par excellence ?
C’est sans doute la raison pour laquelle il est possible de démontrer que
certains des principes directeurs de la codification civile française de 1804
demeurent en vigueur dans le droit des biens et dans le droit des obligations
dans la plupart des pays du Proche-Orient. Quelques exemples suffiront à
illustrer la permanence et le classicisme du droit français, au travers du droit
des obligations (Section 1ère).
Mais les réformes plus ou moins récentes du droit privé français de la
famille demeurent étrangères à l’inspiration de la législation des pays arabes.
L’introduction du PACS, la réforme des droits successoraux du conjoint et
des enfants, celle des régimes matrimoniaux et du « démariage »…, ces
matières restent totalement étrangères aux coutumes et aux modes actuels de
pensée arabe... Cela risque de peser sur l’avenir de la francophonie juridique.
D’autant que la pénétration du droit français par les nécessités de la
« mondialisation » le rend parfois moins attractif (Section 2nde).
(1) Le droit musulman répugne à consacrer la validité des fictions juridiques (rétroactivité, représentation
successorale, etc…) et préfère faire un usage, parfois immodéré des « subterfuges légaux ».

5
Section 1ère : L’influence de la codification civile française en matière de
droit des obligations
Sans prétendre ni vouloir procéder à une étude comparative détaillée,
il est clair que le droit des obligations dans les pays évoqués atteste de
l’influence décisive des principes, sinon des textes du code civil français.
Cela ressort clairement aussi bien en matière de formation du contrat et ses
racines tirées du « patrimoine », que de responsabilité civile – pour ne citer
que quelques matières symptomatiques.
§ 1 – L’autonomie de la volonté et la théorie du patrimoine
On ne peut raisonnablement évoquer le droit des obligations sans se
référer au préalable à ce qui en forme la substance sou jacente, le patrimoine
et certains principes directeurs, dont l’autonomie de la volonté.
Or les opérateurs du commerce international sont souvent étonnés par
la vigueur du principe de l’autonomie de la volonté telle qu’elle est
appliquée dans les différents droits des pays arabes, notamment du Proche-
Orient. D’autant qu’une telle autonomie est souvent consacrée par le droit
anglo-américain.
Bien sûr, certaines lois d’origines socialistes ont contribué à limiter le
domaine de cette autonomie dans les matières ayant fait l’objet d’une
intervention étatique. On sait cependant que ces lois ont largement été – ou
sont en voie d’être – abandonnées, après les récentes transformations dans
certains pays – notamment l’Egypte, l’Irak et la Syrie, dans une moindre
mesure.
Dans certains secteurs où le chareh islamique reste prépondérant
(prohibition des prêts à intérêt, de l’usure, des contrats aléatoires, etc...), la
liberté laissée aux individus reste variable. Plus la législation est proche du
chareh, moins les choix individuels sont libres dans ces domaines
particuliers.
Néanmoins, hormis ces interdits, il est évident qu’au Liban, en
Egypte, en Syrie, dans une moindre mesure, en Jordanie, en Irak, voire dans
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%