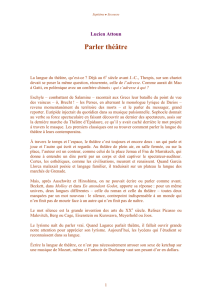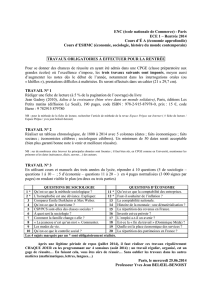Article sur Lucien Goldmann (revue Anamnèse - Jean Ferrette

1
Lucien GOLDMANN
Regard critique sur une œuvre et sa postérité
Le destin de Lucien Goldmann et de son œuvre est singulier : voilà un homme
qui revient en France après la guerre avec pour tout bagage une thèse en allemand
sur Kant. Il parvient en quelques années à diriger un séminaire sur la sociologie de la
littérature en France puis à Bruxelles, s’entoure d’une équipe qui le considère avec
respect, constitue le centre de colloques, inspire des travaux parfois originaux,
parfois dévots, et qui semble malgré tout tombé aujourd’hui dans l’oubli. Si l’on date
le début de sa renommée de la publication de son premier livre connu, « Sciences
humaines et philosophie » paru en 1951, elle n’a duré que moins de vingt ans de son
vivant, pour s’éteindre peu à peu après 1977.
L’apport de Lucien Goldmann à la sociologie.
Lucien Goldmann cherche à construire une sociologie de la littérature qui évite
deux écueils. Celui, positiviste, de la relation entre la position sociale de l’auteur et le
contenu de l’œuvre ; celui, marxiste orthodoxe, de l’identité de la formation sociale et
le contenu de l’œuvre. Les concepts qu’il utilise sont : vision du monde, totalité,
cohérence, maximum de conscience possible, homologie structurale. Selon lui, la
« grande œuvre » est celle qui exprime avec le plus de cohérence le maximum de
conscience possible d’un groupe social. Entre l’œuvre et le groupe, il existe une
relation non pas de contenu mais d’homologie structurale, une « vision du monde »,

2
un ensemble de façon de penser, de percevoir, de réagir, commune à la classe mais
qu’exprime le mieux (ou avec le plus de cohérence) le « bon » auteur.
La conscience sociale qui s’y exprime n’est jamais vraiment celle du groupe social
tout entier : c’est par l’auteur que celui-ci accède à son maximum de conscience
possible.
A l’inverse, les œuvres mineures peuvent faire l’objet d’ une analyse des
contenus telle que la tente le marxisme traditionnel.
Cette distinction entre les œuvres est critiquable. Elle concède trop facilement
une reconnaissance sociologique aux instances de consécration, en faisant
l’impasse sur les procédures institutionnelles voire les connivences. En retirant du
champ de la sociologie les œuvres considérées comme mineures, en les consacrant
comme indignes ne participait-il pas lui-même d’une théorie des œuvres dont la
délimitation lui échappait ?
Le statut de l’auteur est ambigu : si c’est par lui que l’œuvre aboutit, en
dernière instance, l’auteur véritable, c’est le groupe social. L’auteur est à la fois le
traducteur des aspirations sociales d’un groupe dans la mesure où il exprime à la fois
ce qu’il est et ce qu’il souhaiterait être, et à l’origine de cette prise de conscience.
Dans cette mesure, l’œuvre littéraire n’est pas qu’un « reflet » : elle contribue à
construire le groupe social en lui faisant prendre conscience de lui-même.
Lucien Goldmann a-t-il pour autant échappé à la théorie du reflet ? François
Chatelet a écrit qu’ « exprimer », sous la plume de Lucien Goldmann, pouvait être
pris comme synonyme de « refléter »
1
. Mais peut-être faudrait-il distinguer plusieurs
époques chez Lucien Goldmann. Dans ses travaux sur Racine, Pascal et le
Jansénisme, il s’appuie effectivement sur des groupes sociaux existant, une
philosophie, une représentation théâtrale métaphorique des rapports sociaux de
l’époque. Par la suite, il tentera une correspondance entre les formes du capitalisme
et les genres littéraires, que l’on peut juger aujourd’hui très mécaniste. C’est ainsi
qu’il définit trois formes du capitalisme, auxquelles correspondent trois sortes de
philosophies et trois genres littéraires. Citons des extraits de ce passage assez long :
« …pendant la période du capitalisme libéral du 19ème siècle, le développement de la
production pour le marché avait éliminé, à l’intérieur du secteur économique, dans la
conscience des individus, les valeurs supra-individuelles [qu’il avait remplacé] par la
1
François Chatelet, « peut-il y avoir une sociologie du roman ? » Annales, 3, 20ème année, mai-juin 1965, page
502.

3
valeur universelle de l’individu à partir de laquelle a pu se développer la grande
philosophie classique dans ses deux courants principaux : le rationalisme et
l’empirisme [mais] la création littéraire a continué l’ancienne tradition culturelle qui
cherchait le fondement ultime de la personne dans le supra-individuel. […] Le
passage de l’économie libérale à l’économie des trusts et des monopoles avec la
suppression des fondements de l’individualisme qu’il entraînait, créait une situation
où aussi bien la philosophie que la littérature ne pouvaient plus être fondées ni sur
les valeurs trans-individuelles […] ni sur l’autonomie et le développement de
l’individu. […] aux romans de Kafka, Sartre, Camus, correspond un important courant
philosophique, le courant existentialiste […]. La fin de la guerre de 1939-1945
marque un nouveau tournant dans l’histoire du capitalisme[…] la philosophie
dominante de l’époque contemporaine semble se rattacher à un rationalisme[…]. Le
succès de la linguistique structurale est hautement symptomatique […]. De même
sur le plan littéraire, le Nouveau Roman. »
2
Trois stades du capitalisme, trois étapes philosophiques, trois genres
littéraires. Chaque nouveau développement du mode de production s’accompagne
d’une représentation philosophique ou littéraire qui lui est liée, en relation de
dépendance, concordante avec une pensée requise par l’économie. Comment ne
pas y reconnaître le retour de la théorie du reflet ? Ceci signifie-t-il que l’auteur, par
un tour de passe-passe rhétorique, fait tout en disant qu’il ne fait pas ? Sans doute.
Mais ceci n’aurait pu arriver s’il n’y avait un public prêt à l’entendre, un public qui
demandait ce discours.
Et sans doute la force de l’œuvre de Goldmann réside-t-elle, in fine, dans ce
qu’elle autorise, voire suscite, de réflexivité. Si ses hypothèses sont susceptibles de
se vérifier pour tout genre littéraire, alors elles peuvent s’appliquer à elles-mêmes.
Cette œuvre est bien le produit d’un auteur représentatif d’un groupe social. Quel est
ce groupe, comment le caractériser, quelle est sa place dans l’évolution historique,
voilà les questions auxquelles il revient au sociologue de répondre. Comment ne pas
voir dans cette recherche d’un marxisme non stalinien, non sectaire, non fossilisé, le
témoignage d’une époque dominée par la guerre froide et l’hégémonie politique et
culturelle du Parti communiste ?
2
Lucien Goldmann La création culturelle dans la société moderne,éd. Denoël/Gonthier, 1971, pages 107 à 111.

4
Quel parcours en moins de dix ans, depuis Le Dieu caché ! Aux recherches de
l’historien des faits sociaux et littéraires, du philosophe, du dialecticien, succède le
structuraliste de « l’homologie structurale ».
Continuité ou rupture ? La créativité a laissé la place à la répétitivité,
l’innovation à la routine, la dialectique au mécanicisme.
Lucien Goldmann sociologue ?
La formation philosophique de Lucien Goldmann, son style abstrait, son
approche des problèmes, l’influence qu’a exercé sur lui Georg Lukacs, le rangent
aujourd’hui à part dans l’univers des sociologues. Mais de quelle sorte de sociologie
s’agissait-il?
Lucien Goldmann affirmait partir du concept « marxiste » selon lui, de totalité. Cette
posture qui affirme que les parties ne peuvent se comprendre sans leur rapport avec
le tout le rapproche de Durkheim dont il refusait le positivisme. Cette proximité avec
Durkheim est soulignée d’autre part par le recours à la notion de conscience
collective
3
qu’il qualifie quant à lui de « transindividuelle ». D’autres ont vu en lui un
sociologue « actionnaliste» d’inspiration weberienne, dans la mesure où « il
considérait les faits sociaux comme des actions orientées vers des fins »
4
.
A posteriori, la méthode utilisée par Lucien Goldmann nous interroge : peut-on
confondre allègrement la dialectique marxiste avec le structuralisme génétique tel
que l’a mis en œuvre Jean Piaget?
5
Qu’en est-il de la prétention à la science, au-delà
d’une confrontation entre les enjeux sociaux d’une époque et sa production
philosophique et littéraire ?
Certes, Lucien Goldmann a dégagé des pistes passionnantes et renouvelé
certaines interrogations. La manière dont il traite de l’alternative
explication/compréhension devrait fasciner tous les étudiants qui ont planché sur ce
sujet : distinguant deux niveaux, celui de la compréhension (immanente) qui se situe
à un seul niveau d’analyse, et celui de l’explication (transcendante), qui s’exerce
3
Gérard Fabre, Pour une sociologie du procès littéraire de Goldmann à Barthes en passant par Bakhtine.
L’Harmattan coll. Logiques sociales 2001, page 26
4
cf. article « Goldmann » Dictionnaire de sciences humaines, Nathan 1990.
5
Lucien Goldmann écrit dans sa postface à la théorie du roman », page 156 : « Le matérialisme dialectique […]
est un structuralisme génétique généralisé … » Voir aussi la stupéfaction ressentie par Jean Piaget telle qu’il la
relate dans le recueil de témoignages qui lui a été consacré dans Lucien Goldmann et la sociologie de la
littérature, Hommage à Lucien Goldmann, 1975, page 54.

5
entre deux niveaux différents, le niveau supérieur expliquant le niveau inférieur (Voir
schéma infra). La totalité devient alors le niveau de l’explication, la partie celui de la
compréhension. Mais parties et tout sont des notions relatives, elles ne servent qu’à
distinguer des niveaux d’analyse.
Un héritage sans héritier ?
Quelle postérité aujourd’hui pour cet auteur ? Celle-ci est loin d’atteindre le
niveau que l’on aurait pu présumer il y a 30 ans, à sa mort. On peut aujourd’hui
achever un cursus de sociologie jusqu’au doctorat sans en avoir entendu une seule
fois le nom. Les manuels de sociologie, les dictionnaires omettent généralement de
le mentionner
6
. Bourdieu, dans son livre consacré au champ littéraire Les règles de
l’art, ne le mentionne qu’une seule fois, en passant ; et c’est dans un livre de
vulgarisation, Questions de sociologie
7
qu’il exécute en quelques lignes, mais de la
façon la plus développée, la démarche et la méthode de Goldmann. Exécution bien
injuste, pouvons-nous penser avec le recul, d’abord parce que Goldmann
commençait déjà à être oublié, et ensuite parce que la distance entre les deux
auteurs, au-delà des différences de style et de méthode, demande aujourd’hui à être
relativisée.
Sa connaissance semble être l’apanage surtout des sociologues qui ont
accompli leurs études dans les années 60 et 70. Ceux-ci connaissent le plus souvent
Sociologie du roman, considéré par les « spécialistes » de Goldmann comme une
œuvre mineure, son œuvre principale restant Le Dieu caché.
A contrario, la plupart des jeunes sociologues de la culture, qui sont intervenus
en 2004 dans les deux principaux colloques (organisés respectivement par l’AFS et
l’AISLF) n’en ont jamais entendu parler. Sans doute, la distance culturelle entre eux
et Goldmann est-elle grande. Quelles hypothèses émettre pour expliquer ce relatif
oubli ? Défaut dans la transmission, Goldmann n’étant jamais passé pour un « auteur
légitime » en sociologie ? Auteur trop spécialisé dans un genre longtemps en marge,
la sociologie de la littérature, élément d’un autre genre non moins marginal, la
6
Mis à part le livre de Jean-Pierre Durand et Robert Weil Sociologie contemporaine qui lui consacre une page
dans le chapitre «sociologie de la culture», et le dictionnaire Nathan déjà cité.
7
BOURDIEU Pierre « Mais qui a créé les créateurs ? » Exposé présenté devant l’École nationale supérieure
des arts décoratifs en avril 1980, reproduit dans Questions de sociologie éditions de minuit, 1981.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%