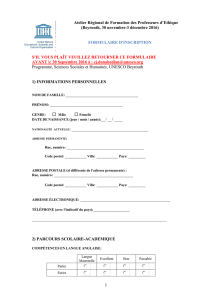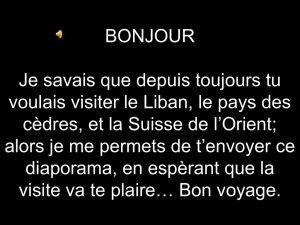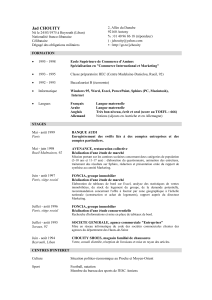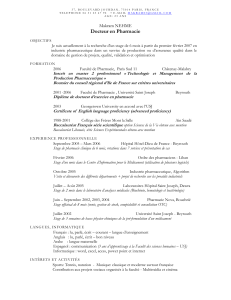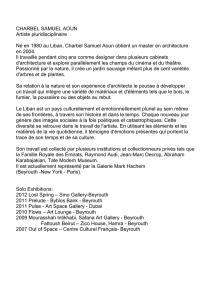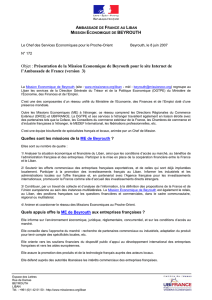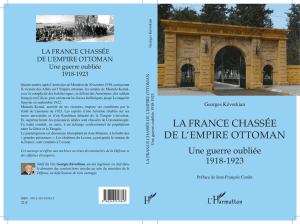Téléchargement

- 1 -
MON PERE
Mon père d’un milieu intellectuel, par ses études, ses voyages, par les revues qu’il
recevait, possédait trois frères, lui étant le plus jeune .
L’aîné, médecin, émigré depuis longtemps en Iraq, y a vécu, y est décédé, il nous
resta inconnu. Cependant un de ses arrière-descendants, Jarco, demeure à Beyrouth
aujourd’hui.
Le second, Pétraki, pharmacien aussi, comme mon père, a dû quitter aussi
Diyarbakir, en 1896, fuyant le programme, pour s’établir avec toute sa famille, sa
femme, sa fille, ses trois fils, Michel, Kosmi , Jean, en Egypte où tous sont morts.
Joseph Pétraki, le quatrième fils, médecin, colonel militaire dans l’armée ottomane à
Beyrouth, a fini par résider à Constantinople avec sa femme, une Grecque, où ils sont
morts sans avoir eu d’enfant.
A ma connaissance, Edouard, un fils du cousin Michel Pétraki, vit en Australie,
marié à une Anglaise (connue durant un séjour en Angleterre).
Kosmi n’a jamais été marié. J’ignore le sort des descendants de Jean.
Le troisième, Vassilaki, fonctionnaire à la Dette Publique ottomane à Smyrne, du
temps des « capitulations » en Turquie, a passé en Egypte, lors de la guerre gréco-
turque avec Mustapha Kémal. Veuf depuis longtemps, il y est décédé en laissant trois
fils : Aleco, Cosmi, Miltiades, tous passés en Grèce après l’événement d’exode
d’Egypte. Que sont-ils devenus en Grèce ? Nous l’ignorons.
Le quatrième frère, mon père, vous connaissez déjà son histoire.
Il est décédé précocement en 1915 à Diyarbakir, à la suite de la grave maladie
contractée, le typhus exanthématique, qui sévit dans tout l’Orient durant la première
conflagration mondiale des années 1914-1918. Cela survint durant ma présence à
Beyrouth.

- 2 -
MA MERE
Ma mère, de souche noble dans la région, avait deux frères.
L’aîné, inconnu pour nous, décédé, a laissé un fils unique établi de longue date à
Smyrne, fonctionnaire à la compagnie du port. Ce fils, en 1922, à la guerre gréco-
turque, à l’invasion de Smyrne, a fui la ville et s’est établi avec sa femme, son unique
fils, ses quatre filles, à Marseille où je ne sais ce que sont devenus ces derniers après
la mort de leurs parents.
Le frère vivant de maman, oncle Rizkallah, que j’ai connu à Diyarbakir, bel homme,
de taille élancée, à belle allure, habitait, dans son immense propriété, une vaste
maison munie d’une grande cour avec un large bassin, avec sa mère, sa femme, son
fils, ses deux filles et sa sœur célibataire, quatrième sœur de ma mère. J’ai connu
dans cette maison, dès mon arrivée d’Alep, assise dans son étincelant lit blanc, ma
grand-mère maternelle, une riante, belle octogénaire, à figure rondelette, rosée, et des
cheveux blancs neige. Elle m’avait reçu et embrassé avec ses tendres lèvres pour la
première et la dernière fois, avant de s’éteindre très peu de temps après.
Laissez-moi vous dire ici que c’est dans cette vaste demeure que les aïeuls de cet
oncle, il y a quelques siècles, avaient majestueusement reçu et hébergé le Sultan
ottoman Murad IV à son passage à Diyarbakir.
Oncle Rizkallah a été déporté comme homme politique chrétien influent et porté par
la suite disparu durant la guerre 1914-1918. Sa famille entière émigrée en Egypte, y a
disparu entièrement dont certains membres par la tuberculose.
Maman avait quatre sœurs.
L’aînée que nous n’avons jamais connue, décédée depuis longue date, a laissé une
fille, Suzanne, devenue Madame Kurkgy à Beyrouth, mère de cinq filles dont l’aînée
Clémentine a été l’épouse décédée de mon frère Ferdinand. Je ne sais comment cette
cousine maternelle, Suzanne, a échoué à Beyrouth pour devenir Madame Kurkgy.
Une seconde sœur, Philomène, devenue Madame Papas, que je n’ai pas vue non plus,
décédée depuis longtemps, a laissé deux filles et deux fils. Les deux filles, émigrées à
Alep, y sont mortes. Alexis a connu à Alep la plus jeune, Khounpouche (khalé).
L’aîné des fils, Youssef, brillant homme politique éminemment cultivé en poste au
gouvernement a été déporté par les Turcs et porté disparu par la suite durant les
années de guerre 1914-1918, comme l’oncle Rizkallah. Le cadet, Abdine Papas,
décédé à Alep a laissé plusieurs fils dont l’un, Edouard Papas, a épousé l’Anglaise
que vous avez connue à Beyrouth chez feue Berthe Sabri.
Puis Sophie Roumi, une tante, décédée à Alep, ayant laissé ses enfants que vous avez
connus à Beyrouth dont il ne reste que la célibataire Marie Roumi, habitant rue
Damas non loin de la Faculté française de Médecine, avec Loutfi son neveu qui est le
frère de Madame Virginie Hakim ( mère de Reina Hakimian). A savoir que Virginie
Hakim est la petite fille de tante Sophie Roumi (elle est la fille d’une fille morte
jeune appelée Vahidé).
La quatrième sœur Minouche qui habitait chez l’oncle Rizkallah avant l’émigration
de sa famille en Egypte s’est éteinte à Diyarbakir.

- 3 -
DIYARBARKIR A L’EPOQUE DE MA NAISSANCE
Ville chef lieu du vilayet (province) turc du même nom, presque à égale distance de
Mossoul et d’Alep, au nord-ouest du premier et au nord-est du second. Bâtie sur le
flanc du parcours du fleuve Tigre, elle est entourée d’une haute et impressionnante
muraille de grosses pierres, érigée dans l’antiquité par les Perses ? les
Macédoniens ? ou par X ? La majestueuse muraille est percée de quatre issues
(portes), Nord, Sud, Est, Ouest. Ville musulmane, sa population est d’environ 50.000
habitants, comptant de nombreux chrétiens à majorité arménienne.
Pour exposer dans l’ordre chronologique les faits et les détails concernant la famille,
les origines de celle-ci, ma vie, et tout autre fait et événement, je vous signalerai ce
que m’a révélé ma mère :
« En l’an 1895, lors de l’exécution du programme du gouvernement turc visant
l’extermination de la population arménienne dans ses territoires, j’étais enceinte de
mon second enfant Milti. En 1896, la terreur battant toujours son plein en ville, mon
mari déterminé catégoriquement à fuir l’atmosphère grave, dramatique du pays
décide d’émigrer avec sa femme, sa fille Eleni âgée environ de deux ans et son
dernier né Milti, âgé de trois mois (c’est donc vers l’été 1896), et de se rendre à
Constantinople où il avait contracté durant ses années de séjour et d’études de
pharmacie, des connaissances et de solides amitiés. »
Cette fuite, dans le feu et le fer, tristement décrite par ma mère, n’a pas été facile et
sans risque. La terreur, les massacres régnant toujours en ville, mon père, acculé à
fuir les lieux, abandonna sa belle pharmacie, livrée au pillage et à l’incendie. Triste
épisode. Maman laisse à votre imagination les lamentables conditions dans lesquelles
fut entreprise et accomplie la migration précipitée de la famille vers la ville visée,
Constantinople. Là, papa, grâce au soutien de ses vieilles connaissances, put
accrocher une place dans l’armée ottomane et fut désigné pharmacien avec titre de
capitaine dans les hôpitaux militaires en Tripolitaine (en Afrique du Nord), territoire
sous la souveraineté ottomane à cette époque.
Je vous épargne la série des détails donnés par ma mère sur le voyage effectué en
1896, en bateaux sur le trajet Constantinople - Tripoli, via le Pirée, Naples et vous
dis aujourd’hui que de cette période de 13 années passées en Tripolitaine c’est-à-dire
depuis la date de notre entrée en 1896, moi bébé, dans ma toute première enfance, à
l’âge de 3, 4 mois jusqu’à celle de notre sortie à l’âge de 13 ans , je ne garde qu’un
vague et nébuleux souvenir des faits et événements qui s’y sont déroulés. Le
caractère dominant de notre séjour en Tripolitaine, c’était au dire de ma mère, dans
l’intention d’assurer l’instruction scolaire des enfants, l’établissement permanent de
la famille à Tripoli, ville principale de la Libye, d’où de par sa fonction officielle,
mon père se trouvait dans l’obligation d’être éloigné et fixé souvent dans les
hôpitaux militaires, loin du centre (à Bengazi, Homs, ou Derna). Aussi j’ai l’image
claire et vivante d’un voyage, à une époque, effectué avec maman, très surveillé par
elle, à dos de chameaux, à travers les vastes dunes du désert libyen, pour aller durant
les vacances scolaires d’été, rejoindre le papa, retenu dans une des régions ci-haut
mentionnées.

- 4 -
QUELQUES SOUVENIRS EPARS DANS LA VILLE DE TRIPOLI
J’ai une nette souvenance de nos successives habitations dans quatre différentes
maisons à Tripoli durant les 13 années de notre vie africaine.
Au premier étage d’une maison située sur la principale artère de la ville, dans la rue
Riccardo, large avenue, je garde deux principaux souvenirs. Au rez-de-chaussée, non
loin des escaliers, dans un large espace, la présence d’une haute balançoire d’où, un
jour de divertissement, j’ai été brutalement projeté en avant, à distance sur les
grosses dalles du parquet. Toujours au rez-de-chaussée, face aux escaliers, la
présence d’une chambre, dans laquelle vivait en permanence un vieillard à barbe
blanche, un condamné à la réclusion à Tripoli, par le gouvernement du Sultan -
Hamid - m’avait-on dit. Quel âge pouvais-je avoir à l’époque, 5, 6 ans ?
La seconde maison située toujours rue Riccardo sur la même ligne à 300 mètres
environ de distance de la première, ne me rappelle rien de saillant.
La troisième maison, dans l’arrière ruelle, parallèle à la rue Riccardo, me rappelle un
capricieux souvenir de mon enfance. Le jeune Nicolas, environ de mon âge, peut-être
9, 10 ans, habitant avec ses parents en face de notre maison, son apparition dans la
rue dès le déjeuner avalé, me signalait par un coup de sifflet sa présence, prêt à
reprendre les jeux interrompus avant le repas, fait qui mettait en colère ma mère,
révoltée par cette insistance à déserter la maison tout de suite après le déjeuner.
La quatrième maison, non loin de la précédente, me rappelle la présence d’une
ordonnance militaire mise à notre disposition pour nous apporter à chaque fin de
mois les denrées attribuées à notre famille (viande, beurre, céréales, etc…) par
l’armée.
Pourquoi tous ces multiples déménagements ? C’était peut-être un régime inhérent
aux dispositions militaires du pays.
MA SCOLARITE
Je fréquentais la grande école italienne très courue à l’époque à Tripoli.
Les cours se pratiquaient en italien, le français était la langue secondaire. Le collège
était situé presque à l’extrémité de la ville. Nous nous y rendions à pied, les livres en
main. Je n’ai aucune souvenance du fait d’avoir vécu dans l’hiver, dans le froid, dans
la pluie. C’était peut-être le climat nord africain, pas froid, pas pluvieux. J’étais un
élève assidu et studieux. C’est à l’âge de 13 ans, durant l’année 1909, que nous
quittâmes la Tripolitaine pour atteindre Alep où mon père nous plaça Ferdinand et
moi dans l’école della Terra Santa en élèves pensionnaires pour l’année scolaire
1909-1910.

- 5 -
NOTRE SORTIE DE TRIPOLITAINE ET LA RENTREE DE LA FAMILLE
A DIYARBAKIR
Pourquoi ce départ d’Afrique et le retour à Diyarbakir ?
Maman expliquait de la façon suivante cette malheureuse initiative : « Papa était las
et déprimé par la surcharge de son travail, sous le poids d’une dysenterie chronique
d’allure rebelle contractée en Tripolitaine. »
Le persistant encouragement par lettres depuis Diyarbakir expédiées par l’oncle
maternel, l’unique frère de maman, proposant à papa de retourner à Diyarbakir où la
situation de la sécurité semblait être solidement établie, avec l’institution du nouveau
régime turc dit « de l’unité et progrès », proclamé par la Turquie nouvelle, l’heureuse
occasion de la présence d’une belle pharmacie libre à être vendue sur la place de
Diyarbakir, ces facteurs, après une longue et mûre réflexion, sourirent à papa pour le
décider à démissionner de l’armée et prendre le chemin du retour pour s’approprier la
pharmacie et s’établir dans sa ville natale.
Ce que je connais partiellement de ce retour : tout en ignorant la raison de notre
départ, je me souviens vaguement en cette année de 1909 d’avoir voyagé en bateau
pour atteindre la première étape, Alexandrie, où nous avons fait la connaissance de
trois de nos cousins paternels, Michel, Cosmi, Jean. Le quatrième, le docteur Joseph
Petraki, médecin colonel à l’armée ottomane était établi à Beyrouth, en poste à
l’hôpital militaire. L’oncle Petraki était déjà décédé. J’ignore totalement le temps
passé en Egypte. Notre seconde étape, toujours en bateau, était Beyrouth. Je n’ai pas
le souvenir d’avoir vu et connu le cousin docteur, ni les Kurkgi, parents par Madame
Suzanne Kurkgi, par notre mère . Suzanne était une nièce à maman, fille d’une sœur
aînée décédée. Ici donc il m’est impossible encore de me prononcer sur le temps
passé à Beyrouth. Peut-être nous l’avons quittée après un court arrêt. Notre troisième
étape, Alep, la dernière pour moi, était atteinte par voie de chemin de fer. Je vous
dirai succinctement que nous y avons habité pour un X de temps, une large maison
quelque part en ville jusqu’à l’heure où papa nous ayant inscrits et placés en
pensionnaires au collège italien della Terra Santa, nous quitta pour Diyarbakir en
compagnie de maman, mon frère Panayoti enfant, ma sœur Marie bébé.
MON ANNEE D’ETUDE A L’ECOLE D’ALEP
Le collège della Terra Santa était d’instruction franco-italienne. A l’âge de 13, 14 ans
cette scolarité de l’année 1909/1910 m’a valu la considération d’un brillant élève qui
à la fin de l’année a pu mériter des prix d’excellence, distribués en grande pompe au
cours d’une séance officielle. Je me rappelle le professeur de français Frère Etienne,
le sympathique, jeune et dynamique religieux à la barbe noire. Mon principal
souvenir à rapporter ici, c’est celui de la distribution au réfectoire, chaque vendredi
soir au dîner, du Halawi que nous savourions avec joie.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
1
/
42
100%