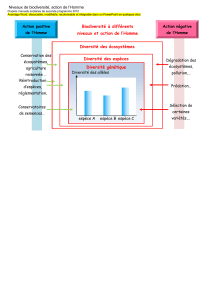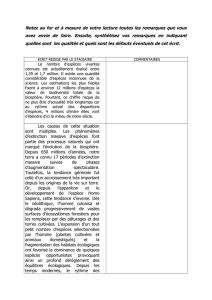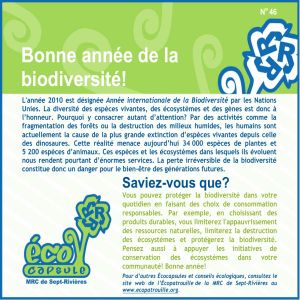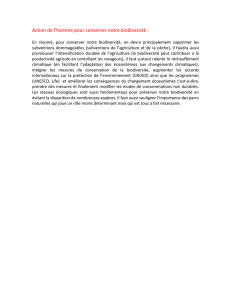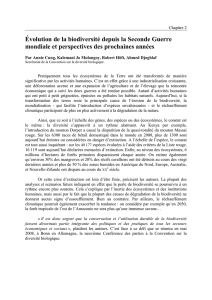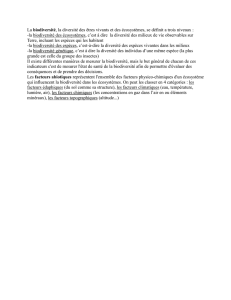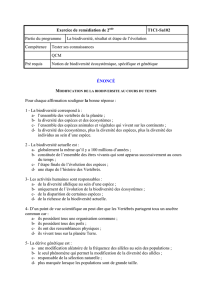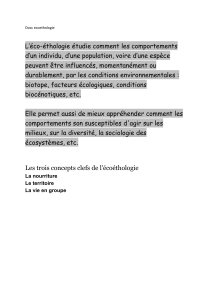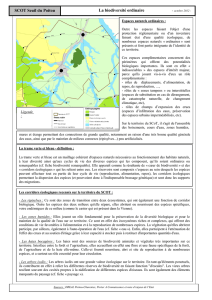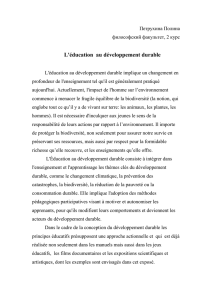[25] Guillaume J., 2010. lls ont domestiqué plantes et animaux

Gérer la biodiversité métropolitaine :
avec ou sans l’homme ?
Christian Lévêque

Cet ouvrage est dédié à Suzanne Mériaux, membre éminent de l’Académie d’Agriculture qui
fut la première femme à présider cette compagnie en 1997. Scientifique de grande valeur et
à l’esprit curieux, toujours prête à relever de nouveaux défis, elle se passionnait aussi pour
la poésie. C’était toujours un véritable plaisir que de s’entretenir avec cette femme
d’exception qui nous manque beaucoup.
« C’est une longue histoire
Il a fallu que l’homme avance
Qu’il émerge de tous ces vivants
Et qu’il arrive à dire
Un peu de la beauté des choses
Et de l’amour qui l’habite
Il a fallu du temps
Pour que le feu s’allume
A l’orient du monde »
Suzanne Mériaux, 2012. Dans la chair du monde. L’Harmattan

Gérer la biodiversité métropolitaine : avec ou sans
l’homme ?
Avertissement
Avant-propos
1 - Evaluer la diversité biologique ? Un véritable casse-tête…
La question controversée de l’espèce
Comment caractériser l’habitat ?
A la recherche d’indicateurs
La diversité biologique invisible en passe d’être démasquée
Qu’en est-il de la diversité biologique fonctionnelle ?
Les bactéries et nous
2 - L’histoire sans cesse renouvelée de la diversité biologique
La mise en place spontanée des flores et des faunes
Les grandes extinctions de masse
Zoom sur l’Europe lors de la dernière glaciation
L’évolution des écosystèmes en phase de recolonisation
Contingence et opportunité, déterminisme et stochastisme
3 - La diversité biologique métropolitaine est une co-production
homme/nature
L’anthropisation progressive de la nature
Une nature « hybride »
Les aménagements détruisent ils la diversité biologique ?
Des hauts lieux de la nature créés par l’homme?
Un héritage en partie menacé par des pratiques héritées de la révolution
verte
Un héritage de plus en plus menacé par l’urbanisation
4 - Réflexions d’un écologue
Le mythe d’une nature vierge
La diversité biologique est contingente
Des systèmes écologiques sur trajectoire
Les difficultés de la prospective
Collaborer pour survivre : mutualisme et symbiose
Les dangers du dogmatisme : Trames verte et bleue

5- Qu’en est-il de l’érosion de la diversité biologique en métropole ?
Petit rappel des fausses prédictions
L’érosion dans le contexte européen ?
Quelques éléments sur la richesse en espèces en France métropolitaine
Zoom sur le milieu marin
Zoom sur les milieux aquatiques continentaux
Faisons le bilan ?
Tous responsables… petites causes cachées d’une érosion
6- Les limites floues de la naturalité
Le fantasme du retour à la nature
Le sauvage en ville
Les paysages: entre nature sauvage et nature patrimoniale ?
La déprise agricole et la fermeture des paysages : l’exemple des
Causses
Touche-pas à mes bocages !
Les forêts méditerranéennes : les filles du feu
7- Les relations homme-nature : un débat qui fait encore recette
L’homme fait-il partie de la nature ?
Des points de vue contrastés sur les relations homme/nature
Les représentations de la nature, ou la nature telle qu’on se l’imagine…
La nature transcendée
Sciences, croyances et expertise ?
9- La diversité biologique: un patrimoine à préserver ?
Une diversité biologique patrimoniale
Comment conserver un patrimoine dans un environnement changeant?
Un héritage confronté à des changements d’usage ?
Quand l’économie se mêle de gérer la nature
Une nature pour les hommes ?
9- peut-on piloter les trajectoires de la nature ?
Les capacités prédictives de l’écologie sont limitées…
Agir en univers incertain : des mesures « sans regrets » ?
Vers de nouveaux écosystèmes ?
La mise en scène de la diversité biologique : la nature jardinée
De la biomanipulation à l’écologie de synthèse ?
Quelle diversité biologique voulons-nous ? Qui décide ?
Et si on redonnait la parole aux citoyens et aux acteurs du terrain ?
Ecoland et la mise en scène de la nature ?

10- Essayons de résumer…
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
1
/
138
100%