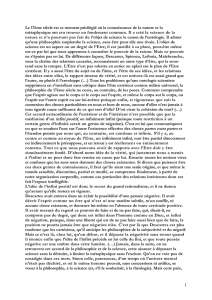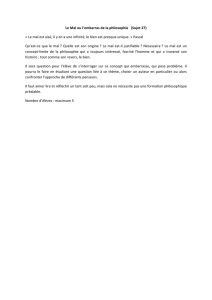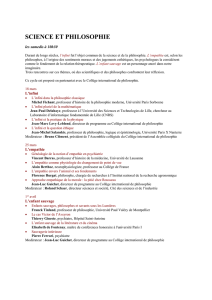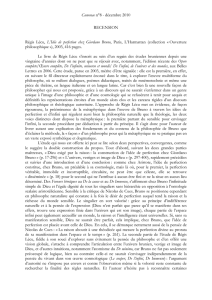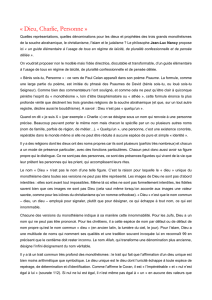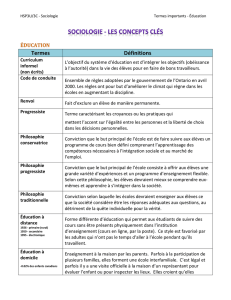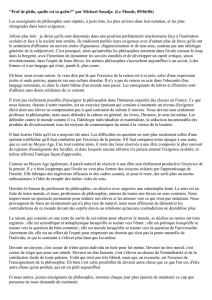philosophie d`une existence

PHILOSOPHIE D’UNE EXISTENCE. EXISTENCE DE LA
PHILOSOPHIE.
L’ESTHETIQUE PHILOSOPHIQUE
DE GIORDANO BRUNO
p a r C l a u d e - R a p h a ë l S a m a m a
Voudrais-tu donc avoir l’éternité comme un enfant et
sommeiller, pareil au néant ?
Ignorer la victoire ?
Ne pas courir au terme de toutes perfections ?
Hölderlin
Que plutôt ta nature explore les hauteurs
car au contact de Dieu, tu seras feu ardent.
Giordano Bruno
La philosophie de Giordano Bruno représente un corpus paradoxal, partagé entre une place parfois marginalisée dans la
pensée occidentale et une fascination pour une figure de l’esprit qui ne se dément pas. Ses intuitions d’un infini cosmologique
paraîtraient-elles aujourd’hui banalisées par les avancées de l’astrophysique ? Sa métaphysique panthéisante et vitaliste datée,
le caractère non académique de ses oeuvres autant qu’un système apparemment peu formalisé, ne plaideraient-ils plus que
pour une postérité mineure ? A l’appui de telles assertions on trouverait déjà les jugements d’un Bayle, de Hegel ou celui plus
récent, même si ambivalent, d’un Koyré1. Faut-il à l’inverse, rejoignant une image commune, retenir l’attirance pour un
martyr de la vérité résistant jusqu’au bout à tout dogmatisme ? Son procès et sa fin spectaculaire sur le bûcher de l’Inquisition
en l’an 1600, ajoutent bien une note tragique à la carrière du philosophe et autoriseraient d’en faire un symbole de la liberté
de pensée et de la fidélité à soi contre toutes les compromissions. Incontestablement cette figure est celle qui souvent prévaut
et continue de hanter l’histoire de l’Eglise comme celle du devenir occidental. Sur cette voie paraîtraient les figures de
Diderot, Gœthe ou Schelling relevant l’héroïsme intellectuel du maître et plus tard, du côté cette fois idéologique, diverses
formes de récupération 2.
Une véritable herméneutique philosophique ne saurait pourtant se contenter des jugements circonstanciels ou péremptoires, ni
d’ailleurs s’en tenir aux lectures érudites mais partielles, qui sont légion. Le foisonnement du commentaire autour d’une œuvre, on le
verra singulière, autant que la facile vulgarisation, ne finiraient-ils pas par cacher l’essence de la pensée et peut-être son inspiration qui,
au delà de ses traces dans l’histoire réelle, continuerait d’être vivante et surtout disponible ? La philosophie du Nolain pourrait bien être
le pertinent paradigme de ce qu’une pensée peut laisser en héritage, certes dans le cours des idées, mais encore en soi et comme espace
spirituel construit. Si la philosophie de G.Bruno est incontestablement une philosophie de l’existence – et pourquoi ne pas risquer à son
propos, un certain « existentialisme » avant la lettre – quel statut philosophique peut-elle donc avoir aujourd’hui ? En quoi la modernité
peut-elle trouver en elle des éléments propres à s’en nourrir, la prolonger ou en extraire la force vive d’un système toujours vivant ?
Si une telle pensée doit encore enseigner ou enrichir un patrimoine, elle pourrait s’articuler autour de ce qu’on désignera
comme une esthétique philosophique et dont il faudra établir la notion. On entendra par là et tout en même temps, une
manière de penser personnelle et conquérante, l’énoncé d’un naturalisme libérateur déclinant la thèse transgressive d’un
infini conséquent3 et heuristique aux plans de la cosmologie, de la matière et de la vie, un procès noétique dans lequel la
connaissance est une dynamique d’engendrement, un polymorphisme expressif, enfin, où l’art le plus haut contribue à la
forme d’une vision signifiante et ouverte de la totalité. Ainsi pourrait être caractérisée une œuvre originale, séduisante et
fertile qui oscille entre la puissance de ses thèses métaphysiques, politiques ou morales et un style, c’est à dire l’élaboration
singulière et productrice de sens nouveaux, l’élargissement de l’horizon philosophique et de la teneur du penser, l’assomption
d’un destin intellectuel s’inscrivant dans la haute culture européenne.
Le corpus des œuvres. Discours, langues et lieux
On ne reprendra ici ni l’analyse détaillée des œuvres auxquelles on renvoie le lecteur, ni leur exégèse commentée. On a
déjà dit que les éditions savantes étaient nombreuses, surtout en langue italienne. Une approche synthétique ferait apparaître
deux séries qui chronologiquement furent écrites d’abord en latin, mais encore ainsi jusqu’en 1591, puis majoritairement en
langue vulgaire italienne à partir de 1584.
Les œuvres latines, souvent en formes de poèmes, sont consacrées à des sujets de philosophie théorique. On peut retenir
par exemple, outre déjà les thèmes de l’infini (De immenso et innumerabilibus ; De monade numero et figura), celui de la
faculté d’imagination (De imaginum compositione), de l’entendement imaginaire (De umbris idearum) et le plus connu
d’entre eux lié à la mémoire et aux moyens de la renforcer qui, en son temps, rendit Bruno célèbre (Ars memoriae). Plusieurs
de ces ouvrages seront publiés à Paris, Londres, Francfort ou Prague.

Ses œuvres en italien sont classées dans l’édition Gentile en deux grandes séries :
a. les dialogues métaphysiques regroupant : Le souper des cendres ; De la cause, du principe et de l’un ; L’ infini,
l’univers et les mondes ;
b. les dialogues moraux comportant : L’expulsion de la bête triomphante ; La cabale du cheval pégaséen ; Les fureurs
héroïques.
Une partie d’entre elles est rédigée et publiée à Londres où sa réception ne fut pas le plus souvent sans soulever le
scandale ou l’indignation que Bruno lui-même rapporte, par exemple dans Le souper des cendres.
Bruno écrira aussi une pièce de théâtre en italien, la comédie publiée à Paris et intitulée il Candelaïo.
Son procès, quant à lui, donnera ultérieurement lieu à une importante littérature où témoignages et archives restées secrètes jusqu’à
ces dernières années nous renseignent sur ce que retint à charge l’Inquisition et comment évolua son cours, de Venise en 1592 à Rome
le 17 février 1600, année sainte de Jubilé, Clément VIII regnante.
A ce point peut-on déjà retenir la variété des thèmes où l’écrit philosophique ne craint pas, pour convaincre et démontrer,
de prendre le plus souvent la forme du dialogue contradictoire et vivant, d’user de celle des poèmes et parfois du dessin, de
s’exprimer dans une langue d’accès facile, imagée, alerte, entraînante, allant parfois à la satyre où la verve d’un Rabelais
n’est pas loin (Chandelier ; Souper des cendres), usant de l’allégorie subtile et salutaire (Cabale), séductrice (L’infini),
tacticienne et politique (Expulsion), ou inspirée ( Fureurs).
On propose de donner dans ce qui suit l’idée d’une lecture non-traditionnelle de l’œuvre, entre une « esthétique » – au
sens d’une forme originale, prégnante, inventive – et une « philosophie » revendiquée comme conception ouverte d’un
monde pluriel, vivant et créateur, cosmologie spiritualisée par certains aspects mais non religieuse dans son contenu, discours
en fait d’un ré-enchantement du monde.
Rompant de toute part avec la scolastique académique et ses dogmes sinon ses références ultimes et incontestées –
Aristote et son monde clos mais aussi Platon et son mépris de la matière – docteur sans chaire, « académicien de nulle
académie » comme il le dit lui-même, jamais chevalier plus errant du savoir ne contrevint plus au respect des dogmes établis
et à la supposée vertu de la Tradition. Moine défroqué, converti puis brouillé avec la Réforme calviniste, chercheur au sens
moderne, éditeur proche des luthériens, polygraphe parisien, homme de cour à Londres, savant reconnu, poète, dramaturge,
théologien, cosmologiste avant tout et homme du verbe plutôt que grammairien, rebelle d’une conscience toujours pure
devant ses accusateurs – qu’on relise les Actes de son procès –, Bruno est cet individu complet et en plénitude d’une
Renaissance finissante qui annonce l’inquiétude et le prométhéisme (Spengler) des Temps modernes ou la sécularisation du
salut (Löwith). Peut-être même avant tous, est-il l’initiateur d’un mouvement de l’esprit qui conduira à l’intuition d’une
certaine « mort du Dieu »4 et la naissance possible enfin du vivant se sachant lui-même. S’ouvrant possiblement à la joie
d’être (Spinoza), à la tâche d’appeler l’homme nouveau (Nietzsche), à la pensée de la déréliction et du souci (Heidegger) ou
celle ironique et joyeuse des « jeux du monde » en quoi les chemins de la modernité en devenir s’exposent au passant de
l’univers (Axelos).
Humaniste, philosophe et métaphysicien, Bruno est peut-être d’abord écrivain et poète, polémiste, inventeur de nouvelles
représentations, artiste – « Socrate musicien » si l’on veut, au sens du Nietzsche de la Naissance de la tragédie –, penseur
original de la tradition occidentale, inventeur d’idées et de mondes. Même si sa place au sein de l’histoire de la philosophie
en France reste à ses marges, même s’il conviendrait de distinguer les traditions nationales où l’italienne, l’anglaise et
l’allemande l’établissent peut-être mieux, Bruno ouvre à la pensée des perspectives et des formes neuves auxquelles son
étonnante existence donne le sceau de l’authenticité. Comme le dit Diderot : « Les lignes tracées avec le sang du philosophe
sont bien d’une autre éloquence » (Corresp. T.IX.) ou encore Gœthe désignant Bruno « d’apôtre vivifiant de la pensée » (voir
le Faust) ou plus près de nous un Ernst Bloch apercevant dans la manière du Nolain une pensée tendue et anticipatrice (Cf.
Philosophie de la Renaissance).
Une carte des lieux où s’installa, s’enfuit ou résida provisoirement Bruno, en finalement si peu de temps – moins de dix
ans – donne pour l’époque un certain vertige. De Naples à Genève, de Rome à Toulouse, de Paris à Londres, de Wittenberg à
Francfort ou Prague, puis Venise et Rome encore… Une vie de monastères en collèges ou académies, de villes lointaines en
capitales européennes, de soutenances de thèses en disputes académiques, de châteaux en palais royaux, de couvents en
auberges, de cours d’ambassade en geôles de l’Inquisition. Le plus exceptionnel est qu’il publia plusieurs de ses oeuvres dans
les pays indiqués, parlant sans doute français avec le Roi de France (Henry III), l’anglais avec la Reine d’Angleterre
(Elisabeth I) ou la langue de Luther avec ses éditeurs allemands.
Une telle figure offrirait de l’Europe, en fin de sa période renaissante, à l’orée de la modernité et du temps de la science,
une image d’homme libre, héroïque, ouvert à la connaissance et à ses risques, multiplié en ses possibles de pensée, de révolte,
de quête d’une idéale sociabilité, d’affirmation de soi et d’imagination du futur.
Les thèmes du discours et ses dimensions
La philosophie
Notre introduction a observé la place modeste de Bruno dans l’histoire de la philosophie, du moins en une certaine
tradition intellectualiste française. Le Nolain ne semble pas inventer au premier abord de concepts en propre 5, n’avance pas
apparemment de science nouvelle à la manière d’un Bacon, n’offre pas une méthode à même de rationaliser par calcul le
monde ou systématiser une cohérence du sujet, ce qu’un Descartes tenta de faire. Le discours, marqué par les conceptions
d’un temps, cependant les dépasse. Il est à ce titre précieux pour l’histoire, et si système il y a, ce dernier vaut plus par un
mouvement et une forme, en la cohérence profonde d’une majeure intuition.

Plus qu’à une philosophie d’académie ou d’école, celle de Bruno pourrait s’apparenter à l’arkhè socio-transcendantale
d’un temps exceptionnel en ses enjeux, à une sensibilité spécifique et comme empreinte de prophétisme séculier, à un mode
de penser du « seuil » (Blumenberg) précédant une époque nouvelle, à la génialité enfin, d’un langage propre et d’une
existence d’exception. Ceux-ci ne furent pas n’importe lesquels, puisque tous au service d’une conviction de l’esprit comme
puissance conquérante, connaissance à acquérir opposée au dogme, déploiement ontologique ou source d’une nouvelle
cosmologie, foi intime en la liberté de l’homme. Bruno assuma jusqu’à la mort ces principes, en une époque où penser par soi
était le risque suprême et où les hommes se disputaient en des guerres cruelles, les dépouilles religieuses d’une divinité plus
tolérante en mal d’espace et de lointains.
Comment alors qualifier une telle pensée par delà le temps et quel statut lui faire face à l’académisme toujours de
rigueur, à une histoire de la philosophie parfois arbitraire, qui aurait pris tel pli ou retenu seulement une tradition de trop
extrême rationalisme dont pourtant le Nolain participe à sa manière ?
Sa Nuova filosofia à lui est d’abord une critique en règle des conceptions du monde clos, limité, de son temps. La
cosmologie ptoléméenne, celle du géocentrisme et de la sphère étoilée des fixes héritée d’Aristote, du pur éther où devaient
résider les dieux et où le Moyen âge placera ses anges (Saint Thomas), est battue en brèche et refusée au nom d’une
philosophie plus ouverte et créatrice. Lecteur de Nicolas de Cuse, puis de Copernic, Bruno voudra offrir la vision d’un
univers sans limite d’aucune sorte. Infinitiste conséquent, ce qu’attestent de manière récurrente la plupart de ses Dialogues, il
tirera assez vite de la représentation de l’infini – catégorie intellectuelle insuffisamment comprise par son temps – des
caractères jusqu’à lui inaperçus en leur conséquence cosmologique mais aussi noétique6.
La finitude bornée de l’espace du cosmos aristotélicien, ses sept sphères déployées autour de la terre immobile,
enveloppée par la voûte ultime des étoiles fixes du monde supra lunaire, sa clôture supposée parfaite, traduite en cyclicité
astrale et mouvement éternitaire mu par un premier moteur assimilé à Dieu, lui paraîtront contredire les notions elles-mêmes
de Cosmos et de Divinité qui par définition n’ont pas, ne peuvent pas avoir de limites. Conçue dans ses potentialités
ontologiques et la réalité même où elle peut prendre corps – en tant qu’elle engloberait ce corps lui-même – la notion/réalité
de l’infini, sera la clef de voûte de la cosmologie brunienne, mais aussi d’une ontologie, d’une phénoménologie naturelle et
d’une spiritualité à cette mesure.
Influences et thèses
Nicolas de Cuse avait fait émerger la possibilité d’une conjonction de l’infini avec le fini dans sa célèbre théorie de la
coincidentia oppositorum. Sa doctrine de la Docte ignorance préservait le mystère de cette possibilité d’expérience et le salut
dans la croyance qui garantit l’invraisemblance du miracle des opposés coexistants. Le mélange fini/infini devenait alors
pensable et non contradictoire, et remettait aussi en cause la logique scolastique impérieuse du tiers exclus. Elle ouvrit
incontestablement à Bruno la perspective d’une transgression des conceptions finitistes dominant encore largement l’époque
et une voie propre à redéfinir la conception de la nature du monde, sinon de l’être. Le Cusain lui-même, tout en introduisant
la conjonction de certains caractères d’infinité avec ceux de la finitude des créatures – par exemple l’accord permanent, pas
seulement mathématique, d’un minimum et d’un maximum –, n’en tire pas toutes les conséquences quant à la véritable
dimension du cosmos et la nature véritable du divin. Si le monde est manifesté dans des opposés quantitatifs et qualitatifs, il
reste dans le mystère de sa compréhension ultime où seule la foi peut faire accepter la contradiction dans le monde et ouvrir à
une sagesse médiane.
Le système héliocentrique copernicien, quant à lui, reste étonnamment encore finitiste. Si même il dépossède la terre de sa
centralité, il n’entraîne pas la remise en cause de l’ordre fini du cosmos – son infinitisation – et du coup, maintient une
création divine limitée au visible de la sphère des fixes d’Aristote et de Ptolémée. On sait que Galilée lui-même et au-delà
Newton n’allèrent pas jusqu’à ouvrir la cosmicité du monde à son illimitation7.
Le postulat invoqué de l’infinité cosmique est donc bien une des clefs du système brunien. Il ne pouvait que renvoyer par
ailleurs à un être identifié à lui, avérant sa possibilité en extension mais aussi en compréhension. L’infinité ontologique
implique un principe infini actif dont dépend l’ensemble jamais achevé des modalités du fini. Plus. Un tel être sous peine de
se limiter, ne peut qu’être conçu comme engendrant à l’infini une multiplicité d’existants. Une cause efficiente de tout
devient nécessaire, sans que ce tout puisse jamais trouver de limite à une telle essentialité (sa nature, inaccessible en soi mais
pensable) mais aussi d’achèvement à une telle existence (son être réalisé, l’étantité réelle de cet être, ce qui est par lui et de
lui en tout étant). Le traité De la Causa, principio e uno poussera cette logique jusqu’à faire de la « cause » ultime une âme
vivante, spirituelle, et matérielle aussi puisqu’elle s’incarne, se crée et vit multiplement. Ceci rejoint la thèse cusaine de la
coexistence des opposés (fini avec infini, maximum avec minimum, multiple avec un, vie avec mort, beau avec laid, petit
avec grand…) et reste cohérent avec l’essence de l’infinité qui ne peut résider qu’en l’un, caractère équivalent de l’infini.
En effet, l’infini en soi ne peut être qu’un, sous peine de n’être pas lui-même ou de n’être plus, car la moindre restriction à
son principe pourrait corrompre, limiter ou diviser son essence et sa réalité ultime. Il est la totalité unifiée comme
asymptotiquement par sa non-finitude, le résultat incontournable d’une progression sans fin, donc sans limite de puissance ni
d’acte. La « cause » une et infinie est aussi source du multiple et de la diversité observée qui ne peuvent que renvoyer à elle,
car sa définition les contient. Le Tout-Un comme cause s’exprime dès lors dans une multiplicité dérivée et active, qui en
permanence y renvoie – à la différence de la conception plotinienne, émanatiste et passive –, et où toute création n’est que
stase dégradée dans une échelle verticalisée de l’être.

La divinité abstraite des philosophes, celle révélée de la religion chrétienne, seront ainsi remplacées par le principe d’une
« âme de l’univers » – pas seulement démiurge du monde connu – mais infiniment créatrice d’une pluralité d’univers où le
nôtre n’est qu’un des possibles. Source infinie de la matière comme de la vie issue d’elle nécessairement, la cause une, est
pour reprendre la célèbre expression du Cusain : « Une sphère dont la circonférence est partout et le centre nulle part »8. La
matière et la vie l’exprimeront, produisant par définition l’innombrable des formes matérielles et vivantes données dans la
nature, sans que celle-ci épuise les infinies potentialités de ce qui la produit. « Mais en vérité le séjour de Dieu est partout
dans l’univers tout entier et dans le ciel immense, dans l’espace vide dont il est la plénitude. Lui le père de la lumière qui
contient les ténèbres, et qui est ineffable. » (De immenso, IV,14).
Une telle conception ne pouvait qu’entraîner, après le rejet de la finitude du cosmos, l’idée d’une divinité d’une autre
nature, ouverte, pleine, limitée par rien, assumant son infinité sans limite de puissance créatrice d’une infinité d’univers, par
sa définition même. L’observation du nôtre, animé, vivant, créé et créant à son échelle, ne pouvait qu’induire, dans cette
intuition, la logique d’une duplication ailleurs de ce qui fut une fois possible et indéfiniment. D’où l’idée, à l’époque
difficilement recevable, de l’infinité des mondes.
«Pourquoi frustrer la capacité infinie, entraver la possibilité d’exister à des mondes innombrables et nuire ainsi à
l’excellence de l’image divine qui devrait resplendir de tout son éclat en un miroir multiplié et suivant le mode de son être
immense et infini. » (De infinito, I,G. 289, in Namer,158). Logique impeccable ouvrant à l’affirmation d’une auto-production
de l’univers infini par une divinité de même nature, transformant la place de l’homme dans le cosmos, ouvrant l’esprit à une
libération dans le temps, l’espace et en lui-même, dans le nouveau voisinage d’un autre sentiment de Dieu.
La place du système et sa compréhension
Toute pensée s’inscrit dans une époque. Qu’on imagine ce que de telles prémisses pouvaient entraîner, eu égard, on l’a vu,
à l’univers clos d’Aristote et des Scolastiques, mais aussi vis-à-vis du dogme chrétien et des conceptions d’un monde
restreint où la Vérité était tenue des Ecritures. Dieu lui-même s’y limite et s’y enferme et le salut n’est acquis justement qu’à
travers la médiation de la finitude christique divinisée ou à travers une mondanité rapportée à un univers fini ou magique de
correspondances ésotériques et de signes à capturer. Seule la foi – comme cela se retrouve à l’époque bouillonnante
d’occultisme de Bruno ou de combat pour la foi, mais encore dans toute la philosophie classique, de Descartes à Pascal,
Leibniz ou Malebranche –, seule la foi en effet, pouvait s’opposer aux arguments de la raison, et si l’on peut dire à la propre
infinité de celle-ci, en tant que rien ne peut venir limiter le progrès de sa lumière et de son expansion. Pour un temps
seulement il est vrai et avant que la science mathématicienne et expérimentale ne ruine toute espérance de vérité hors d’elle !
Spinoza sera peut-être, un peu plus d’un demi-siècle plus tard, celui qui tirera d’une telle idée, un système, s’attachant plus, il
est vrai, à préciser la nature de la substance infinie et sa relation à ses attributs et leurs modes, dont l’homme évidemment
participe. Incontestablement en une même communauté de pensée.
Bruno se libérera sur la forme et sur le fond de toute médiation unique vis-à-vis du divin. Ses écrits combattent ce qui
s’opposait à cette intuition première d’un monde ouvert, vivant, illimité, relié, avec les conséquences d’un tel déploiement
pour la vérité en soi, le destin de l’homme et une familiarité nouvelle avec la Divinité. Repoussant le dogme chrétien qui
limite sa vision des mondes pluriels, rejetant l’antique philosophie cosmiquement close, il gardera la grande métaphore des
dieux antiques, mieux à même de faire entendre à ses contemporains – avançant ainsi masqué – la divinité de l’homme et
l’humanité des dieux, jouant aussi de leur dialogue et d’un autre destin possible à l’horizon infini de l’humanité.
Certes la forme du discours – nous y reviendrons – ne s’en prend jamais de front à l’adversaire et on verra aussi comment
la rhétorique, la forme mythologique et l’allégorie, permettent de contourner l’affrontement. Avant que le procès ne vienne
interrompre ce qui déjà ébranlait un édifice.
Il serait trop long de rappeler ici le contexte historique et religieux de l’Europe à la fin du Seizième siècle. Réforme et
Contre-réforme s’affrontent de manière parfois sanglante et entraînent la politique des royaumes, en France et en Angleterre
mais aussi en Allemagne, Suisse, Pologne ou Bohême. Bruno s’en serait mêlé, tentant ici de promouvoir, à l’encontre de
Rome, une tolérance mutuelle opposée aux « guerres de religion », mais surtout une conception de la Cité et du monde
ouverts à un système plus universel de valeurs9. Comment comprendre sinon des oeuvres comme La Cabale ou L’expulsion,
ouvrages de réforme politique, certes allégorisés ? Comment ne pas être intrigué encore par le passage de Bruno du
catholicisme au protestantisme puis son abandon et d’autres hésitations dont le moindre reproche n’était pas, raison souvent
invoquée par lui, le seul « salut par la foi » et dès lors la dispense des oeuvres terrestres. Si cette perception reste partielle, car
la Réforme ouvrira la question abyssale du travail rédempteur et du gain économique salutaire où la vocation de l’Occident
est encore immergée, sa modernité, certes renaissante mais anticipatrice de l’esprit des Temps modernes, n’en reste pas
moins incontestable.
Retenons qu’une intuition centrale, ici celle d’infini onto-cosmologique conséquent, entraîne dans son sillage l’ensemble
d’une conception où il y va d’une remise en cause des représentations fermées du cosmos et du dogme de la religion
christique, mais tout aussi bien de la vocation de l’homme et du monde où, d’autre façon, elle pourrait se déployer. C’est tout
le projet réformateur de L’expulsion.

La thèse, soutenue en particulier par Frances Yates, consistant à voir dans Bruno un « mage de la Renaissance » (sic),
reprenant à son compte les discours de l'hermétisme si répandus en son temps – en particulier celui de la Cabale chrétienne –
et faisant siennes les pratiques ou spéculations cosmologiques, astrologiques, magiques de ses contemporains, constitue selon
nous une interprétation erronée. Si bien sûr, Bruno est un lecteur, comme tout érudit de son temps, d'Hermès trismégiste, de
Reuchlin, d'Agrippa de Nettesheim et de tant d'autres occultistes, s'il fut l'ami de John Dee ou visita le « Cabinet des
Merveilles » de Rodolphe II à Prague, si parfois il ne peut échapper à la langue10 de son temps – à la prégnance forte d'un
ordre synchronique du discours –, en aucune manière il ne verse dans la divination, jamais dans la prophétie ou un
quelconque projet de magie ésotérique ou de déchiffrage secret du monde. Sans doute s'y est-il intéressé, a-t-il eu besoin de
dialoguer avec ses contemporains, à aucun moment il ne semble le céder aux fables du sacré occulte (ou d’un astral pris à la
lettre) ou encore des correspondances arbitraires et foisonnantes, proclamer tenir les clefs d'un sens caché ou écrit du monde,
imaginer que les constructions symboliques de l'hermétisme aient une quelconque efficace (de M. de Nostredame à
Pistorius...). Une certaine rationalité –même si plus intuitive que scientifique, encore qu'il soit fondamentalement copernicien
– reste toujours la marque de Bruno. Sa « magie » n’est, compte tenu du temps qui est le sien, qu’une technique de « science
humaine », de perfectionnement du discours ou de la pensée, de meilleur fonctionnement des pouvoirs de l’homme et des
liens (vinculi) qui l’unissent aux autres et à lui-même, sous des procédés logiques et combinatoires d’optimisation.
Si l'on devait néanmoins vouloir le tirer vers le courant mystique et mystagogique, il faudrait plutôt le faire dans le sillage
d’un Léon l'Hébreu, auteur inspiré des Dialogues d'amour, magistral et subtil passeur de l'inspiration vivante et infinitiste de
la Cabale juive au sein de la chrétienté, mais aussi penseur d'une synthèse brillante de l'hébraïsme biblique et des deux
systèmes majeurs de Platon et d'Aristote en une lecture réconciliatrice dont son temps lui fit le plus large écho. Là encore
l'infinitisme brunien rompt avec les illusions crédules des univers clos du finitisme et leur déterminisme angélique, astral ou
symboliquement analogique, renaissant.
A côté de « l’existence d’une philosophie » comme contenus formels, mise en jeu dialectique ou invention de concepts,
interprétations l’accompagnant et place dans une histoire, en quoi et comment une certaine « philosophie de l’existence » –
au sens de sa « situation » et des choix qu’elle opère et pour autant qu’elle en constitue une, ce qui est le cas nous semble-t-il
– peut-elle maintenant instruire, dépasser un horizon, annoncer ou déjà franchir le « seuil » d’une époque nouvelle, donner à
penser de manière vivante, c’est à dire grandiose et sinon totalisée, en voie de l’être en un asymptotique mouvement ? De
quelle manière et avec quels moyens, anciens ou neufs ? L’expression retenue, le style, les formes démonstratives, le genre
littéraire, le mode de la composition, le niveau de langue ou son registre et son choix lui-même, la règle rhétorique ou son
rejet, la stratégie démonstrative n’influent-t-ils pas d’autre part, sur la manière dont sera reçu le discours et restera inscrite la
thèse ? Quels autres aspects dès lors retenir ou mettre au jour, en complément ? Et leur statut ?
Une esthétique philosophique
Infinité
Si l’infini, tout au long du Moyen âge, est une notion pratiquée – n’allant d’ailleurs jamais au delà de sa représentation
antique sous la forme d’un illimité ou d’un signifié inatteignable, chez Saint Anselme par exemple en son célèbre argument
ontologique qui reste dans la logique d’une représentation, ou chez Saint Thomas qui l’admet en en réduisant singulièrement
la perspective mondaine et l’efficace ontologique dans un univers physique qui reste ptoléméen –, il devient chez Bruno
d’une heuristicité redoutable.
Il n’est pas ici seulement une idée (celle que livrera Descartes en sa Troisième Méditation) ou une notion à la limite (celle
de « maximum » mathématique ou réel chez Nicolas de Cuse), mais une réalité nécessaire et fondatrice en même temps qu’un
mouvement de la pensée qui n’a de cesse. L’infini est pour Bruno un principe de raison avec la logique qu’il entraîne, une
représentation mentale non statique, active, spirituellement dynamique par le mouvement qu’elle induit, et tout autant est-il
une cause nécessaire, une réalité physique. Il le démontre encore d’une induction à partir de la variété innombrable des étants
observables, dans la réalité constatée de l’expérience mais aussi dans celle projetée du possible. Il s’en assure dans une
déduction non contradictoire avec l’ontologie, cette fois ouverte et vivifiée, et pas seulement d’une représentation abstraite11.
Bruno amène ici à coïncider des opposés d’apparence cusienne, mais en les plaçant dans le cadre d’une savante
connaissance cette fois, qui fait l’économie de la foi, de la révélation et de l’Ecriture, se libère du recours à la finitude
salvatrice de l’Homme-Dieu ou d’une quelconque médiation nécessaire à l’accès au divin. Comme le dit Koyré : « Pour lui le
mouvement et le changement sont signes de perfection et non d’absence de perfection »12. S’imagine-t-on aujourd’hui
encore la portée d’un tel mode de pensée où se trouvent réfutées, rejetées comme inutiles les Autorités théologico-politiques
– pour reprendre le terme spinoziste – qui à l’époque constituaient un appareil intellectuel et institutionnel dominant,
impérial, uniforme, considéré comme seul pourvoyeur de La vérité ? Entre la cosmologie universalisée gréco-latine ou arabe
issue d’Aristote, le magistère chrétien dit infaillible de Saint Thomas et la puissance de la papauté arc-boutée à sa contre-
réforme. La puissance d’un discours se mesurerait ici à ses obstacles.
1
/
5
100%