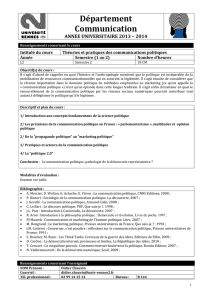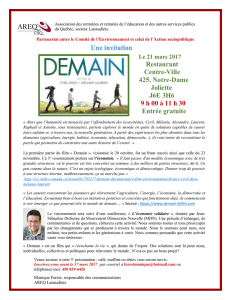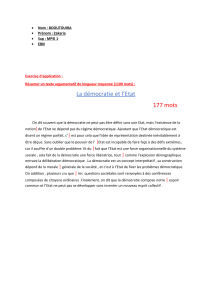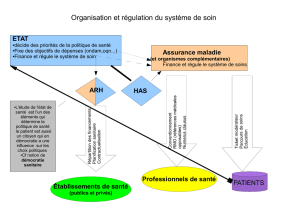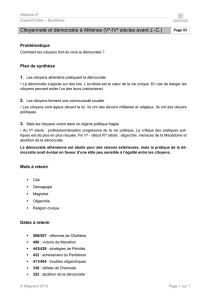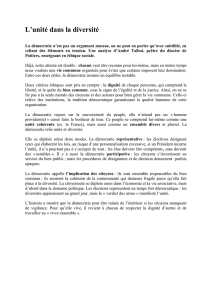Document n°266 - Cours licence Emmanuel Le Masson

239
SECTION IV : Démocratie politique, démocratie sociale : la promotion de la notion de
gouvernance
« Pour Max Weber, l’équilibre des pouvoirs dans les démocraties forme une histoire
inachevée. Un tel constat implique que toute démocratie politique y compris les plus
anciennes – soit incessamment amendée, donnant ainsi lieu à l’essor de nouveaux pouvoirs,
de nouvelles instances et de nouvelles légitimités qui s’affirment à divers niveaux de l’espace
public - au stade local ou à des stades supérieurs - sous des formes toujours plus diverses »
1
.
A) Démocratie politique : la promotion de la notion de gouvernance
Depuis le début des années 1980, se dessinent de nouvelles formes de
politiques publiques où les contradictions en œuvre au sein de la société ne sont plus
gérées au niveau du Politique mais au niveau même de la société et même au niveau le
plus prés des individus, dans le cadre d’une société considérée comme pacifiée.
Nouvelle formes de politiques publiques qui se trouveront légitimés par une absence
généralisée d’engagement et par une volonté de l’organiser ou de la légitimer.
Document n°206
« Trop de citoyens, trop de groupes, surtout syndicalistes, surtout de gauche, s’impliquent
dans la vie politique, rendant presque impossible, la tâche des « décideurs ». La crise tels
qu’ils la voient (M. Crozier, S. Huntington, J. Watanuki), ce n’est donc pas une quelconque
apathie, mais au contraire une énergie devenue redoutable dès lors que la société d’en bas
s’est mise à douter des élites politique – et à agir, le cas échéant, contre elles. Intellectuel
libéral à la mode giscardienne, auteur d’essai remarqués sur le « phénomène bureaucratique »
lié selon lui à une insuffisante implication civique des acteurs sociaux, Michel Crozier paraît
s’être transformé en penseur néo-conservateur réclamant un retour à l’ordre. Et il rejoint le
démocrate Samuel Huntington, connu à l’époque pour avoir été l’un des théoriciens des
politiques de « pacification » américaines dans le Sud-Est asiatique. Ensemble, que
découvrent-ils ? Que les intellectuels ont failli à leur mission en encourageant une « culture
d’opposition » au système. Qu’on doit « reconnaître qu’il y a une limite désirable à
l’extension indéfinie de la démocratie politique », à l’excessive vitalité » des années 60 : sa
« participation populaire accrue », son incurable « fidélité au concept d’égalité ».
S. Halimi, « Le grand bond en arrière », éd Fayard 2004, p.249.
Dans un contexte d’organisation d’une réelle déresponsabilisation de l'exécutif et du
législatif
2
, les agents des administrations publiques sont invités à mettre en œuvre des
politiques publiques intégrant de plus en plus l'amont et l'aval, dans un objectif non avoué de
1
Groux G., art « Clivages démocratiques, pluralités des régulations et légitimités », in Duclos L. Groux G.,
Mériaux O. (ss la dir) (2009), Les nouvelles dimensions du politique. Relations professionnelles et régulations
sociales, LGDJ, Montchrestien, p.14.
2
L’arrivée à la présidence de N. Sarkozy ne change guère ici la donne à ce jour, l’orientation globale reste la
même, le Politique semble toujours organiser sa déresponsabilisation, et ce malgré les discours volontaristes du
Chef de l’Etat.

240
maintien de l'ordre et de la paix sociale.
Document n°207
Aujourd'hui, "la politique ne se limite pas à la prise en compte d'une décision identifiée à un
moment ou à un texte mais intègre l'amont (la consultation) aussi bien que l'aval
(l'évaluation). La politique publique permet aussi de comprendre la pluralité des acteurs et des
modes d'interventions dans le processus d'intervention dans le processus de décision : les
groupes de pression sous la forme classique de la concertation et de la cogestion mais aussi
"le public" sous forme de sondage, de la consultation du groupe concerné (usagers, lycéens,
étudiants, personnes âgées, handicapés, fonctionnaires, etc.) et de l'audit généralisé".
N. Rousselier, art : « Deux formes de représentation politique : le citoyen et l’individu »,
in M. Sadoun (ss la dir), « La démocratie en France », tome 1, Ed Gallimard, 2000, p.324
Il convient de souligner qu'une telle façon d'envisager le rôle des administrations
publiques dans la prise de décision publique nous éloigne des formes de la démocratie et de la
représentation classique.
Cette façon d'envisager les décisions publiques est bien loin du modèle républicain
traditionnel et n'est pas sans conséquence sur le maintien ou le renforcement des inégalités,
dans la mesure où on sait que les mobilisations des individus sont très dépendantes des
positions dans les rapports sociaux de production. En d'autres termes, un tel modèle de
démocratie ne fait que donner la parole à ceux qui l'ont déjà, à ceux qui ont des capacités de
mobilisation, autant dire qu'encore une fois, les classes populaires seront exclues, dans la
mesure où elles sont sous représentées dans le tissu associatif et politique.
Document n°208
"Donner la parole à tel ou tel public, telle ou telle cible, produit à bon compte un effet de
démocratie où la parole ainsi donnée en bloc, illisible à force d'être massive et immédiate
(questionnaire, sondage, audit, etc. …) peut tourner à la manipulation d'opinion. On est loin
de la mise en place de véritable processus de délibération fondés sur la transmission et
l'appropriation de l'information, l'autonomie des participants, la maîtrise du temps et la
capacité de contradiction et d'expression des conflits. Il serait présomptueux de ce point de
vue de parler d'une nouvelle citoyenneté"
N. Rousselier, art : « Deux formes de représentation politique : le citoyen et l’individu »,
in M. Sadoun (ss la dir), « La démocratie en France », tome 1, Ed Gallimard, 2000,
p.328.
Document n°209
"Mandataires, médiateurs et porte-parole ne sont jamais désignés au hasard. La distribution
de la prise de parole et du pouvoir de décision dans le cadre d'une politique publique relève
plus de l'exercice de la domination et de la discrimination que d'une improbable égalité
représentative. Certains groupes peuvent se mobiliser plus facilement que d'autres et avec

241
une plus grande impunité que d'autres, comme le montre le cas des agriculteurs.
Le niveau d'accès au processus d'élaboration des décisions publiques représente un "coût
élevé" qui joue bien souvent le rôle de barrière. La puissance publique elle-même est loin
d'avoir abdiqué son pouvoir de régulation et de commandement. Elle continue d'inclure et
d'exclure à son gré les acteurs d'une consultation ou d'une négociation dont elle a elle-même
défini le cadre (…) plus encore, le modèle de la gouvernance ouvre une large remise en cause
de la démocratie représentative, se substituant à cette dernière, il ne relie plus un seul centre
de pouvoir à la communauté nationale. "Pouvoir anonyme", qui n'est plus contrôlé par les
citoyens parce qu'ils ne parviennent ni à l'identifier, ni à le situer, le modèle de la
gouvernance nourrit ainsi une crise de "l'imputation politique". L'image d'une administration
démultipliée, associant à ses fonctions régaliennes des agences exécutives de nature semi-
privée, remplace l'image d'un pouvoir politique qui était encore perçu comme une unité de
commandement soumise au choix concentré des citoyens et capable d'intervenir puissamment
dans la définition de leur vie".
N. Rousselier, art : « Deux formes de représentation politique : le citoyen et l’individu »,
in M. Sadoun (ss la dir), « La démocratie en France », tome 1, Ed Gallimard, 2000,
p.330-331.
Ces nouvelles politiques publiques au cours des années 1990 trouvent leur légitimation
dans une nouvelle technique de gouvernement : la gouvernance.
Cette notion de gouvernance renvoie à une technique de gouvernement, à la définition
d’un processus de régulation sociale au caractère s’affirmant volontiers démocratique.
Document n°210
"Le modèle de la gouvernance se différencie aussi bien du gouvernement parlementaire que
du gouvernement décisionnel. Il ne correspond plus à la vision autoritaire d'un pouvoir qui,
une fois désigné par un mode de délégation démocratique, est transmis par le biais d'un
appareil administratif hiérarchisé. Pour toutes ces raisons, le modèle de la gouvernance
représente à certains égards une extension de la démocratie ; les modalités de la décision
publique et non plus seulement le mode de désignation des représentants (soit parlementaires,
soit gouvernants) doivent répondre de l'exigence démocratique".
N. Rousselier, art : « Deux formes de représentation politique : le citoyen et l’individu »,
in M. Sadoun (ss la dir), « La démocratie en France », tome 1, Ed Gallimard, 2000,
p.330.
Document n°211
« Pour la gouvernance, la décision au lieu d’être la propriété et le pouvoir de quelqu’un
(individu ou groupe), doit résulter d’une négociation permanente entre les acteurs sociaux,
constitués en partenaires d’un vaste jeu, le terrain de jeu pouvant être une entreprise, un Etat,
une organisation, un problème à résoudre » « La gouvernance peut être analysée comme un
système démocratique de gestion. Elle reprend dans une perspective de management, les
ingrédients de la démocratie », « un pacte fondateur », l’égalité », « la participation ».

242
Philippe Moreau-Desfarges, « La gouvernance, Ed Puf, coll « Que sais-je », 2003, p.7 ;
19
Document n°212
« Le détour par l’écoute des citoyens se donne comme une figure obligée de l’action publique
et comme un nouvel art de gouverner, comme si désormais il n’était plus possible de prendre
de décision sans avoir consulté le public au préalable ».
Blondiaux L. (2008), Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie
participative, Seuil, République des idées, p.6.
Cette technique de gouvernement présuppose qu’il n’existe pas dans la société de
conflits irréductibles et que les contradictions entre intérêts divergents peuvent être résolus
dans la négociation, dès lors justement que les individus sont raisonnables et croient dans la
validité du processus.
Document n°213
Ce pouvoir étant censé ne plus descendre d’en haut, ne plus appartenir à une instance précise,
se coule dans une négociation multiforme et continue. Tout est marchandage et compromis,
avec, tout de même, pour tenir le système, un intérêt commun très fort : que ce système
fonctionne ! »,
Philippe Moreau-Desfarges, « La gouvernance, Ed Puf, coll « Que sais-je », 2003, p.56
Au fond, la gouvernance correspond au rêve d’une société sans conflits, d’une société dans
laquelle le Politique peut être désidéologisé, l’Etat se contentant de fixer les règles du jeu et
d’évaluer le résultat des processus de négociation.
Document n°214
« L’Etat n’apparaissant plus qu’à l’origine (fixation des normes) et à la fin (contrôle ultime
de l’application de ces normes) des processus sociaux, tout l’entre-deux est régi par la
concurrence ».
Philippe Moreau-Desfarges, « La gouvernance, Ed Puf, coll « Que sais-je », 2003, p.27
Document n°215
« La gouvernance, elle, porte une autre forme d’intérêt général. Façonné par les diverses
parties impliqués, il s’agit d’un compromis constamment renégocié (…) Au principe de cette
nouvelle action publique, s’il y a moins de commandement central et de hiérarchie que de
procédures de négociation, l’ajustement entre acteurs n’en reste pas moins nécessaires. La
négociation en réseaux apparaît comme mode coordination en actions, impliquant objectifs et
moyens, systèmes de valeurs et logiques d’intérêts. Et cela par des procédures d’interaction et
de négociation systématiques »

243
Jean-pierre Gaudin, »Pourquoi la gouvernance, Paris, Presses de Science Po, 2002) in
Philippe Moreau-Desfarges, « La gouvernance, Ed Puf, coll « Que sais-je », 2003, p.33
Cette modification des techniques de gouvernements correspondraient pour certains à une
volonté non de démocratiser le pouvoir, mais à une volonté de manipuler l’opinion.
Document n°216
« A ces critiques se joignent celles, non moins nombreuses et en provenance de démocrates
souvent sincères, qui associent démocratie participative et manipulation. Les nouveaux
subterfuges déployés par le pouvoir ne viseraient en rien une démocratisation de l’accès à la
décision. Au mieux ils contribueraient à « ce que tout change pour que rien ne change », pour
reprendre la formule tirée du Guépard de Lampedusa ».
Blondiaux L. (2008), Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie
participative, Seuil, République des idées, p.7.
Document n°217
„Le concept de bonne gouvernance est directement issu de cette méfiance à l ‘égard de
l’humain : tout en prêchant à longueur de journée la force et la victoire de la démocratie, les
nouveaux gestionnaires publics éloignent peu à peu, en effet, les choix politiques des
aspirations ou des pulsions du peuple, présentées péjorativement comme populistes, et
remettent ainsi en cause, au prétexte de bonne gouvernance, le principe même de
souveraineté populaire. L’individu perd, dans cette révolution son statut d’homme libre,
c’est-à-dire sa part de souveraineté ».
A. Bellon in Caillé A (ss la dir) (2006), Quelle démocratie voulons nous ? Pièces pour un
débat, La Découverte, p.65-66.
Document n°218
« (…) assez curieusement, la substitution récente de l’idée de gouvernance à celle de pouvoir
remplit des fonctions assez analogues. Elle vise à laisser entendre que personne n’a ou ne
détient de pouvoir, que toute décision est issue des nécessités objectives de la situation, que
tout part en principe d’en bas.
A aucun moment, ni dans l’entreprise ni au sein de l’appareil d’Etat, n’est structurée une
situation de débat où s’affronteraient des conceptions opposées du bien commun . Tout est
contractuel, négocié, accepté. Ce que nous vous imposons, c’est ce que vous avez voulu. Qui
« nous » ? Qui « vous » ? Personne ».
Ph. Corcuff in Caillé A (ss la dir) (2006), Quelle démocratie voulons nous ? Pièces pour
un débat, La Découverte, p.96.
Plus précisément, une telle technique de gouvernement implique donc :
- une redéfinition de l’intérêt général ;
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
1
/
95
100%