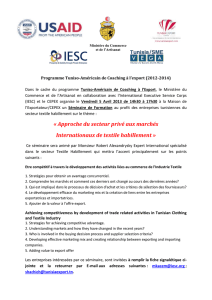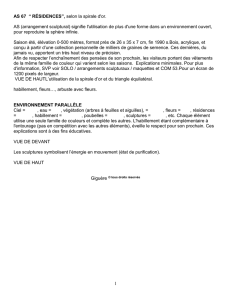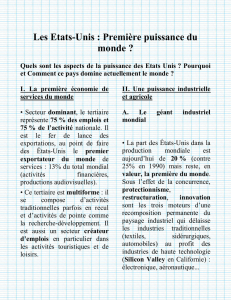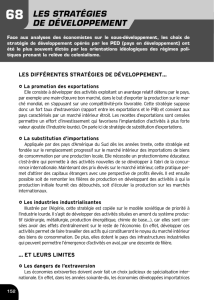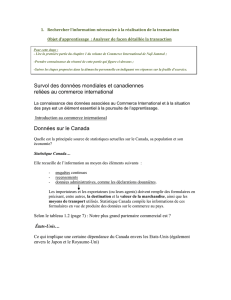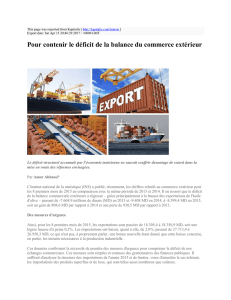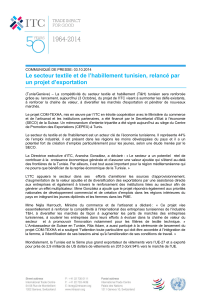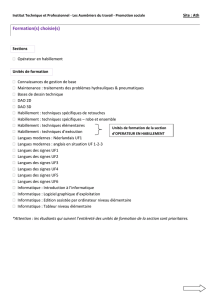3. textile et habillement

A usage officiel
TD/TC(2005)2/ANN2
Organisation de Coopération et de Développement Economiques
Organisation for Economic Co-operation and Development
10-Mar-2005
___________________________________________________________________________________________
_____________
Français - Or. Anglais
DIRECTION DES ECHANGES
COMITE DES ECHANGES
ECHANGES ET AJUSTEMENT STRUCTUREL
9-10 mars 2005
Ce document forme l'une des trois annexes au rapport référencé TD/TC(2005)2/CHAP1 et
TD/TC(2005)2/CHAP2 et présente des études de cas concernant le textile et l'habillement, l'acier et la
construction navale.
Kenneth Heydon, Direction des échanges ; téléphone : (00)33-(0) 1 45 24 89 40 ; courrier électronique
: kenneth.heydon@oecd.org / Jun Kazeki : téléphone : (00) 33-(0)1 45 24 89 27 ; courrier électronique
: jun.kaz[email protected]
JT00180092
Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine
Complete document available on OLIS in its original format
TD/TC(2005)2/ANN2
A usage officiel
Français - Or. Anglais

TD/TC(2005)2/ANN2
2
TABLE DES MATIERES
3. TEXTILE ET HABILLEMENT ................................................................................................................. 3
3.1 BANGLADESH ....................................................................................................................................... 7
3.2 COLOMBIE ........................................................................................................................................... 19
3.3 LESOTHO – LE SECTEUR DE L’HABILLEMENT ........................................................................... 28
3.4 MAURICE – LE SECTEUR DE L’HABILLEMENT ........................................................................... 34
3.5 LES ETATS-UNIS ................................................................................................................................. 42
3.6 AUSTRALIE .......................................................................................................................................... 50
3.7 LA REPUBLIQUE SLOVAQUE .......................................................................................................... 52
4. ACIER ...................................................................................................................................................... 54
4.1 L’UNION EUROPÉENNE .................................................................................................................... 56
4.2 LA RESTRUCTURATION DU SECTEUR DE L’ACIER AUX ÉTATS-UNIS ................................. 62
5. CONSTRUCTION NAVALE .................................................................................................................. 65
5.1 UNION EUROPÉENNE ........................................................................................................................ 67
5.2 JAPON .................................................................................................................................................... 73
5.3 AUSTRALIE .......................................................................................................................................... 78

TD/TC(2005)2/ANN2
3
3. TEXTILE ET HABILLEMENT
Principaux points ressortant de l’analyse
La politique commerciale doit favoriser et non retarder l’ajustement
1. De tous les secteurs examinés dans cette étude, c’est sans doute dans celui du textile et de
l’habillement que les obstacles aux échanges sont les plus importants, mais aussi la libéralisation la plus
rapide. Depuis le début des années 60 et jusqu’en 2004, des restrictions quantitatives permettaient aux pays
importateurs de restreindre les volumes autorisés et d’influer sur l’orientation des échanges. Ces dix
dernières années, les contingents imposés par l’Arrangement multifibres (AMF) ont été progressivement
supprimés, pour disparaître complètement fin 2004. Malgré la suppression de ces contingents, les droits de
douane à l’importation restent beaucoup plus élevés sur ces produits que sur la plupart des autres produits
non agricoles. Les obstacles tarifaires et non tarifaires existant dans ce secteur y ont faussé les échanges de
plusieurs façons, ce qui a eu pour résultat des prix à la consommation élevés, le maintien de filières dans
les économies « matures », l’apparition d’une production née des contingents dans des pays qui n’en
auraient pas développé dans d’autres circonstances et, enfin, l’existence de rentes pour les producteurs les
plus efficaces (acceptant de réduire leur production).
2. Que ce soit dans les pays en développement ou dans les pays industrialisés, le système du
contingentement a créé l’illusion que les producteurs étaient à l’abri de la concurrence et, partant, n’avaient
pas besoin d’ajuster leur production. Ce constat vaut de la même manière pour les producteurs de secteurs
issus des contingents dans les pays en développement, dont beaucoup n’ont existé malgré leur inefficacité
que parce que les prix étaient artificiellement élevés, et pour les producteurs des pays industrialisés, depuis
longtemps menacés par la concurrence des importations.
3. On s’accorde à penser que la disparition des contingents provoquera des changements majeurs
dans la structure des échanges du secteur. Les effets seront particulièrement sensibles pour les petits
producteurs moins performants des pays en développement. La suppression des contingents n’a pas pour
autant sonné le glas de la production textile et vestimentaire de tous les pays à l’exception de quelques-uns.
Toutes les études de cas offrent des exemples de producteurs qui, dans les pays industrialisés comme dans
les pays en développement, ont profité de la dernière décennie pour se préparer à l’évolution qui
s’annonçait et pour ajuster leur production. Dans tous les cas, les pays concernés ont réduit leurs barrières
commerciales en prévision de 2005. Les méthodes employées à cet effet n’ont cependant pas été les mêmes
partout.
4. Le Bangladesh a réduit les obstacles qu’il imposait aux importations de fournitures et de biens
d’équipement, afin de diminuer les coûts de production pour son industrie de la confection. Outre une
diminution des droits de douane et des taxes, le pays a libéralisé son taux de change et s’est attaqué aux
problèmes de la corruption et de l’inefficacité de l’administration
1
. La principale leçon à tirer de
l’expérience du Bangladesh est qu’il est impossible de soutenir indéfiniment le secteur des exportations
d’un pays uniquement parce qu’il bénéficie d’un accès préférentiel à des marchés réglementés.
5. Cette dernière remarque concernant l’accès préférentiel aux marchés se trouve confirmée par
l’exemple du Lesotho. Si le pays a bénéficié d’un accès préférentiel aux marchés de l’Union européenne

TD/TC(2005)2/ANN2
4
(dans le cadre de la Convention de Lomé, du Système généralisé de préférences et de l’initiative « Tout
sauf les armes ») et des États-Unis (dans le cadre de la Loi sur la croissance et les possibilités économiques
en Afrique), ce sont les réformes nationales qui ont tout d’abord attiré les investissements. Les premiers
investissements remontent au milieu des années 80. Ils résultaient d’une évolution de la stratégie de
développement combinant substitution des importations et promotion des exportations.
6. De la même manière, l’exemple de Maurice souligne l’importance des réformes économiques
nationales. La stabilité politique et macro-économique a été essentielle pour le développement de
l’investissement étranger et pour l’amélioration des conditions sociales. Le secteur du textile et de
l’habillement a également bénéficié d’une politique commerciale favorable. Après l’échec des politiques
de substitution des importations mises en œuvre dans les années 60, les pouvoirs publics mauriciens ont
encouragé la production par la création de zones de promotion des exportations, dans les années 70, puis
par l’adoption d’un programme d’ajustement structurel, dans les années 80.
7. La politique colombienne tient à la fois de l’approche bangladaise et de l’approche américaine
(décrite plus bas). Plus encore que le Bangladesh, la Colombie est revenue de sa stratégie
d’industrialisation par substitution des importations. En menant des réformes de marché plus complètes, le
pays s’est débarrassée de l’influence néfaste du protectionnisme sur les exportations, tout en favorisant une
concurrence saine entre ses producteurs. La Colombie a également négocié de nombreux accords de libre
échange, afin de garantir son accès aux marchés d’exportation.
8. De la même façon que les exportateurs colombiens ont profité de leur proximité avec les États-
Unis et de leur accès à ce marché, le secteur slovaque de l’habillement a tiré avantage de l’entrée de son
pays dans l’Union européenne. Depuis l’Accord européen de 1995 jusqu’à l’accession à l’Union neuf ans
plus tard, la filière a pu accéder au marché communautaire. Elle en a profité pour mettre en œuvre des
activités de perfectionnement passif avec ses partenaires européens.
9. Les États-Unis ont mis en œuvre une série de programmes et d’accords offrant à certains pays en
développement un accès en franchise de droits et sans contingents au marché américain de l’habillement.
Les règles d’origine en vigueur dans les programmes comme l’Initiative du bassin des Caraïbes ou les
accords de libre-échange passés avec les pays d’Amérique latine ou d’autres régions du monde font
dépendre le libre accès au marché américain de règles applicables au niveau de la fibre ou du tissu.
L’intention est ici d’encourager un partage de la production entre le secteur textile américain et les secteurs
de l’habillement des pays partenaires. Cette stratégie vise à assurer « un atterrissage en douceur » aux
producteurs américains de vêtements (dont beaucoup relocalisent leur production dans les pays
partenaires), tout en créant de nouveaux débouchés destinés à compenser le recul du chiffre d’affaires de la
filière textile nationale.
10. La réforme de la politique commerciale australienne, fondée sur des droits de douane peu élevés
et un large accès aux importations de textiles, vêtements, chaussures et cuir, a prouvé que ce type de choix
pouvait favoriser la réussite de l’ajustement, en incitant les entreprises à miser sur des produits novateurs à
forte valeur ajoutée, spécialisés et à forte intensité de capital, ainsi que sur le développement de la marque,
le service à la clientèle ou l’expansion du marché. Le processus d’ajustement s’est néanmoins accompagné
d’un soutien budgétaire substantiel à l’innovation et à l’investissement, afin d’aider les entreprises à rester
compétitives dans un contexte de droits de douane peu élevés.
Le coût de la main d’œuvre compte, mais sa qualité aussi
11. La tentation est grande de conclure que la compétitivité, dans le secteur de l’habillement, est
purement fonction du coût de la main-d’œuvre. En effet, il est avéré que (a) la main d’œuvre contribue très
largement à la valeur de la plupart des vêtements et (b) que les salaires des pays en développement sont

TD/TC(2005)2/ANN2
5
inférieurs à ceux des pays industrialisés. À ce titre, il n’est pas étonnant que la tendance à long terme soit
de délocaliser la confection dans les pays en développement et de quitter ces pays dès qu’ils ont à leur tour
atteint un certain niveau de développement.
12. Cela ne signifie pas pour autant qu’un pays serait bien avisé de ne fonder sa compétitivité que
sur une main-d’œuvre bon marché. L’exemple de la Colombie montre bien que la qualité de la main
d’œuvre compte tout autant que son coût, en particulier pour un pays qui souhaite conserver son secteur de
l’habillement après avoir atteint un niveau de développement industriel moyen. La différence essentielle se
joue entre les filières d’assemblage pur, pour lesquelles le coût de la main-d’œuvre est effectivement
crucial, et des secteurs plus élaborés, capables d’assumer des activités à plus forte valeur ajoutée axées sur
la transformation du tissu en vêtement. Dans le cas de la Colombie, le passage de l’assemblage à une filière
de production complète a nécessité d’améliorer les compétences de la main-d’œuvre et ses capacités de
gestion, mais a permis de créer un secteur plus concurrentiel et mieux à même de résister à l’abandon des
contingents. Certaines entreprises du Bangladesh s’efforcent elles aussi de passer ce cap.
13. L’atmosphère qui règne sur le lieu de travail a également son rôle à jouer. L’exemple
australien semble indiquer que renforcer la coopération et l’efficacité de la communication entre la
direction et les salariés, notamment par des négociations sur les conditions de travail, pourrait contribuer à
davantage de flexibilité et de productivité.
Plus hautes étaient les barrières et plus dure sera la chute
14. Les paragraphes précédents concernaient l’ajustement au sein même des secteurs du textile et
de l’habillement. Il importe tout autant d’encourager l’ajustement en dehors de cette filière, en particulier
dans les pays dont la production devrait chuter — et qui perdront des emplois — avec la suppression des
contingents. La disparition du contingentement affectera les pays indépendamment de leur niveau de
développement économique.
15. Les programmes d’aide à l’ajustement ont jusqu’à présent été beaucoup plus conséquents
dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Cela tient sans doute à la fois à l’offre et à
la demande : les pays industrialisés ont plus de ressources à consacrer à ces questions et sont aussi plus
susceptibles de présenter un grand nombre de secteurs « matures » confrontés à la concurrence des
importations et ayant besoin d’aide. Dans le cas du textile et plus encore de l’habillement, néanmoins, on
prévoit que les perturbations toucheront dans les prochaines années aussi bien les pays industrialisés que
les pays en développement. Les États et les autres sources de financement, comme les institutions
financières régionales et internationales, devront probablement consacrer plus de moyens à ces
programmes.
16. L’exemple de l’Australie suggère qu’en cas de suppressions d’emplois significatives sur le
plan régional ou de compression massive des effectifs dans le secteur, les pouvoirs publics
accompagneront d’une aide spécifique les mesures d’ajustement généralement disponibles.
17. Aux États-Unis, les travailleurs des secteurs du textile et de l’habillement victimes de
suppressions d’emploi ont occupé une place centrale dans le programme d’aide à l’ajustement. Certaines
des questions soulevées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce programme mériteront d’être
examinées avec soin par les pays ou les organismes qui se pencheront sur ce type de programmes dans les
prochaines années, notamment les arguments économiques et politiques plaidant en faveur de la
différenciation des travailleurs ayant perdu leur emploi en fonction des causes de leur licenciement (c’est-
à-dire la question de savoir si le chômage lié aux échanges doit être traité de manière différente).
2
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
1
/
83
100%