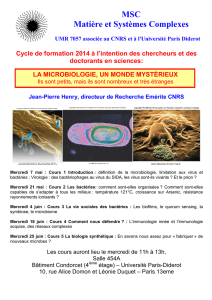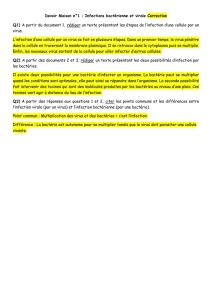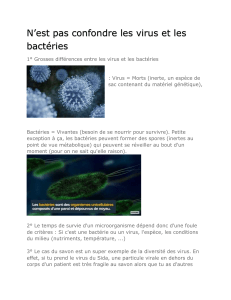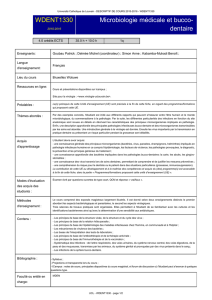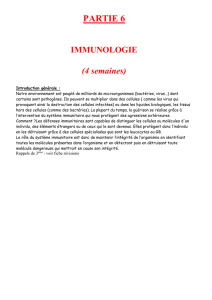microbiologie - le site de la promo 2006-2009

Notes : Florence MENESTRELLO
1
MICROBIOLOGIE
INFECTIEUX
MME LETON
I – Le virus
A) généralités
Virus : parasite cellulaire ; ils détournent le métabolisme de la cellule hôte à leur profit. Ils s’y
reproduisent par réplication de leur acide nucléique. Ils sont de très petite taille et se réduisent à une
simple information génétique d’ADN ou d’ARN (jamais les deux)
Conséquences pour la cellule quand un virus rentre à l’intérieur
(Il a besoin de la cellule pour se répliquer)
mort de la cellule infectée
libération de plusieurs centaines de virions (particules infectées du virus ; bébé virus)
o qui vont être aptes à infecter d’autres cellules (et à les détruire à leur tour)
o ou qui y resteront sans bruit (ex : herpès, varicelle), asymptomatique
o ou qui provoquent des effets inhabituels avec une multiplication anarchique (ex : cancer)
B) structure et classification
Virus constitué de 2 éléments :
la capside : coque protectrice constituée de molécules de protéines
le filament d’acide nucléique : soit ADN soit ARN ; cette structure a permis de classer
les virus (virus à ADN / virus à ARN)
o virus à ADN : herpes, varicelle, zona, hépatite B
o virus à ARN : grippe, rougeole, oreillon, VIH etc.
C) la reproduction d’un virus
1ère étape : le virus pénètre dans la cellule
La capside va s’ouvrir et libère son AN dans le cytoplasme. A partir de ce moment là, il va y avoir
blocage de la fabrication cellulaire et la cellule va commencer à dupliquer l’AN du virus : métabolisme
cellulaire détourné au profit du développement du virus.
Si ARN : duplication du cytoplasme
si ADN : duplication dans le noyau
La cellule va procéder à la fabrication des protéines d’une nouvelle capside ; l’AN viral et les éléments
de la capside s’assemblent. De nouveaux virus sont ainsi formés. (Il y a fabrication et assemblage des
pièces donc)
D) l’identification
Le sérodiagnostic identifie les virus (sérologie virale) permet d’identifier le virus responsable et la
quantité d’anticorps qu’on a
(Microscope électronique et culture cellulaire le permettent aussi)

Notes : Florence MENESTRELLO
2
E) les actions de certains agents sur les virus
1. la température
la chaleur détruit les virus entre 50 et 60° ; certains sont détruits à 180° (hépatite B)
le froid entre + 4° et – 70° permet la conservation des virus (pour les laboratoires de
recherche)
2. les agents chimiques peuvent avoir des actions variables en fonction des concentrations et
des temps de contact. (il faut donc bien lire le mode d’emploi des produits) ; certains virus
supportent mal l’éther ou l’iode
3. les agents thérapeutiques : certains produits agissent comme anti métabolique (ex : la
chimiothérapie dans les cas des traitements contre les cellules)
4. la vaccination : très bon moyen de prévention
5. l’immunoglobuline (ou gammaglobuline) est une protection à court terme : on injecte des
anticorps contre le tétanos par exemple qui vont protéger pendant un certain nombre de
semaines et on demandera aussi de faire le rappel tétanos dans un certain temps (pour que
l’organisme identifie et fabrique les anticorps du tétanos)
II – les bactéries
Ce sont des organismes vivant unicellulaires qui croissent et se multiplient dans un milieu nutritif
adapté et provoquent des infections bactériennes
A) les différentes formes des bactéries
La bactérie est polymorphe c'est-à-dire qu’elle a des formes différentes, des dimensions variables et des
modes de regroupement qui servent à la reconnaître.
Ex : les coques : sphères
Les bacilles : bâtons
Les spirilles : vague (syphilis)
Les vibrions : pont (choléra)
Modes de regroupement : en chaîne ou en chaînette, en amas ou grappe, isolé, en palissade etc.
B) la structure bactérienne
Il y a des éléments constants dans les bactéries et des éléments facultatifs
1. les éléments constants
noyau avec ADN
cytoplasme
membrane cytoplasmique
paroi : protection contre les agressions physiques et chimiques ; elle donne la forme à la bactérie ;
de plus la composition chimique peut être différente selon les bactéries et cela se traduit par un
aspect différent à la coloration de Gram. La différence de couleur se fait par rapport à l’épaisseur de
la paroi ; c’est un élément de reconnaissance des agents bactériens (bactéries à Gram+ et bactéries à
Gram-) ; ça détermine aussi le choix de l’antibiotique

Notes : Florence MENESTRELLO
3
2. éléments facultatifs
flagelles : elles assurent la mobilité et la spécificité de la bactérie (reconnaissable au microscope)
Capsule : elle joue un rôle de protection empêchant ainsi la phagocytose ; les bactéries ainsi
protégées peuvent provoquer une infection
la spore (thermorésistante entre 80° et 100°) : forme sous laquelle peuvent se présenter certaines
bactéries et qui est plus résistante à des conditions défavorables et au temps. Elles se transforment
en coques, en spores et ça la protège contre les conditions défavorables (ex : le tétanos qui se met
dans la rouille, dans la terre etc.) ; elle se retransformera en bactérie virulente sous le coup de
conditions défavorables ; ex : tétanos, botulisme
C’est donc un état de vie latent
Donc la sporulation c’est la capacité que possèdent certaines bactéries de se transformer en spores.
C’est un mécanisme de défense (et non un mode de reproduction).
La germination c’est le phénomène inverse ; elle est déclenchée par le retour à des conditions
favorables (donc elle donne une bactérie)
les pilis sont les prolongements cellulaires qui permettent le transfert de matériel génétique d’une
bactérie à l’autre
C) la reproduction
Les bactéries se reproduisent par scission : quand elles atteignent une certaine taille, le noyau et le
cytoplasme se dédoublent. Il y a donc après deux cellules filles identiques.
D) le pouvoir pathogène
C’est la capacité de créer des troubles, d’engendrer une maladie. Ce pouvoir dépend de deux
mécanismes :
la virulence (pouvoir de multiplication du germe dans l’organisme)
la toxicogénèse (propriété d’élaborer une toxine)
E) actions d’agent extérieur sur les bactéries
la température : le froid arrête leur multiplication mais ne les détruit pas
la chaleur : une température de 60° pendant 30 minutes inactive certaines bactéries. A 100° la
plupart sont tuées. Si elles sont sporulées il faut dépasser 180°

Notes : Florence MENESTRELLO
4
la lumière : action du soleil et des rayons UV, l’ensoleillement des habitations est nécessaire par
rapport à l’hygiène car les bactéries sont sensibles aux radiations
les agents chimiques : (voir cours sur les antiseptiques, les désinfectants, les antibio)
1
/
4
100%