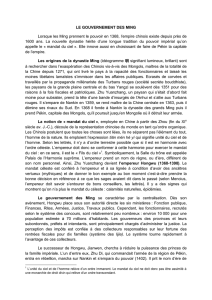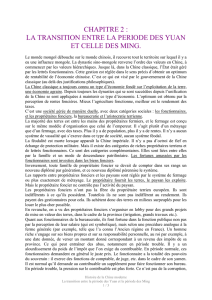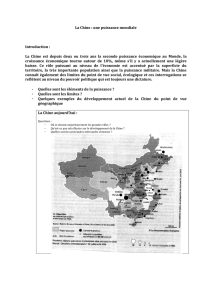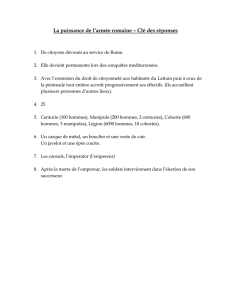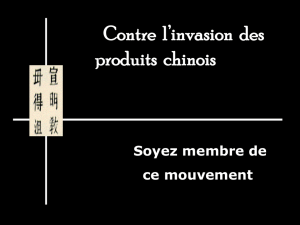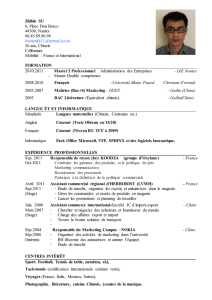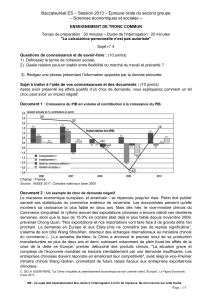CHI 013A – J. Kerlouégan – Février 2006 ENTRE CRISE ET

CHI 013A – J. Kerlouégan – Février 2006
1
ENTRE CRISE ET DÉVELOPPEMENT.
LA FIN DES MING
1. LE RÈGNE DE JIAJING (1521-1566)
1.1 La Controverse sur les Grands Rites (Dali yi 大禮議)
Lorsqu’en 1521, le fantasque empereur Zhengde meurt des suites d’un accident, à l’âge de 30 ans,
sans fils ni frère, les grands secrétaires se demandent qui doit lui succéder. La situation est sans
précédent (sous les Ming) et prend au dépourvu la Cour. Que faire ? Le premier grand secrétaire
(c’est-à-dire le chef du gouvernement) Yang Tinghe, en accord avec la mère du défunt empereur,
choisit d’introniser un cousin germain âgé de 13 ans, qui est prince dans un fief du Sud. Yang prétend
que telles étaient les dernières volontés de Zhengde dans son testament (il est probable que c’était un
mensonge et que Yang a lui-même écrit ce testament). L’adolescent est amené sous haute escorte à
Pékin, et monte sur le trône en adoptant le nom d’ère Jiajing 嘉靖. C’est donc le représentant d’une
branche collatérale qui monte sur le trône en 1521 : Jiajing est respectivement le cousin et le neveu de
ses deux prédécesseurs (voir l’arbre généalogique distribué en cours).
Le but de Yang est de forcer rapidement l’adolescent à se déclarer, non pas cousin et neveu de
ses deux prédécesseurs, mais, fictivement, leur frère et fils. Tout sera alors sauf du point de vue de la
succession et du rituel : l’empereur sacrifiera à ses deux prédécesseurs comme s’il était de leur lignée.
Yang et l’impératrice douairière pensent qu’ils n’auront pas de mal à convaincre le jeune garçon. Or,
ce ne sera pas du tout le cas, et c’est là l’origine de la Controverse, une Controverse qui va
littéralement enflammer la Cour pendant sept ans. Beaucoup d’énergies s’y perdront, avec
l’impression d’un véritable gâchis. C’est une controverse dont les enjeux nous apparaissent
aujourd’hui insignifiants, mais qui à l’époque, par leurs implications éthiques et rituelles, étaenit
considérables, aussi bien aux yeux de Jiajing que des lettrés.
Jiajing, donc, refuse la « manipulation » généalogique qu’on lui propose (une adoption fictive),
provoquant par ce refus une impasse (car la ligne de succession est brisée). Dès le départ, il se
considère comme un héritier « du trône » (c’est-à-dire de l’institution impériale) mais pas comme un
héritier biologique de Zhengde. Les lettrés de la Cour s’arrachent les cheveux : qui est ce jeune gamin
pour jouer ainsi sur les mots ? Mais Jiajing refuse de céder. Il se considère uniquement comme le fils
de ses vrais parents. Son père, décédé en 1519, était le frère de Hongzhi et n’avait bien entendu jamais
été empereur (il n’avait été qu’un prince, le prince Xian), et sa mère était toujours en vie. Jiajing veut
qu’on accomplisse en leur honneur les rituels dus aux parents de tout empereur, et qu’on les appelle
purement et simplement « empereur » et « impératrice douairière » (la douairière est la mère d’un
empereur). Lorsque sa mère arrive à Pékin pour s’installer au Palais, il obtient qu’on l’accueille avec
le rite dû à une impératrice douairière. C’est une première victoire.
Un certain nombre de fonctionnaires (une minorité d’opportunistes qui sent venir les choses)
prend fait et cause pour le jeune empereur. Il y a parmi eux d’obscurs petits fonctionnaires des quatre
coins de la Chine, mais aussi de grands lettrés. Mais l’immense majorité de la bureaucratie est contre
lui. Le débat est extrêmement violent. Chaque camp cite toutes sortes de précédents historiques (de
l’époque des Han ou des Song), va fouiller dans les Classiques, en particulier ceux traitant du rituel
(Liji, Yili, Zhouli), ou dans les Instructions des Ancêtres publiées par Hongwu, le fondateur des Ming.
On se sert aussi des manifestations de la nature (incendies au Palais, déchaînement des éléments, etc.)
pour appuyer son argumentation. C’est un débat très complexe, à la fois philosophique et technique
(car les règles rituelles découlent toujours des principes philosophiques). On glose les mots (si 嗣
versus tong 統), les concepts (qu’est-ce que la piété filiale ? jusqu’où peut-elle aller ? qu’est-ce que le
zhengtong, « succession légitime » ?), on se dispute à propos des « règles claniques » (zongfa),
instituées dans l’Antiquité pour déterminer la hiérarchie interne (et donc les principes de succession)

Entre crise et développement. La fin des Ming
2
au sein d’un clan. Cela montre, au passage, que rien n’est fixé immuablement par les textes, y compris
les plus anciens et les plus sacrés : ils sont matière à interprétation.
Jiajing supporte mal qu’on lui oppose résistance et, en 1524 (rappelons qu’il n’a alors que 17
ans), fait bastonner et emprisonner 134 protestataires (16 mourront de leurs blessures). Il voudrait
même qu’on transfère la dépouille de son père dans le site des tombeaux des Ming, comme s’il avait
régné. Plusieurs flagorneurs l’y poussent. Peu à peu, les lettrés, sans doute las, font des concessions, et
Jiajing finit par obtenir pas à pas ce qu’il souhaite : il obtient que ses parents soient qualifiés de huang
皇 (« impérial »), que son père soit qualifié non plus de « prince de Xian » mais d’« empereur Xian »
(sa mère étant promue impératrice Xian, comme si elle était la veuve d’un empereur), puis, en 1525-
1526, qu’on construise un temple en l’honneur de son père, mais les lettrés exigent que ce temple soit
séparé du temple des ancêtres impériaux. Jiajing ordonne aussi qu’on compile les annales du « règne »
de son défunt père (Annales du règne de l’empereur Xian).
Jiajing fait publier deux ouvrages officiels, des sortes de « livres blancs » qui entérinent les
conclusions de la Controverse en rassemblant des documents. De façon symbolique, il change le nom
de sa préfecture natale, Anlu, en Chengtian (« qui obéit au Ciel »), afin qu’elle soit sur le même pied
d’égalité que Shuntian (« qui est soumise au Ciel »), c’est-à-dire Pékin, et Yingtian (« qui se conforme
au Ciel »), c’est-à-dire Nankin.
Le gros de la Controverse est terminé… sauf pour Jiajing. En 1538, il franchit le dernier pas :
il donne à son père un nom de temple (miaohao), c’est-à-dire un nom d’ancêtre impérial, se terminant
par zong 宗 (« ancêtre ») : Ruizong. Pour l’introduire dans le temple des ancêtres impériaux, il
n’hésite pas, cette fois, à en déloger l’un des ancêtres
1
. Désormais, son père est dans le temple des
ancêtres. Jiajing a mis 17 ans pour y arriver ! Obstination de Jiajing dans la Controverse : parfois, il est
seul contre tous, il n’accepte qu’en apparence de se plier aux recommandations du ministère des rites
ou des grands secrétaires (il revient toujours à la charge et les fonctionnaires, las, finissent par lui faire
des concessions, c’est comme ça pendant 17 ans). Côté enfant têtu.
Le dernier épisode de cette controverse rituelle se situe à la mort de la mère de Jiajing en 1538.
Jiajing se pose la question de savoir où l’enterrer : à Pékin, avec les autres empereurs et impératrices,
ou au pays natal ? Faire venir les restes du père au Nord ou envoyer la dépouille de la mère au Sud,
aux côtés de celle du père ? Il fait même une tournée d’inspection dans son pays natal en 1539 mais
finalement, après moult hésitations et revirements, il envoie les restes de sa mère au Sud.
En marge de la Controverse sur les Grands Rites – qui concerne le statut à accorder à ses parents,
surtout à son père –, Jiajing fait réformer des rituels impériaux importants (il modifie ce qu’on appelle
les « règles des sacrifices », sidian 祀典). À chaque fois, cela provoque des polémiques érudites. En
1530 :
- il sépare les sacrifices au Ciel et à la Terre, qui depuis Hongwu étaient combinés. Un autel dans la
banlieue sud (et sacrifice au solstice d’hiver) pour le Ciel (attention : le fameux Temple du Ciel n’est
pas l’Autel du Ciel, qui se trouve en réalité à côté), un autel dans la banlieue nord (et sacrifice au
solstice d’été pour la Terre). Il y avait aussi un autel de la Lune dans la banlieue ouest et un Autel du
Soleil dans la banlieue est (aujourd’hui, tous ces autels se trouvent à l’intérieur de Pékin).
- il remet en vigueur le rituel de l’élevage des vers à soie par l’impératrice (rituel lors duquel
l’impératrice, à la tête des femmes de l’aristocratie, accomplit symboliquement les gestes de la
sériciculture). Il y voit en effet un pendant du rituel du Labourage, qui était accompli par l’empereur.
Le premier est placé sous les auspices de Xiancan, la déesse de la sériciculture, le second sous ceux de
Xiannong (ou Shennong), le dieu de l’agriculture.
- il réforme le culte de Confucius : le rabaisse au rang de Premier Maître (et non plus Roi de la
Diffusion de la Culture, car il détestait avoir à se prosterner devant un roi. Tablettes et non plus statues
ou portraits, moins de rangs de danseurs dans les sacrifices. Valable pour tout l’empire. Il fait cela car
mécontent des protestations du mandarinat confucianiste dans la Controverse.
1
Techniquement, il fallut donner à l’empereur délogé le statut d’« ancêtre éloigné » (éloigné dans le temps). Ces
« ancêtres éloignés », tout en étant dans le temple, n’étaient pas comptés parmi les neuf ancêtres (les plus
proches). Toutes ces manipulations, qui nous semblent aujourd’hui être de la cuisine rituelle confucianiste,
faisaient à l’époque l’objet de débats érudits. C’était le quotidien de la cour !

CHI 013A – J. Kerlouégan – Février 2006
3
Dans les années qui suivent, il poursuit ces réformes rituelles. Il instaure par exemple la prière pour les
céréales (qigu) en 1531, et le « grand sacrifice » en l’honneur de Shangdi en 1538. Il réforme aussi la
musique des rituels impériaux (rituels et musique vont de pair dans la tradition chinoise). Il autorise
les gens à sacrifier à l’ancêtre fondateur de leur clan (shizu)(1536).
Pour entériner tous ces changements, il fait rééditer le code rituel des Ming de Hongwu (en y
portant les modifications qu’il a introduites) et publier un Siyi 祀儀 (Les règles protocolaires pour les
sacrifices), qui récapitule tous les rituels réformés ou créés, avec des illustrations et la liste des danses
et musiques qui vont avec chaque rituel.
Jiajing a aussi tenté de modifier le « système du temple des ancêtres impériaux » (miaozhi 廟
制). En 1535-1536, suite à l’incendie du temple des ancêtres impériaux de Nankin, Jiajing décide de
reconfigurer celui de Pékin : il fait bâtir des temples séparés pour chaque ancêtre impérial (alors que
jusque-là un seul temple abritait des niches pour chaque ancêtre impérial). Toutefois, il se heurte au
refus des lettrés pour y introduire son père (cela nécessitait de retirer un des ancêtres impériaux, car le
nombre maximum était de 9). Mais cinq ans après sa construction, ce nouveau temple brûle, ce que
Jiajing prend comme un signe de la colère céleste. Lorsqu’il le fait reconstruire, il revient à l’ancienne
forme. Enfin, Jiajing donne un nouveau titre posthume à Yongle : Chengzu (zu 祖 était normalement
réservé au fondateur d’une dynastie, canonisé sous le nom de Gaozu ou Taizu). Pourquoi cette
réhabilitation de Yongle ? Car Jiajing se sent une grande affinité avec Yongle : comme lui, Yongle a
usurpé le pouvoir et a inauguré une branche collatérale dans la succession. En réhabilitant Yongle, il
se légitime lui-même
2
…
Bilan :
- importance des rituels dans la civilisation chinoise (rituels domestiques, religieux ou, comme ici,
impériaux) => garants de l’harmonie terrestre. Thèse de certains historiens : ce sont ces rituels qui
permettent parfois à des dynasties en crise de tenir … (facteur de cohésion). Passer à côté de ces
rituels, c’est ne pas comprendre la culture chinoise, ritualiste.
- publication de nombreux textes rituels pour entériner les réformes (Jiajing est, après Hongwu, celui
qui a le plus produit de textes rituels). Mais dans les faits, la plupart de ces nouveaux rituels vont vite
être abandonnés, y compris par Jiajing lui-même, puis supprimés par ses successeurs. Beaucoup de
bruit pour rien !
L’impact de la Controverse est en fait ailleurs. Il se situe au niveau de la vie politique des Ming :
● rôle central de l’empereur, qui affirme son autorité, au besoin par l’arbitraire (opposants torturés,
exilés voire exécutés, cf. 1.4).
● essor du factionnalisme. C’est à cette période (la décennie 1520) qu’on peut faire remonter la
naissance des factions au sein du gouvernement central, en l’occurrence un petit noyau de
fonctionnaires proches de l’empereur (qui le soutiennent et/ou le manipulent) contre le reste de la
bureaucratie. La Controverse n’a été qu’un prétexte à la lutte des factions, avec des règlements de
compte personnels au sommet de la bureaucratie, des purges. Idée que derrière des débats éthico-
rituels, il y a toujours la lutte entre les cliques, la politique politicienne, le carriérisme, des haines
personnelles se forment, des vengeances se trament …
● l’empereur se coupe de ses fonctionnaires. Ce divorce, prononcé par Jiajing, ne disparaîtra plus
jusqu’à la fin des Ming (voir 2.2).
● Début de la toute-puissance du Grand Secrétariat (où, à l’époque de la Controverse, siègent les pro-
Jiajing).
● Toutes ces modifications de rituels sont l’occasion de débats entre lettrés, du moins entre ceux qui
osent critiquer l’empereur et ceux qui le flattent (beaucoup se taisaient). On fait faire des sondages
parmi les fonctionnaires, pétitions, mémoires collectifs, protestations collectives. La vie politique est
intense (annonce le règne de Wanli, cf. 2.2).
2
En 1530, Jiajing avait d’ailleurs fait publier, avec la signature de sa mère, un ouvrage de morale à l’attention
des femmes, le Nüxun (Instructions aux femmes), en même temps qu’il avait fait republier le petit ouvrage
similaire, le Neixun (Instructions pour le gynécée) qu’avait rédigé l’épouse de Yongle (voir chapitre précédent) :
c’était un moyen de se comparer à Yongle.

Entre crise et développement. La fin des Ming
4
1.2 Les périls extérieurs
Au début du règne de Jiajing, l’empire vit (globalement) depuis longtemps dans la paix, si bien que la
défense des frontières a été négligée. Deux périls vont réveiller les Chinois.
1.2.1 Les Mongols
Il n’est pas excessif de dire qu’entre le milieu du 15e siècle et le milieu du 16e siècle, les Ming sont
obnubilés par la menace mongole. Rappelons que tout au long de son règne, au début du 15e siècle,
Yongle avait lancé plusieurs campagnes contre les Mongols. Il avait même, pour mieux les contenir,
déplacé la capitale de l’empire de Nankin à Pékin. La déroute de Tumu (1449), lors de laquelle une
partie de la Cour était morte sur le champ de bataille et surtout l’empereur avait été fait prisonnier (on
avait mis sur le trône son frère), avait failli faire repasser la Chine sous le joug mongol. Elle ouvre
pour longtemps une période de doute et de repli. Mais l’empire chinois profitera sur le long terme de
la désunion des ethnies nomades, qui luttent entre elles pour le contrôle de la steppe (division entre
Mongols occidentaux et Mongols orientaux, puis entre Mongols orientaux eux-mêmes).
Dans les dernières années du 15e siècle, les Mongols effectuent chaque année des raids
dévastateurs le long de la frontière. Pékin, protégée par les garnisons de Xuanfu et Datong (deux des
neuf points de défense établis sur les quelque 3500 km de la frontière nord), est presque constamment
en état d’alerte. Le péril devient d’autant plus menaçant lorsque Batu Möngke parvient à unifier les
Mongols orientaux, autour de l’an 1500. À la Cour des Ming, la question mongole est un sujet brûlant,
qui a des implications dans la politique intérieure : aux tenants d’une politique offensive (expédition
militaire pour récupérer la zone stratégique des Ordos, c’est-à-dire la zone à l’intérieur de la boucle du
Fleuve jaune, où les Mongols ont pris pied) s’opposent les partisans d’une politique plus défensive,
qui réussissent à imposer le renforcement de la Grande Muraille et la construction d’un deuxième
rempart pour doubler le premier (années 1470) et prônent l’octroi de concessions diplomatiques et
commerciales aux Mongols (ouvertures temporaires de marchés frontaliers). Mais la construction de
murailles ne fait que déplacer les attaques mongoles plus à l’Est.
Le débat sur les Ordos refait surface à la fin des années 1540, après un raid particulièrement
meurtrier des Mongols orientaux en 1542 au Shaanxi. Une fois encore, partisans de la reconquête
militaire et avocats de la diplomatie s’affrontent via les factions. Un fonctionnaire responsable de la
défense du Nord-Ouest propose un plan détaillé de reconquête des Ordos mais très coûteux en
chevaux, hommes et armes. Jiajing, qui détestait les Mongols
3
, soutient d’abord les premiers, mais
finit par donner raison aux seconds. Les deux concepteurs du plan offensif seront exécutés.
En 1550, le digne héritier de Batu Möngke, Altan Khan – qui a établi sa capitale quasiment au
pied de la Grande Muraille (Huhehot actuelle) – s’approche tout près de Pékin, les gens fuient, se
réfugient dans la ville. Mais Altan ne parvient pas à prendre la capitale de l’empire. S’ensuit
néanmoins une nouvelle crise politico-militaire à la Cour : comme en 1449, on se rejette la
responsabilité de la défaite, des têtes tombent (au sens propre comme au sens figuré). Les régiments
stationnés à Pékin sont à nouveau restructurés, et Jiajing sent même le besoin de créer une armée
d’eunuques au Palais (1552). On renforce les défenses (à partir de 1550, la construction de nouvelles
portions (ou renforcement d’existantes) de la Gde Muraille. 1553 : construction du rempart sud de
Pékin, qui englobe la ville sud (i.e. le temple du Ciel est inclus dans la ville). Mais les raids mongols
ne cessent pas pendant les 20 années qui suivent. Malgré la hausse des dépenses militaires, les Chinois
n’arrivèrent pas à contrôler Altan. La menace mongole n’est contenue qu’à partir des accords de paix
et d’échanges de 1571 (voir 2.1). En 1578, la conversion d’Altan Khan au bouddhisme tibétain aura
une influence apaisante sur ses ardeurs guerrières.
La raison pour laquelle les cavaliers mongols – dont l’adresse au tir à l’arc, la rapidité et la
mobilité désorientent complètement les Chinois – effectuent des raids en territoire chinois est que la
Chine refuse aux Mongols un commerce qui leur est vital (achat de thé, de grain, de métaux, et de
3
Il avait retiré du culte impérial tous les empereurs et les ministres des Yuan, comme Khubilai; et demandé aux
fonctionnaires d’écrire le mot lu (mot péjoratif désignant les Mongols) en tout petits caractères dans les
documents officiels.

CHI 013A – J. Kerlouégan – Février 2006
5
soieries contre chevaux). En réalité, ce « choc des cultures » est plus complexe qu’il n’y paraît ou que
ne le prétendent les patriotes les plus durs, animés uniquement par le mépris du Barbare. En effet, de
nombreux Mongols, descendants de ceux qui occupaient le pays au 14e siècle, vivent en Chine. On en
trouve notamment dans les armées chinoises et dans la Garde impériale. La Cour s’en sert comme
ambassadeurs. Si ceux-là sont assez « sinisés », d’autres émigrent continuellement en Chine, attirés
par de meilleures conditions de vie; des soldats ou même des princes mongols se rendent (ils sont de
précieux informateurs). À l’inverse, des sujets chinois, faits prisonniers ou corrompus par les Mongols,
ou bien des déserteurs, vivent en territoire ennemi, ou du moins dans cet hinterland poreux, théâtre de
toutes les tractations. La Cour tente de marchander la livraison de ces « traîtres ». D’autre part, la
Chine des Ming a gardé certaines influences mongoles dans ses coutumes (langue, vêtement,
institutions politiques, mariage), même si ces emprunts ont été au fil du temps intégrés ou abolis (en
1464, l’empereur demande qu’à sa mort, on épargne ses concubines, rompant ainsi avec l’héritage
mongol).
1.2.2 La piraterie
Les pirates qui ont déferlé sur les côtes chinoises sous les Ming sont appelés dans les textes chinois les
Wokou 倭寇, c’est-à-dire « bandits japonais ». Wo (les Nains) était le terme utilisé par les Chinois
depuis les tout premiers contacts avec l’archipel japonais, au 3e siècle. En réalité, il n’y avait pas que
des Japonais parmi ces pirates. L’Histoire dynastique des Ming reconnaît qu’il y avait parmi les pirates
30% de « vrais Wo » (c’est-à-dire de Japonais) et 70% de « gens qui les suivaient » (sous-entendu :
des Chinois ou des métis). Les deux chefs pirates les plus célèbres furent d’ailleurs des Chinois. Quant
au terme « bandit », il est ambigu : c’est un des termes habituellement utilisé par l’État chinois pour
désigner tous ceux qui sont contre lui. Il s’agit d’une étiquette. S’agissait-il vraiment de « bandits », de
« pirates » ? Ne peut-on pas y voir tout simplement des marchands désireux de pratiquer le commerce ?
Le commerce devient de la contrebande dès lors qu’il est interdit…
Le commerce côtier et maritime était une longue tradition en Chine – les Tang et surtout les
Song l’avaient soutenu officiellement. Il était en fait assez naturel. La province montagneuse du Fujian,
par exemple, n’arrivait pas à vivre uniquement de l’agriculture et il était logique qu’elle se tourne vers
des activités maritimes. Mais depuis l’époque de Hongwu, l’État avait interdit le commerce maritime
privé, interdiction qui avait été réitérée régulièrement (ce qui prouve au passage que ce commerce se
poursuivait et que l’interdiction n’était pas respectée). Il était interdit de « mettre les voiles et
d’entretenir des contacts avec les Barbares », et a fortiori d’aller à l’étranger, sans permission. Le seul
commerce possible était celui effectué dans le cadre du tribut, dans certains ports de la côte, sortes
d’ancêtres des « ports ouverts » du 19e siècle. Les raisons de cette « fermeture des mers » (jinhai,
littéralement « interdire la mer ») étaient idéologiques : peur de voir se nouer des complicités avec
l’étranger, de voir des secrets militaires révélés, etc. Malgré tout, des Chinois, en particulier des
Foukiénois, n’avaient cessé depuis le 15e siècle d’émigrer à Java, au Siam, aux îles Ryūkyū et même
au Japon.
De fait, il y eut de la contrebande maritime dès le milieu du 15e siècle, et peut-être même
avant. En ce qui concerne le commerce officiel, le tonnage des bateaux japonais était limité, le nombre
de marchands à bord aussi (il avait été réduit à 50 par ambassade depuis un incident en 1496). La
cargaison était fouillée et les Japonais devaient loger dans des hôtels officiels dans les « ports
ouverts ». Le système, depuis le début du 15e siècle, était fondé sur des certificats officiels, que les
Chinois renouvelaient à chaque ambassade. Les particuliers avaient le droit d’acheter des produits
mais en quantité limitée, et une fois que les autorités chinoises avaient tout vérifié. Mais dans la réalité,
les Chinois entraient en contact avec les Japonais qui venaient faire le commerce officiel. Des pirates
se mêlaient à ces ambassades, et les ambassadeurs eux-mêmes se livraient à leur petit commerce. À
partir du 16e siècle, surtout dans les années 1520 et 1530, le commerce illégal s’accéléra – la tendance
est confirmée par les sources coréennes.
L’arrivée des navires japonais dans le port de Ningbo (au Zhejiang) était toujours redoutée en
raison de la crainte d’incidents entre Chinois et Japonais. En 1523, de sérieux incidents furent
provoqués par une rivalité entre deux ambassadeurs japonais : l’un, furieux de s’être vu refusé la
préséance par les Chinois alors qu’il était arrivé avant l’autre, mit le feu à ses bateaux, tua ses hommes,
et sema la terreur entre Ningbo et Shaoxing avant de repartir. Il faut dire que les relations sino-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%