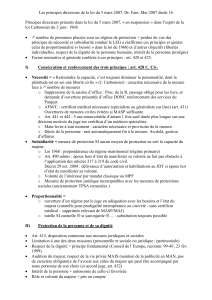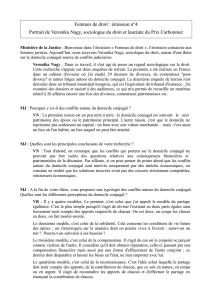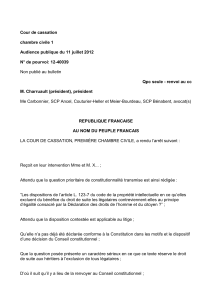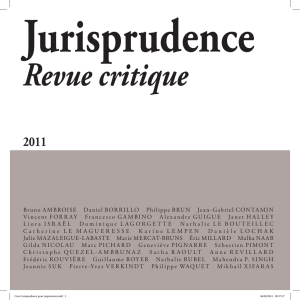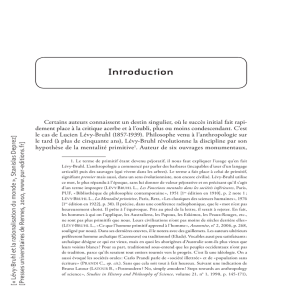Francesco Saverio Nisio - Dipartimento di Giurisprudenza

1
Francesco Saverio Nisio
Lucien Lévy-Bruhl et Jean Carbonnier.
Expérience mystique et droit
1. Jean Carbonnier a exprimé plusieurs fois sa dette envers l’œuvre de
Lucien Lévy-Bruhl , en particulier La morale et la science des mœurs de
1903 et la Préface de la troisième édition 1907
1
.
«Cette lecture m'avait ouvert les yeux sur une autre perspective, la sociologie du
droit»
2
Présence explicite de Lucien Lévy-Bruhl dans les textes de Carbonnier : Flexible
droit, pp. 17, 110, 362 ; Sociologie juridique, Paris, Puf, 20042, pp. 28-38 ; Écrits,
Paris, Puf, 2008, pp. 528, 612, 1052, 1058, 1540. Plus avant on trouvera les
références au Droit civil.
La morale et la science des mœurs, qui fût à l’époque «un livre
choc»
3
, est l’ouvrage fondamental dans le corpus de Lévy-Bruhl, à
l’intersection entre les livres nés dans une perspective académique historico-
philosophique – Lévy-Bruhl a été professeur d'histoire de la philosophie
moderne à la Sorbonne entre 1902 et 1926 – et l’époque des recherches
sociologiques et ethnologiques, dont il a offert les résultats dans plusieurs
ouvrages avec lesquels il est devenu fameux dans le monde savant, le
premier desquels fût, en 1910, Les fonctions mentales dans les sociétés
inférieures.
Carbonnier, il faut le dire tout de suite, s’intéresse bien évidemment
au philosophe autant qu’à l’ethnologue Lévy-Bruhl. Pour en avoir
1
Lévy-Bruhl Lucien, La morale et la science des mœurs, Paris, Félix Alcan,
197116 (la Préface y est incluse).
2
Carbonnier Jean, Flexible droit, Paris, Lgdj, 200110, p. 183n ; voir aussi Andrini
Simona - Arnaud André-Jean, Jean Carbonnier, Renato Treves et la sociologie du droit.
Archéologie d’une discipline, Paris, Lgdj, 1995, pp. 27-28.
3
Carbonnier, Écrits, p. 1037.

2
confirmation il suffit se reporter aux pages de Sociologie juridique
4
où il
discute en détail le thème de la «rationalité» ou «irrationalité» des droits
primitifs en utilisant le langage ordinaire de la philosophie. Ces concepts
fondamentaux des ouvrages ethnologiques de Lévy-Bruhl tels que «raison»,
«raisonnabilité», «rationalité» ou «irrationalité» des sociétés primitives,
«principe d’identité», «schémas de causalité indéterminée», «techniques»,
sont tous bien présents dans la section indiquée de Sociologie juridique et
opèrent, presque tous, sur le fond de la recherche entière de Carbonnier.
Carbonnier souligne que ce langage est utilisé par «beaucoup
d’ethnologues aujourd’hui» par rapport à la présence dans ces sociétés des
techniques - parmi lesquelles le droit - et à leur développement, fait qui
confère aux dites sociétés «primitives» une dimension de «raisonnabilité».
«Dans [la] redécouverte de la rationalité des droits primitifs, quelques ethnologues
en arrivent presque à gommer la différence d’avec les droits modernes. La
mentalité juridique primitive est raisonnable, affirment-ils. Cependant, cette
raisonnabilité ils la saisissent – et c’est l’originalité da la thèse -, plutôt qu’a
l’hauteur de la règle de droit abstraite, dans les sinuosités du procès et du jugement.
Non pas que les acteurs, juges et parties, y fassent profession d’être logiques. Mais,
en fait, on les y voit discuter, en gens raisonnables, d’une conduite qu’ils essaient
d’apprécier par référence à ce qu’aurait fait un homme raisonnable (c’est-à dire,
concrètement, un époux, un père, un chef, etc.) dans la même situation. Ce qui
porterait, en somme à conclure que tous les systèmes de droit, quelle que soit leurs
position sur l’axe de l’évolution, sont équidistants d’une même raison, pour ne pas
dire d’une même justice.»
5
La subtilité de la pensée de Carbonnier est telle qu’il arrive ainsi à
défendre, effectivement, la thèse de Lévy-Bruhl, en la réinterprétant aussi au
bénéfice d’une salutaire critique de la modernité juridique à la Weber : ce
qui relève de l’analyse de la mentalité juridique n’est pas seulement
l’abstraction dogmatique, «logique», c’est-à-dire la règle de droit abstraite ;
c’est plus encore, dans l’évaluation de la «rationalité» dans son complexe,
est le caractère concret da la conduite juridique dans le procès, la conduite
«en gens raisonnables». La dimension «logique» du droit est alors mise en
rapport avec le «caractère concret» de la pratique. Il fût toujours ainsi dans
la vie du droit.
«Rationalité et irrationalité se mélangent toujours, quoique à doses variées […] ;
même dans un système juridique moderne, il ne manque pas d’institutions ou de
comportements qui soient irrationnels par quelque côté. A ce propos, on ne prend
pas assez garde que les différentes parties du droit moderne sont inégalement
fermées à l’irrationalité ou, si l’on préfère, à la primitivité. Il est un secteur qui la
repousse : le droit du patrimoine, dominé par le calcul économique. Mais il en est
d’autres qui l’attirent : le droit des personnes et de la famille, où les institutions et
les comportements doivent s’ajuster à une trame d’événements (l’union sexuelle, la
4
Carbonnier, Sociologie juridique, pp. 28-38.
5
Ibid., pp. 30-31.

3
filiation, la mort) sur laquelle la raison humaine a peu de prise – et, bien sûr, le
droit pénal, si aisément passionné de part et d’autre.»
6
Il faut signaler l’importance de ce dernier texte qui exprime le travail
d’une existence entière consacrée au droit du juriste qui, tout en travaillant
sur le droit des personnes et la famille, a gardé aussi, comme l’on apprend à
plusieurs endroits de son ouvrage, l’œil bien ouvert sur le droit pénal
7
.
Carbonnier, encore, qui a vu dans la «justiciabilité» ou «mise en question»
le critère fondamental de la juridicité, élément ultérieur qui atteste la
survivance «parmi nous [d’éléments] de cette mentalité archaïque»
8
.
«Ce qui s’est passé [à propos de Comte, en cessant de décrire les trois états comme
une succession mécanique de périodes tranchées pour en faire comme un ballet
psychologique,] rappelle un peu l’aventure de la mentalité primitive chez Lucien
Lévy-Bruhl, lorsque les Carnets reconnurent, en un codicille d’exemplaire probité,
qu’au demeurant l’homme pouvait bien rester primitif – théologique – à tout âge de
sa civilisation.»
9
On comprendra alors sans difficultés que Droit civil à plusieurs
endroits comprend une réflexion sur les aspects «primitifs» ou concrets du
droit moderne :
«Personnifier les choses répond à un instinct si primitif, si profond de l’esprit
humain qu’il est des résurgences du phénomène (animisme, anthropomorphisme)
même dans le droit occidental (la personnalité morale sert en partie à cela) : ex. les
fondations, la tentative doctrinale […] pour faire du navire une personne morale et
surtout, dans le droit le plus moderne, qui se croit si peu mystique, la tendance à
personnaliser des biens comme l’entreprise, l’exploitation agricole, que l’homme
sent supérieurs à lui, parce qu’ils sont plus grands et meurent généralement moins
vite.»
10
«Deux directions [à partir des recherches sur les sociétés primitives] peuvent être
retenues par le juriste : 1° Le lien entre la propriété et la personne […] : c’est un
lien mystique, une participation, l’objet possédé participe de la nature de celui qui
le possède. Il serait tentant – mais hâtif – de conclure à une justification
sociologique de ceux qui, aujourd’hui, défendent la propriété individuelle, comme
un irremplaçable prolongement de la personnalité.»
11
6
Ibid., p. 33.
7
Carbonnier, Écrits, pp. 26-27, 764-930.
8
Carbonnier, Sociologie juridique, pp. 318-330.
9
Carbonnier, Écrits, p. 1058. Voir aussi Flexible droit, p. 17.
10
Carbonnier, Droit civil, Paris, Puf, 2004, p. 1597, je souligne.
11
Ibid. pp. 1647-1648.

4
2. Pour construire sa propre méthodologie sociologico-juridique Carbonnier
a donc trouvé appui sur Lévy-Bruhl. On a lu, «Le droit le plus moderne, qui
se croit si peu mystique»: Carbonnier utilise ici le maître-mot de la
«philosophie ethnologique» de Lévy-Bruhl. Quel a été alors le fondement de
leur entente sur le plan philosophique? Il faut se reporter directement à la
Préface de La morale et la science des mœurs pour chercher d’y trouver
réponse. Dans ce texte, Lévy-Bruhl affirme qu’il cherche à fonder
«Une science qui ait la ‘nature morale’ pour objet, et, s’il se peut, un art moral
rationnel, qui tire les applications de cette science»
12
.
Il s’agit donc d’une science appliquée à connaître cette nature morale
de l’homme, laquelle est,
«Au sens plein du mot, une réalité objective, qui ne dépend pas de nous pour
exister, [nature morale] régie par des lois que nous ignorons et qui ne seront mises
au jour que par une recherche méthodique et persévérante»
13
.
«Nature» indique ici des «faits […] régis par des lois que nous
ignorons d’abord, et que la recherche scientifique peut seul découvrir»
14
;
faits d’«ordre moral, […] que nous appelons ‘nature morale’ par analogie
avec la nature physique»
15
.
«Personne aujourd’hui ne conteste plus guère que les institutions sociales, telles
que la religion et le droit par exemple, constituent pour les individus d’une société
donnée une réalité véritablement objective. Sans doute, elle n’existerait pas sans
eux, mais elle ne dépend pas de leur bon vouloir pour exister. Elle s’impose à eux,
elle existait avant eux, et elle leur survivra. C’est là un ‘ordre’ qui, pour n’être pas
physique, mais ‘moral’, c’est-à-dire pour avoir lieu dans des consciences, n’en
présente pas moins les caractères essentiels d’une ‘nature’ dont les faits peuvent
être analysée et ramenés à leur lois»
16
.
On est en face de la nature «sociale» de l’homme, avec sa dimension
obscure et inconnue mais qui peut, néanmoins, être analysée à travers une
démarche scientifique, c’est-à-dire l’observation des comportements et leur
mise en relation avec les croyances collectives, jamais oubliant que les
résultats de cette analyse seront toujours «provisoires», non définitifs ou,
pour utiliser une expression chère à Carbonnier, «hypothétiques»
17
.
Si normalement, affirme Lévy-Bruhl, on s’imagine au contraire de
connaître la réalité morale «par des représentations presque exclusivement
subjectives et sentimentales», en la croyant transformable par des «actes de
12
Lévy-Bruhl, La morale et la science des mœurs, p. XII.
13
Ibid., pp. XXXII-XXXIII.
14
Ibid., p. VII.
15
Ibid., p. VI.
16
Ibid.
17
Ibid., p. XXVII. La formule des lois juridiques a une bonne probabilité de rester
toujours approximative : Carbonnier s’exprime de façon positive en la disant flexible.

5
volonté» qui rendent superflu «le long et pénible détour qui passe par la
science»
18
, cela dépend du fait que
«L’on rejette une analogie trop étroite entre la nature physique et la nature morale,
comme un paradoxe à la fois invraisemblable et dangereux. Mais on oublie que
pendant de long siècles, qui se comptent par centaines et peut-être par milliers, nos
ancêtres ont senti, ont vécu la nature physique comme nous sentons, comme nous
vivons aujourd’hui la nature morale, et peut-être plus intimement encore : je veux
dire qu’elle leur était à la fois plus familière et plus inconnue que la nature morale
ne l’est pour nous. Les croyances et les pratiques des primitifs en fournissent des
preuves sans nombre. Ce n’est donc pas la nature physique, telle que nous la
concevons aujourd’hui, objectivée dans ses lois, qu’il faut comparer à la nature
morale, qui ne nous est connue encore que par des représentations presque
exclusivement subjectives et sentimentales. Il faut rapprocher de cette nature
morale la nature physique des primitifs, ou la nature physique objectivée
d’aujourd’hui [à] la nature morale telle que la science commence à dégager avec
ses lois. Alors l’analogie se justifie, et elle apparaît profonde»
19
.
On voit que dans cette démarche il y a un jeu entre sentiment et
analyse, expérience et recherche méthodique des lois, jamais résoluble au
profit de l’un des deux composants, s’agissant de tenir ensemble les deux
parties de la nature humaine, la rationnelle et l’affective.
En tout cela, Lévy-Bruhl se montre bon spinozien : «nature» signifie
«faits […] qui sont régis par des lois que nous ignorons d’abord» et que
nous pouvons seulement «sentir» ou «vivre», en attendant d’en connaître
l’«ordre» par une recherche méthodique fondée sur l’expérience, qui au
fond aboutit toujours à des connaissances hypothétiques, non dogmatiques.
Personne n’est doté d’un intellect infini, seul capable d’avoir uniquement
idées vraies.
Sur Lévy-Bruhl lecteur de Spinoza, F. S. Nisio, ‘Partecipazione come Scientia
intuitiva. Lévy-Bruhl e Spinoza’, Revue philosophique de la France et de
l’étranger, n°. 3, 2005. Sur le rapport de Carbonnier à Spinoza, F. S. Nisio, Jean
Carbonnier. Regards sur le droit et le non-droit, Paris, Dalloz, 2005, pp. 93-95 et
passim.
3. Dans le dernier ouvrage édité de son vivant, L’expérience mystique et les
symboles chez les primitifs, Lévy-Bruhl a mis à jour avec détail cette
dimension «mystique» de l’expérience, c’est-à-dire invisible et
«mystérieuse», affectivement sentie, émotionnellement vécue. Une
dimension analytique sur laquelle il avait bien travaillé toute au long de sa
vie intellectuelle, mais qui trouve ici son explicitation historico-
philosophique.
18
Ibid., pp. XXXII-XXXIII.
19
Ibid., p. XXXIII.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%