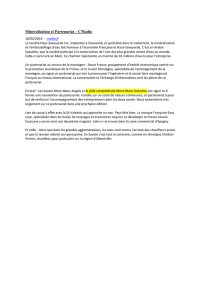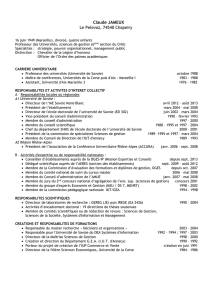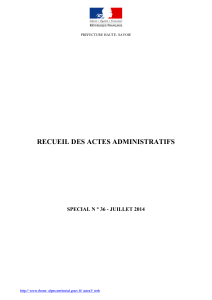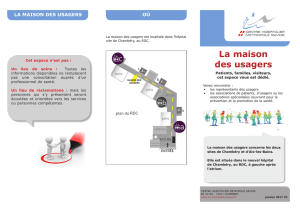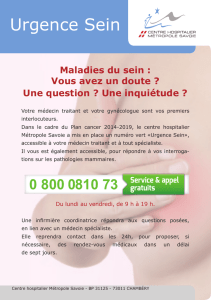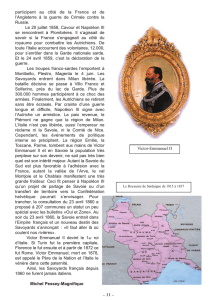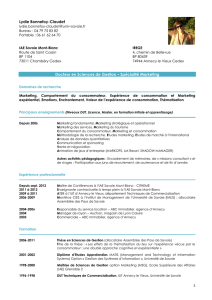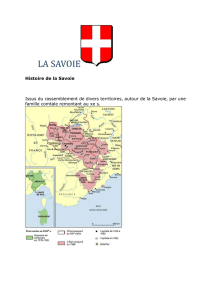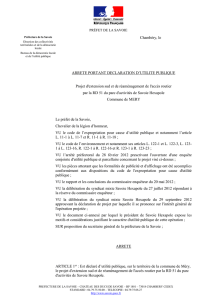L`incorporation bancaire de 1860 : une simple

L
L’
’i
in
nc
co
or
rp
po
or
ra
at
ti
io
on
n
b
ba
an
nc
ca
ai
ir
re
e
d
de
e
1
18
86
60
0
:
:
u
un
ne
e
s
si
im
mp
pl
le
e
a
an
nn
ne
ex
xi
io
on
n
o
ou
u
u
un
ne
e
c
ch
ha
an
nc
ce
e
d
d’
’i
in
nt
té
ég
gr
ra
at
ti
io
on
n
?
?
Hubert Bonin, professeur d’histoire économique à Sciences Po Bordeaux et à l’UMR CNRS 5113 GRETHA-
Université Montesquieu Bordeaux 4 [www.hubertbonin.com]
Sans l’ambition de reconstituer une histoire de l’économie bancaire savoyarde des
décennies entourant le rattachement de 1860, notre projet vise à débattre de la portée de
cet événement sur les structures institutionnelles. Est-ce que, pour la Savoie, il s’est agi
d’une simple « annexion » à un « système bancaire » centralisé, ouvrant ainsi la porte à la
domination de la place, des institutions et des établissements de crédit parisiens ? Ou, au
contraire, l’incorporation aurait-elle pu servir de levier à la maturation d’initiatives
entrepreneuriales et de places bancaires propres à favoriser l’émergence de systèmes
productifs décentralisés à l’échelle des Alpes du Nord ? Pour ce faire, nous nous
appuierons sur des ouvrages de banquiers ou d’universitaires, sur des archives de banques
1
et sur les archives de la Banque de France
2
.
Quand la Savoie rejoint la France, elle ne se trouve absolument pas dans la situation de
l’Alsace-Lorraine en 1918 ; en effet, celle-ci avait connu au XIXe siècle un puissant
mouvement d’équipement industriel et bancaire, et ses banques se posent alors en fortes
banques régionales. Or, en 1860, le degré d’industrialisation savoyard reste modeste, avec
quelques îlots ou sites d’industrie concentrée moderne (dans le textile ou la métallurgie,
par exemple) et des myriades de petits ateliers enclavés sur leur petit marché local ou,
parfois, insérés dans des flux d’échanges que l’on pourrait identifier comme « proto-
industriels ». L’économie bancaire doit se conformer à la prédominance de ces échanges
commerciaux et des formes variées de l’agriculture de vallée ou d’alpage. Sa capacité
d’autonomie est par conséquent contestable ; les « capitales » marchandes ne constituent
guère des places trapues, d’autant plus qu’elles doivent rebâtir rapidement des réseaux
d’affaires pour substituer au pôle de Turin de nouveaux leviers de refinancement ou de
change. L’enjeu du rattachement à la France peut par conséquent concerner aussi le
monde de la banque, car tout essor durable de l’économie savoyarde suppose une
monétarisation intense aux dépens des pratiques de thésaurisation, une mobilisation des
épargnes des foyers ou des patrons d’entreprise au service d’une liquidité fluide par le biais
de la monnaie de banque, et enfin une stabilité des échanges et des réserves de monnaies
de tout type que des capacités de refinancement départementales ou parisiennes peuvent
favoriser.
1. Banque de Savoie contre Banque de France ?
Cependant, dans un premier temps, il faut définir les contours institutionnels de
l’économie monétaire et bancaire savoyarde. En effet, le processus de centralisation des
marchés de l’argent autour d’une institution centrale, la Banque de France, dont le
privilège a été récemment consolidé en 1852, empêche toute velléité d’autonomie ou même
de spécificité. Or la royaume sarde disposait jusqu’alors de deux banques d’émission (et de
1
Nous remercions les services des archives historiques du Crédit agricole et du Crédit lyonnais (notamment
Roger Nougaret et Anne Brunterch et Pascal Penot) et des archives historiques de la Société générale et de la
Banque de l’union parisienne.
2
Nous remercions notamment les Archives historiques de la Banque de France, qui nous avaient largement
ouvert leurs dossiers pour l’entre-deux-guerres, et François Grélard, qui nous a procuré l’ensemble des
rapports numérisés de l’Inspection générale de la Banque de France dans les succursales des deux
départements.

2
réescompte), la Banque nationale, à Turin, et la Banque de Savoie
3
, avec une succursale à
Chambéry et un siège à Annecy, car elle y avait succédé le 26 avril 1851 à la Banque
d’Annecy, elle-même fondée en mai 1840. Son capital avait progressé de 800 000 francs à
1,6 million en 1853, 2 millions en 1856 et enfin 4 millions au début de 1860. Soudain, cette
Banque de Savoie devient un enjeu de spéculations financières et intellectuelles. Jean
Bouvier
4
puis Alain Plessis
5
ont bien analysé les circonstances qui ont accompagné
l’incorporation de la Banque de Savoie à la France.
A. De la Banque de Savoie à une nouvelle économie bancaire ?
Un premier enjeu est académique. Ce rattachement de la Savoie à la France relance certes
un temps les joutes théoriques entre experts à propos de la liberté d’émission de la
monnaie (comme aux États-Unis et en Écosse). En effet, la Société d'économie politique,
qui regroupe les économistes français (à peu près deux cent membres, dont Michel
Chevalier) argue que la « banque libre » serait plus efficace que l’unicité d'émission – dont
Louis Wolowski semble être le seul économiste à défendre le principe en France
6
. Bref,
l’affaire de la Banque de Savoie aurait pu ouvrir la boîte de Pandore d’une remise en cause
du monopole monétaire de la Banque de France (émission de billets et réescompte des
banques). Malgré une floraison de brochures, d’opuscules
7
et d’articles de presse sur cette
affaire de la Banque de Savoie
8
, et après un débat lui aussi théorique au Sénat, qui rejette
la pétition des « libre-banquistes » par 83 voix contre deux (dont Chevalier), les partisans
théoriciens et affairistes (les Pereire) de « la banque libre » subissent une défaite sans
appel…
Un second enjeu est financier et bancaire. Certes, pendant l’été 1860, divers mouvements
spéculatifs portent des investisseurs à ramasser des paquets d’actions de la Banque de
Savoie, en pariant sur un destin autonome, des échafaudages imaginatifs ou une fusion
avec la Banque de France à un cours séduisant – et un quart du capital passe entre leurs
mains, en particulier une petite maison de banque marseillaise, Gay-Bazin, ou des hommes
d’affaires qui ont fondé tout récemment à Paris le Crédit industriel et commerciale.
Les grands banquiers saint-simoniens, les Pereire, envisagent quant à eux d’utiliser la
Banque de Savoie comme levier d’une compétition avec cette Banque de France ou le
monde de leurs rivaux parisiens (les maisons de la Haute Banque, comme les Rothschild
ou les Fould). Les Pereire négocient avec les dirigeants de la Banque de Savoie en 1861-
3
Paul Guichonnet, « La Banque de Savoie sous le régime sarde, 1851-1860 », in Mélanges d’histoire
économique et sociale en hommage au professeur Antony Babel, Genève, Université de Genève, 1963,
pp. 211-230.
4
Jean Bouvier, « Les Pereire et l’affaire de la Banque de Savoie », Cahiers d’histoire (Université de Lyon),
1960, n°4, pp. 383-410 ; réédité dans : Jean Bouvier, Histoire économique et histoire sociale, Genève, Droz,
1968, pp. 135-158. Cf. aussi Georges de Fonclare, Un épisode de l’annexion. La Banque de Savoie et le droit
d’émission des billets, discours de réception à l’Académie de Savoie, 10 janvier 1924.
5
Alain Plessis, « L’affaire de la Banque de Savoie », in Alain Plessis, La politique de la Banque de France
sous le Second Empire, Genève, Droz, 1985, pp. 261-277.
6
Cf. les travaux de l’économiste Gilles Jacoud (nous remercions Marc-Alexandre Sénégas d’avoir attiré notre
attention sur ses travaux) : Gilles Jacoud, La monnaie fiduciaire : d'une émission libérée au privilège de la
Banque de France (1796-1803), Paris, L’Harmattan, 1996. Gilles Jacoud, Le billet de banque en France
(1796-1803), Paris, L’Harmattan, 1996. Gilles Jacoud, « Unicité ou pluralité des banques d'émission ? Les
débats en France (1846-1848) », Études et Documents, n°9, ministère de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 1997, pp. 391-413.
7
Par exemple : Th. Furet, La Banque de France et la Banque de Savoie, ou : Réduction et fixité du taux
d’escompte des banques privilégiées, Paris, 1864.
8
Cf. le dossier « Débats et enquêtes. Opinion de la presse, Banque de Savoie », Archives historiques de la
Banque de France, 500 pages (un exemplaire a été déposé par nous-même aux Archives départementales de
Haute-Savoie).

3
1863 et concluent, le 18 septembre 1863, un projet de contrat qui leur ferait apporter 36
millions de francs lors d’une augmentation de capital énorme de 4 à 40 millions…, comme
s’ils imaginaient d’en faire le ferment d’une seconde Banque de France ! Les Pereire
doivent encore convaincre le pouvoir exécutif parisien, l’empereur – à qui ils remettent une
note en janvier 1864 –, le gouvernement de Rouher, le ministre des Finances – mais leur
rival Fould, un banquier d’une grosse maison de Haute Banque
9
, vient de revenir à ce poste
depuis 1861 –, et évidemment la Banque de France elle-même. Les Pereire remettent un
mémoire analysant leur projet à Fould le 27 novembre 1863. Le « système Pereire » a
besoin d’être alimenté par une forte expansion du crédit, de la monnaie de banque, de la
circulation monétaire, alors que la Banque de France tarde à densifier son réseau de
succursales, fort seulement d’une cinquantaine d’unités. Utiliser la Banque de Savoie pour
créer une nouvelle institution bancaire, voire pour diffuser de la monnaie de banque et du
réescompte, contribuerait à la croissance générale et à l’offre d’argent, en particulier pour
diffuser plus encore les valeurs mobilières (pouvant servir de gage à des prêts). C’est à cette
époque, rappelons le, que les Pereire participent au-delà des Alpes à la création du Crédit
mobilier italien (en 1863), une banque d’affaires insérée dans un schéma d’investissements
en chemins de fer et industries ; et que se fondent successivement le Crédit lyonnais
10
(1863), la Société générale
11
et la Société marseillaise de crédit (1864). L’affaire de la
Banque de Savoie n’est donc pas seulement un « coup spéculatif », car elle s’insère dans un
schéma de pensée et d’action qui dispose de sa logique structurée, diversifier l’économie
bancaire et développer la liquidité d’ensemble de l’économie.
Toutefois, ils doivent vite déchanter : c’est la mobilisation générale contre leurs
conceptions. Le gouverneur de la Banque de France, Adolphe Vuitry, « est fort alarmé des
projets que l’on prête au Crédit mobilier pour une reconstruction de la Banque de Savoie
avec des succursales dans tous les départements, ayant le droit d’émettre des billets en
concurrence avec la Banque de France. Ce projet serait insensé, et, quelques que soient les
espérances que fondent MM. Pereire sur des conversations avec l’empereur, je crois que la
Banque peut être parfaitement tranquille. »
12
Fould prend position fermement : « Je n’ai
nullement encourage M. Pereire dans son projet de la Banque de Savoie. Je vous serai
obligé de faire devenir le gouverneur de la Banque [de France] et de lui communiquer le
sens de cette dépêche qui calmera les inquiétudes qu’il m’a exprimée au nom de son
Conseil »
13
de Régence. « J’ai bien étudié cette affaire et les statuts de la Banque de Savoie
ne lui donneraient tout au plus le doit d’établir des succursales dans les deux départements
du pays. Ainsi que je lui [à Pereire] déjà dit, je regarderais la concurrence qui tendrait à
s’établir entre la Banque de France et la Banque de Savoie comme déplorable, et je
l’empêcherai par tous les moyens possibles. Je suis dans ma position de défenseur naturel
de la Banque de France. »
14
Malgré leurs tentatives et leur groupe de pression, les Pereire
15
ne peuvent percer ainsi
dans le grand Sud-Est, ni par le biais de la Banque de Savoie, ni par leurs intérêts dans les
9
Frédéric Barbier, Finance et politique. La dynastie des Fould, XVIIIe-XXe siècles, Paris, Armand Colin, 1991.
10
Jean Bouvier, Le Crédit lyonnais (1863-1882). Naissance d'une grande banque, Paris, SEVPEN, 1961 ;
Flammarion, 1968 ; EHESS, 1999.
11
Hubert Bonin, Histoire de la Société générale. I. 1864-1890. Naissance d’une banque, Genève, Droz, 2006.
12
Lettre de Fould à Pierre Jules Baroche, 27 septembre 1863, archives Baroche, Bibliothèque Thiers, n°979-
980, cité par Alain Plessis, op.cit., p. 265.
13
Fould à Baroche, 28 septembre 1863, Ibidem.
14
Fould à Baroche, 27 septembre 1863, Ibidem.
15
Cf. Nicolas Stoskopf, Les patrons du Second Empire. Banquiers et financiers parisiens, Paris, Picard,
2002. Jean Autin, Les frères Pereire. Le bonheur d’entreprendre, Paris, Perrin, 1984. Elisabeth Paulet,
« Financing industry: The Crédit mobilier in France, 1860-1875 », Journal of European Economic History,
2002, volume 31, n°1, p. 89-112. Elisabeth Paulet, The Role of Banks in Monitoring Firms. The Case of the

4
chemins de fer puisque c’est devenu un fief ferroviaire des Talabot autour du Paris-Lyon-
Marseille. Celui-ci empêche notamment les Pereire d’obtenir la ligne Sète-Marseille
16
qu’ils
souhaitaient pour obtenir un débouché phocéen à leur Compagnie du Midi (qui gérait le
Bordeaux-Sète) lors du renouvellement et de l’extension des concessions ferroviaires par
l’État en juin 1863.
B. L’absorption de la Banque de Savoie par la Banque de France ?
Malgré ces espérances saint-simoniennes et les débats des libre-banquistes, l’impératif de
l’unicité de la banque d’émission et de réescompte s’impose in fine. La Banque de France,
forte du monopole de la banque d’émission qu’elle a obtenu sur l’ensemble du territoire
national par la convention de 1848, récupère la Banque de Savoie, dont le nom disparaît
(pour un temps) et dont les outils deviennent des succursales de la Banque de France –
tout comme cela avait été le cas en 1848 pour d’autres banques régionales d’émission,
comme la Banque de Bordeaux ou la Banque de Lille.
Un débat de l’époque est toujours ardent, celui qui touche aux fondements mêmes des
accords liés au rattachement de la Savoie. En effet, la convention du 24 août 1860 avait
garanti la pérennité du privilège royal attribué par Charles-Albert à la Banque de Savoie
pour l'émission de la monnaie fiduciaire officielle du duché de Savoie et son respect par les
autorités françaises. Aussi la décision du gouverneur et des Régents de la Banque de
France de revendiquer le monopole de l’émission peut-elle sembler aller en contradiction
avec la convention de 1860 cosignée par les autorités françaises et violer le droit de la
Savoie à émettre sa propre monnaie. Or le décret impérial du 8 avril 1865 autorise « la
cession du privilège d'émission de la Banque de Savoie » à la Banque de France. Celle-ci en
profite d’ailleurs pour intégrer dans ses propres coffres le stock d’or qui servait à la Banque
de Savoie pour garantir ses opérations monétaires.
Un rapport circonstancié est d’abord remis au ministre des Finances (en novembre 1860-
novembre 1861) Jean-Louis Forcade de la Roquette sur le destin de la Banque de Savoie
17
et à une lettre de cadrage du ministre à la Banque de France
18
. Les discussions entre le
ministère des Finances (dirigé par Achille Fould entre novembre 1861 et janvier 1861), le
gouverneur de la Banque de France (Charles de Germiny depuis 1857 puis Vuitry à partir
de juin 1863) et la Banque de Savoie (dont son président, le baron Ruphy) portent sur les
compensations et les modalités du rapprochement
19
. La Banque de Savoie imagine dans un
premier temps une fusion capitalistique, au pair – ce qui aurait justifié le petit boum de
spéculation sur ses actions, qui ont bondi de 1 200/1 300 à 1 800/2 000 francs en 1860-
1861 (par rapport à un pair d’un millier de francs). Mais la Banque de France rechigne à
incorporer dans son bilan des comptes d’une institution qu’elles jugent douteux car la
Banque de Savoie aurait pris trop de risques en acceptant d’escompter des billets de clients
par trop incertains
20
– et d’ailleurs le directeur de la succursale de Chambéry est révoqué
pendant ces discussions. Le gouverneur propose alors en avril 1861 le simple versement
Crédit Mobilier, Londres, Routledge, 1999.
16
Louis Girard, « Le chemin de fer Cette-Marseille », Revue d’histoire moderne et contemporaine, avril-juin
1955.
17
Rapport de l’inspecteur des succursales, A. de Lisa au ministre des Finances Forcade, 4 janvier 1861,
archives historiques de la Banque de France (11 pages).
18
Lettre du ministre des Finances Forcade au Conseil de la Banque de France, 12 janvier 1861, archives
historiques de la Banque de France.
19
Nous nous appuyons sur le rapport annuel du conseil d’administration de la Banque de Savoie pour ces
années 1860-1864, archives historiques de la Banque de France.
20
Comme l’indique le rapport rédigé sur place par l’inspecteur de la Banque de France de Lisa, janvier 1861.

5
d’une indemnité de 600 000 francs pour compenser la perte du droit d’émission
monétaire, tandis que la Banque de Savoie poursuivrait son existence en temps que banque
locale banalisée
21
. Une partie de poker menteur se déroule alors : celle-ci demande 8
millions d’indemnité et entame, on l’a vu, ses discussions avec les Pereire à partir de mars
1862. Une commission présidée par le président de la section des Finances du Conseil
d’État, Vuitry (le futur gouverneur de la Banque de France), propose 1,2 million.
Finalement, ces négociations débouchent sur un traité signé entre la Banque de Savoie et la
Banque de France le 19 novembre 1864. Celui-ci prévoit le payement d’une indemnité de 4
millions de francs à la Banque de Savoie, l’effacement de ses guichets et administration
monétaires, au profit de l’ouverture de deux succursales qui se substitueraient à eux. Le
Conseil général de la Banque de France la demande cette ouverture le 9 mars 1865 et la
décide le 8 avril. Ces deux succursales ouvrent donc leurs portes en 1865, respectivement le
20 avril à Annecy et le 22 avril à Chambéry. Des « bureaux rattachés » viennent plus tard
renforcer cette architecture du crédit, à Aix-les-Bains (1887), Albertville (1899) et Thonon
(1898-1899) – bureau érigé en succursale en 1990.
Entre-temps, la Banque de Savoie, qui aurait pu continuer une vie bancaire classique,
préfère se saborder, faute de repreneurs parisiens et surtout parce que sa situation et son
propre crédit sont devenus précaires. Une assemblée générale décide sa dissolution, le 19
mars 1865 : le royaume sarde ne peut ainsi transmettre aucun héritage institutionnel
bancaire aux nouveaux département.
2. Les premiers ferments des Caisses d’épargne savoyardes
Pourtant, un véritable héritage, bien que modeste, est transmis par le royaume sarde, celui
des Caisses d’épargne. En effet, le mouvement de promotion de l’épargne, de la prévoyance
et de la morale populaire
22
avait essaimé dans toute l’Europe, et le Piémont-Sardaigne
s’était équipé lui aussi des premières institutions philanthropiques patronnées par la
bonne bourgeoisie. Chambéry avait ainsi abrité sa Caisse d’épargne
23
dès le 5 juillet 1835 –
longtemps après celle de Lyon dès 1822, mais seulement un an après celle de Grenoble, par
exemple – avant Annecy en 1841, Rumilly en 1852, Thonon en 1855 et Aix-les-Bains en
1857. Comme ces caisses sont indépendantes les unes des autres, proches de la
municipalité, elles n’ont aucun mal à s’adapter à leur nouvel environnement français en
1860
Néanmoins, elles doivent dorénavant faire remonter presque toute leur collecte à la Caisse
des dépôts, à Paris. Cette centralisation est imposée par une loi de 1852, en échange de la
garantie des dépôts par l’État ; comme les 440 autres Caisses françaises, elles perdent leur
droit de pratiquer des crédits, contrairement aux Caisses restées italiennes ou aux
Sparkassen germaniques à partir des années 1890 : c’est « le choc de l’annexion » et un
« séisme juridique »
24
. Après quelques remous, chaque Caisse vote des statuts conformes à
ces exigences (Thonon dès 1862, Chambéry en 1867) sauf celle d’Aix-les-Bains, qui préfère
disparaître en 1865 et celle d’Annecy qui pratique une résistance passive jusqu’à sa
capitulation de facto en 1887.
21
Jean Bouvier, op.cit., p. 142.
22
Bernard Vogler (dir.), L'histoire des Caisses d’épargnes européennes. Tome 1 : Les origines des Caisses
d'épargne, 1815-1848, Paris, 1991. André Gueslin, « Aux origines de l'État-providence : la mise en place du
modèle français des Caisses d'épargne », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1991, pp. 231-250.
André Gueslin, « L'invention des Caisses d'épargne en France : une grande utopie libérale », Revue
historique, 1989, pp. 391-409.
23
Daniel Duet (dir.), Caisse d’épargne des Alpes. De l’abeille à l’écureuil, Grenoble, 2007.
24
Ibidem, p. 28.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%